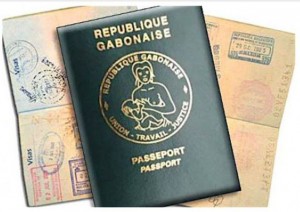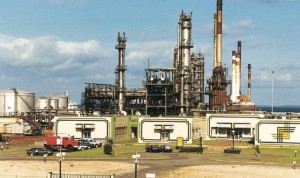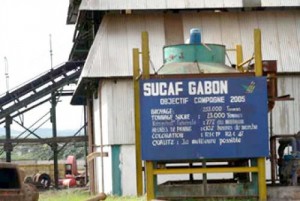Le Nouveau Gabon
La facture des importations gabonaises s’élève à 921 milliards FCFA à fin septembre
La hausse des importations observée au deuxième trimestre de l’année en cours (24,5%), s’est poursuivie jusqu’au 30 septembre, atteignant 346,7 milliards FCFA soit une progression de 8,8%.
Cette évolution est consécutive à l’amélioration des achats des biens énergétiques et d’équipement, assure-t-on au ministère de l’Economie.
Du coup, à fin septembre 2018, le Gabon a enregistré une légère hausse de ses achats en provenance de l’étranger de 1% à 921,2 milliards FCFA.
Cette progression se caractérise par la hausse des commandes des biens énergétiques, notamment le gazole, le coke, le butane ou encore les lubrifiants à hauteur de 88% à 103,1 milliards FCFA.
Une situation que le ministère de l’Economie met en relation avec l’alourdissement de la facture de ces produits en provenance essentiellement du Togo et qui représente 45,6 milliards FCFA.
Côté camerounais, le pays a importé pour 10,2 milliards FCFA ; 4,8 milliards FCFA de la Colombie ; 1,3 milliard FCFA de Guinée équatoriale.
Pour ce qui concerne les importations de biens d’équipements, en hausse de 4%, cela s’explique en partie par « la reprise des investissements des opérateurs du secteur pétrolier, ainsi que l’accroissement des investissements dans le secteur minier ». Cette hausse est très perceptible au troisième trimestre et s’établit à 111,5 milliards FCFA par rapport aux deux premiers trimestres de l’année.
PcA
Le passeport gabonais arrive au 86e rang mondial des passeports les plus puissants
L’index Henley vient de dresser la liste des pays qui détiennent les passeports les plus puissants au monde, en se basant sur le nombre de pays que leurs propriétaires peuvent visiter sans visa.
Au plan mondial, le Japon tient la palme d’or, avec 190 destinations. Il est suivi de Singapour, la France, l’Allemagne, la Corée du Sud qui totalisent, chacun, un voyage sans visa dans 189 destinations. Ensuite arrivent le Danemark, la Finlande, l’Italie, la Suède et l’Espagne, avec des entrées sans visa dans 187 pays.
Au bas du tableau, on retrouve la Palestine, le Soudan, l’Erythrée avec 39 destinations chacun, le Yémen (37), le Pakistan (33), la Somalie et la Syrie (32 destinations) et, enfin, l’Afghanistan et l’Iraq (30 destinations).
Sur le continent, les Seychelles tiennent la dragée haute à tous les autres pays, avec 152 destinations, suivies de Maurice (146 destinations) et l’Afrique du Sud (102 destinations). Ensuite arrivent le Kenya, le Malawi et le Swaziland avec, chacun, 71 destinations.
Le Gabon, malgré une position statique de 86e par rapport au classement 2017, ajoute tout de même cinq destinations sans visa à son répertoire, pour arriver à un total de 55 dans le classement 2018.
Pour rappel, l'index de passeport Henley est un classement de tous les passeports du monde, en fonction du nombre de pays que leurs titulaires peuvent visiter sans visa. Le classement est basé sur des données exclusives de l'Association du transport aérien international (IATA), qui gère la base de données d'informations sur les voyages, la plus vaste et la plus complète au monde, et est renforcé par des recherches internes approfondies.
Stéphane Billé
Les exportations de bois gabonais vers l’Europe en baisse en septembre 2018
C’est la première fois, depuis l’exercice 2016, que les exportations hors pétrole du Gabon enregistrent un repli. Le retrait de 1,6% est la conséquence de la contraction de la demande des produits tels que les bois sciés, le caoutchouc et l’huile de palme.
De manière générale, le bois depuis 2016 est le secteur qui connaît le moins la crise que vit le pays. Mais pour le troisième trimestre de l’année en cours, les ventes de bois sciés vers l’Europe, des différents opérateurs du pays, ont baissé de plus de 30%, en raison des difficultés logistiques du port d’Owendo.
En effet, assure le ministère de l’Economie, de nombreuses entreprises du secteur bois, ne disposeraient plus d’espace disponible pour le stockage des caisses en placage. De plus, l’insuffisance des navires entrainerait le blocage de plusieurs conteneurs, poursuit le ministère.
Prise globalement, la baisse des exportations s’établit à plus de 16% au cours du troisième trimestre. Mais, par continent, la chute des ventes en Afrique culmine à plus de 28% tandis qu’en Asie, elle est atténuée et se situe à 4%.
PcA
Perenco transfère la gestion des participations de l’Etat à Gabon Oil Company
La gestion des 32 participations de l’Etat dans tous les titres pétroliers gabonais détenus par la compagnie pétrolière française Perenco, sera désormais assurée par Gabon Oil Company (GOC).
La société nationale des hydrocarbures à qui cette gestion a été attribuée depuis 2016 au détriment de la direction générale des hydrocarbures, entend désormais défendre les intérêts de l’Etat dans les contrats pétroliers.
Pour Patrichi Christian Tanasa, directeur général de GOC, le partenariat conclu avec Perenco il y a quelques jours, notamment de l’accord de la mise à disposition des 32 titres de participation, matérialise le transfert effectif et définitif de la gestion de ces titres.
«Il faut dire que c’est l’aboutissement de très longues discussions et négociations. Nous devons nous réjouir aujourd’hui des résultats. Nous espérons que les autres opérateurs du secteur pourront suivre le pas.», indique le Dg à la presse locale.
Les 32 titres pétroliers autrefois opérés par Perenco, sont donc désormais la propriété de l’Etat à travers GOC. Dans le détail, trois sont en négociation tandis que les autres, soit 29 au total, sont en production. Ce qui va augmenter les parts de l’Etat dans les recettes pétrolières.
PcA
De janvier à septembre 2018, le Gabon a produit 1 242 425 hectolitres de bière
Selon les données fournies par la Société des brasseries du Gabon (Sobraga), la morosité de l’activité de la branche des boissons gazeuses et alcoolisées observée au Gabon, depuis l’année dernière, tend à s’estomper.
En effet, au terme des neuf premiers mois de l’année, la production totale n’a fléchi que de 0,7% à 2 millions d’hectolitres, en raison de la contraction de la production des boissons gazeuses, des vins et des alcomix.
La production de bières est passée de 1 224 978 hectolitres à la même période, l’an dernier, à 1 242 425 hectolitres. Celles des boissons gazeuses de 744 766 hectolitres, à 713 883 hectolitres et enfin, celle des vins de 33 636 hectolitres à 32 976 hectolitres.
Dans le même temps, le chiffre d’affaires de cette branche a augmenté de 3,7%, pour se situer à 119,8 milliards FCFA contre 115,6 milliards Fcfa en 2017, sous l’effet de la bonne tenue des commandes de bières favorisée par la campagne électorale.
Quant à la production de l’eau minérale, elle s’est établie à 779 999 hectolitres au cours de cette période sous-revue, soit une hausse de 8,4%, par rapport à la même période en 2017. Cette embellie est due à la consolidation de la demande de la gamme Akewa, par les ménages confrontés aux difficultés de fourniture en eau potable.
On note cependant un repli du volume global de production au cours du troisième trimestre par rapport aux deux premiers. On observe également dans cette branche, un repli de 1,4% du chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois, à 11,4 milliards Fcfa.
Stéphane Billé
Les importations d’hydrocarbures en hausse de 41% sur les neuf premiers mois de l’année
Pour satisfaire la croissance des besoins locaux en matière de consommation des produits pétroliers, la société gabonaise de raffinage (Sogara), dans l’optique de faire face au déficit de production, s’est approvisionnée auprès de fournisseurs étrangers à hauteur de 201 098 tonnes métriques.
Ces importations qui affichent une hausse de 41,9% par rapport à la même période en 2017, permettent de se rendre compte qu’en raison de l’augmentation de la consommation de gasoil, le pays a acheté un volume de 122 588 tonnes métriques sur les neuf premiers mois de l’année.
Si le fuel lourd a augmenté de 104,6%, en termes d’importations, celles de gaz domestique s’établissent à 55,4% soit 41 304 tonnes métriques.
Cette situation est liée à la baisse de production des volumes de bruts traités par le raffineur suite aux perturbations techniques survenues en cours d'année et des dysfonctionnements qu'a connus son outil de production.
En effet, le volume de brut traité a baissé de 12,3% à 648 889 tonnes métriques contre 740 146 tonnes métriques en 2017, à la même période.
Les contreperformances ont également été remarquées dans le volet commercial. Les quantités vendues se sont en effet contractées, en raison de la faiblesse de la demande domestique, exceptions faites du « turbine fuel 1 » et du kérosène à l’export qui ont enregistré de très fortes hausses pour se situer respectivement à 25 011 m3 et 20 770 m3.
Le chiffre d’affaires de la société s’est du coup replié de près de 3% à 200 milliards FCFA contre 206,285 milliards FCFA, au troisième trimestre de l’année écoulée.
PcA
La Cemac engage un plaidoyer auprès du FMI pour le rapatriement des recettes d’exportation
Une délégation mandatée par le président en exercice de la Cemac, Idriss Déby Itno, conduite par le président de la Commission de la Cemac, Daniel Ona Ondo, et composée du ministre de l’Economie du Gabon, par ailleurs président de l'Union monétaire d’Afrique centrale, Jean Marie Ogandaga ou encore du gouverneur de la BEAC, Abbas Mahamat Tolli, a présenté la situation économique de la sous-région à la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde (photo), à Washington, le 10 décembre.
Lors des échanges, les représentants de la Communauté ont exprimé des préoccupations quant aux crises sécuritaires multiformes qui secouent la sous-région ainsi que le suivi des réformes entreprises dans le cadre des programmes conclus avec les pays de l’espace communautaire.
En plus de la mise en œuvre des politiques d'ajustement et des mesures contenues dans le Programme des réformes économiques et financières de la Cemac (Pref-Cemac), les émissaires du président de la Cemac ont indiqué qu’il faut une meilleure prise en compte de ces problématiques dans les revues de programmes entre le FMI et les Etats de la région.
Aussi ont-ils souhaité que le FMI continue de soutenir les économies de la Cemac, sachant que 2019 marquera la fin des programmes conclus avec le Cameroun, le Gabon, la Centrafrique et le Tchad. La Guinée équatoriale et le Congo étant encore en négociation avec le Fonds.
Pour ce qui concerne la fuite des capitaux et l’érosion des réserves de change dans la zone, ces deux questions qui conduisent à une spéculation accrue ne sont pas de nature, estime le président de la Commission de la Cemac, à encourager une reprise plus rapide.
C’est pourquoi Daniel Ona Ondo a demandé à la directrice générale du FMI de relayer ce plaidoyer auprès des grandes entreprises qui opèrent en zone Cemac, afin que le rapatriement des recettes d’exportation contribue à sa juste part, à l'amélioration de la situation économique des Etats et au retour à l’équilibre budgétaire.
Pour Christine Lagarde, le Fonds continuera à soutenir et appuyer les Etats de la Communauté dans la poursuite de politiques budgétaires et monétaires efficaces pour le développement.
« Cette volonté de parvenir à une amélioration significative de la situation et à une sortie de crise, a insisté Mme Christine Lagarde, est la raison qui nous a convaincus lors de nos échanges avec les décideurs de la Cemac », explique-t-elle.
PcA
Le transport aérien en repli au troisième trimestre au Gabon
En dépit du dynamisme des compagnies aériennes Afrijet Business Service, la Nationale Régionale Transport et le retour de la compagnie camerounaise Camair Co à l’aéroport international Léon Mba de Libreville, le transport aérien connaît une tendance baissière sur les neuf premiers mois de l’année au Gabon.
Les mouvements d’avions commerciaux ont fléchi de 14,51% à 12 870 vols contre 15055 rotations un an plus tôt. Cette baisse, selon Aérports de Libreville (ADL), est attribuable à l’arrêt des dessertes du transporteur sud-africain South Africa Airways et aux difficultés de Transair Congo.
Dans le même temps, le nombre de passagers transportés par la vingtaine de compagnies qui dessert le pays, a suivi la même tendance baissière. Il est ainsi passé de 623 153 passagers en 2017, à 589 583 passagers à fin septembre 2018, soit un repli de 5,4%.
«Par contre, relève ADL, le volume de fret s’est apprécié de 6,8%, grâce aux résultats de Solenta Aviation, Allied Air Limited, Corex international et Air France qui ont considérablement augmenté leur tonnage».
PcA
Nouvelle réduction de 1,2 million b/j de la production pétrolière de l'OPEP
Vendredi dernier, l’organisation des pays producteurs de pétrole (OPEP) a décidé de reconduire une nouvelle réduction de 1,2 million de barils par jour de son offre pétrolière, à partir de janvier 2019. Les parties prenantes à cet accord indiquent qu’il court jusqu’à juin 2019.
Cet arrangement survient dans un contexte mouvementé par la récente hausse de la production du cartel depuis octobre, la décision du Qatar de s’en retirer et les menaces de Donald Trump d’agir par la manière forte si les membres de l’OPEP ne prennent pas rapidement une décision dans ce sens.
Les pays membres du cartel opéreront une réduction de 800 000 b/j sans l’apport de l’Iran et de Libye, tandis que les pays non OPEP apporteront les 400 000 b/j restants. La Russie à elle seule s’engage à réduire sa production de 200 000 barils b/j pour participer à cette nouvelle politique qui vise à rendre le marché plus attractif.
Commentant l'opération, les analystes de Wood MacKenzie ont déclaré que cette réduction resserrerait le marché pétrolier d'ici le troisième trimestre de 2019, et ferait remonter les prix du Brent au-dessus de 70 $ le baril.
« Cela aiderait les producteurs à faire face à la forte croissance de l'offre américaine en 2019 alors que nous prévoyons une augmentation de 2,4 millions de barils par jour de la production hors OPEP en glissement annuel, alors que l'offre américaine continue de croître fortement.», a-t-on pu lire dans une analyse de Wood MacKenzie.
Olivier de Souza
Sucaf, filiale locale du groupe sucrier français Somdiaa, réalise des ventes de 24 000 tonnes en neuf mois
Les neuf premiers mois de l’année ont été marqués au sein de la branche sucrière par la consolidation des performances enregistrées en début d’année. En effet, souligne le ministère de l’Economie, «hormis le repli de la production de granulés de 50 kg et de la transformation de sucre en morceaux, les autres indicateurs ont connu une évolution ascendante ».
Ainsi, relève le ministère, la production de sucre raffiné a augmenté de 3,3% pour atteindre un volume total de 16 319 tonnes, soutenue par la bonne tenue de la production des autres formes de sucre notamment les doses, les granulés et les sachets de 1kg.
La meilleure des performances réalisées par l’unique compagnie sucrière du Gabon, Sucaf, filiale locale de la multinationale française Somdiaa, réside dans les ventes de sucre qui ont progressé de 2,6% à 24 464 tonnes par rapport à l'année 2017.
Une évolution due à l’augmentation de la demande des boulangeries et des entreprises brassicoles qui ont du coup propulsé le chiffre d’affaires de l’entreprise à 15 milliards
FCFA sur cette période, soit une hausse de 2,7%.
En raison du recours au personnel saisonnier et du renforcement des effectifs de la compagnie en période de récolte, la masse salariale affiche une évolution de 30,5% à 4,2 milliards FCFA sur les neuf premiers mois de l’année.
Les chiffres de la compagnie d’ici la fin de l’année, pourraient davantage s'apprécier en raison du récent accord conclu avec le leader du surgelé gabonais San-gel, qui va commercialiser dans ses rayons de Libreville, les produits de la compagnie.
PcA