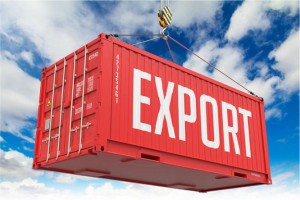Le Nouveau Gabon
Le chiffre d’affaires de Siat Gabon en baisse de 38% au troisième trimestre
La production et la commercialisation de l’hévéa au Gabon par l’entreprise agroalimentaire belge Siat, subit les foudres de la conjoncture internationale.
La filière, au cours des neuf premiers mois de l’année 2018, est restée sur sa tendance baissière observée depuis l’année 2017.
Ainsi, indique la note de conjoncture du ministère de l’Economie, la production de caoutchouc humide en fond de tasse a reculé de 5,3% à 18 576 tonnes au cours des neuf premiers mois de cet exercice.
De même, le volume du caoutchouc transformé en granulés de 50 kg s’est replié de 0,7% à 10 313 tonnes.
La plus grande catastrophe vient du volet commercial de l’activité où le chiffre d’affaires de la société a baissé de 38,4% à 7,2 milliards Fcfa contre 11, 657 milliards Fcfa, il y a un an.
Un repli lié au retrait des volumes exportés en baisse de 14% à 9 325 tonnes contre 10 841,3 tonnes il y a un an à la même période. Autre raison invoquée, la baisse des cours mondiaux du caoutchouc naturel sur le marché international.
Pourtant, au cours des six premiers mois de cette année, l’on avait noté une augmentation des exportations de 6,3% à 15 000 tonnes; ce qui avait conduit à une progression de 37% du chiffre d’affaires de la société belge, à 15,152 milliards Fcfa.
PcA
La filière manganèse poursuit sa progression avec un chiffre d’affaires de 538 milliards Fcfa à fin septembre 2018
La filière manganèse pourrait cette année tutoyer une production de 5 millions de tonnes, si l’on en juge par les performances du secteur au cours des trois premiers trimestres de l’exercice en cours.
Sur les neuf premiers mois de l’année, les entreprises exerçant dans le secteur ont produit 3,96 millions de tonnes de minerai, en hausse de 9,6% par rapport à l’année dernière.
Les bonnes performances enregistrées sur les gisements de Ndjolé par le Chinois CICHMZ et à Franceville par NoGa Mining, le dernier arrivé sur le marché, expliquent cette progression.
Cependant, remarque le ministère de l’Economie dans sa note de conjoncture trimestrielle, les volumes cumulés de minerai exporté, affichent une baisse de 14,7% et se sont élevés à 3,3 millions de tonnes à fin septembre du fait des déraillements de train survenus en février et en juillet. Ce qui a eu un impact sur les ventes externes de minerai en retrait de 10,2% à 3,5 millions de tonnes.
«Sur le plan financier, les ventes de minerai et d’agglomérés de manganèse ont généré un chiffre d’affaires de 538,5 milliards FCFA, soit une progression de 4,2% par rapport à fin septembre 2017, soutenue par le raffermissement des cours mondiaux du minerai de manganèse (6,83 USD/dmtu au troisième trimestre 2018) », relève le ministère de l’Economie.
En fait, assure la note, le prix spot du minerai CIF Chine 44% est repassé au-dessus de 7 USD/dmtu en fin septembre de cette année, en raison de la forte demande mondiale soutenue par les importations chinoise, indienne et européenne.
PcA
Bien qu’en recul, la Chine conserve le maillot jaune des partenaires commerciaux du Gabon
Malgré un recul de 8,8% des biens échangés, la Chine demeure le premier partenaire du Gabon sur les 9 premier mois 2018, avec une valeur des échanges globale estimée à 884,6 milliards de FCFA, contre 970,0 milliards de FCFA l’année précédente, sur la même période. C’est ce que révèlent les données de la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI). Dans ce classement, elle est suivie de la France (284,5 milliards de FCFA), de l’Inde (246,4 milliards de FCFA) et de Trinidad et Tobago (153,1 milliards de FCFA).
Ces données de la DGDDI, soulignent également que les ventes gabonaises à destination de ses dix premiers clients sont en hausse de 32,8%, passant de 1275,2 milliards de FCFA à 1694,1 milliards de FCFA en 2018. L’on souligne cette variation est portée principalement par les commandes de la Chine (29,5%), l’Inde (10,2%), de l’Australie (5,1%) et de Trinidad et Tobago (7,0%), en lien, avec les ventes du Pétrole brut, en particulier.
Par ailleurs, le solde de la balance commerciale avec la Chine a été excédentaire de 568,9 milliards de FCFA, essentiellement en lien avec les ventes du pétrole brut. On note une forte hausse des échanges avec ce pays au cours du troisième trimestre, tout comme avec l’Inde et l’Australie.
Au niveau continental, l’Asie reste le premier client du Gabon (61,8%) devant l’Europe (19,3%), l’Amérique (12,1%) et l’Océanie (5,1%). Les ventes gabonaises, vers cette zone, sont orientées principalement vers la Chine, l’Indonésie et portent essentiellement sur les achats de pétrole.
En outre, à la fin du mois de septembre 2018, les achats du Gabon en provenance de ses dix premiers fournisseurs ont enregistré une diminution de 6,0%, pour se situer à 606,2 milliards de FCFA. Dans ce cadre, le principal fournisseur du Gabon demeure la France (25,8% des parts), suivie de la Chine (8,4% des parts) et de la Belgique (9,2% des parts). Les importations en provenance de ces trois partenaires concernent essentiellement les produits manufacturés.
Par ailleurs, le solde de la balance commerciale avec la France est déficitaire de 191,7 milliards de FCFA à fin septembre 2018. Les principaux produits importés de la France sont les produits de consommation non alimentaires (76,7 milliards de FCFA), les produits alimentaires (47,5 milliards de FCFA) et des outillages, machines et les appareils mécaniques (42,5 milliards de FCFA).
Par continent, le principal fournisseur du Gabon demeure l’Europe avec 48,0% des parts. Elle est suivie de l’Asie (21,4% des parts) et de l’Afrique (20,2% des parts). Cette position de l’Asie est confortée par les livraisons de la Chine, de l’Inde et du Cambodge.
Stéphane Billé
Chute des exportations hors-pétrole au troisième trimestre 2018
Le troisième trimestre de l’année en cours, n’aura pas été favorable pour le Gabon, en matière d’exportations hors-pétrole.
En effet, selon la Direction générale de l’économie, pour la première fois depuis 2016, les exportations hors-pétrole ont enregistré une légère baisse (-1,6%), suite à la contraction de la demande des produits tels que les bois sciés, le caoutchouc et l’huile de palme.
Dans ce cadre, la baisse des exportations de bois sciés (-16,2%) est due à la diminution des ventes vers les continents européen (-30,1%), africain (-28,5%) et asiatique (-4,4%) liée aux difficultés logistiques au niveau du Port d’Owendo. Car de nombreuses entreprises n’auraient plus d’espace disponible pour le stockage des caisses en placage. De plus, l’insuffisance des navires entrainerait le blocage de plusieurs conteneurs.
La chute de la valeur des exportations de caoutchouc naturel (-30,6%) quant à elle, fait suite, en partie, à la dégradation des cours mondiaux du caoutchouc naturel et au repli des ventes à destination de l’Europe (-36,3%) et de l’Asie (-59,3%), ainsi qu’à la baisse de la production nationale. Néanmoins, on note une remontée au cours du troisième trimestre, comparativement aux deux premiers trimestres 2018.
Les exportations d’huile de palme ont également enregistré une baisse à cette période sous-revue, par rapport au deuxième trimestre. En glissement annuel, elles ont observé une baisse de 19,5% à 1,9 milliard de FCFA, malgré la hausse observée des ventes à destination de l’Europe, qui ont quadruplé, passant de 0,4 milliard de FCFA à 1,6 milliards de FCFA. On note par contre un recul des ventes à destination du Bénin, du Cameroun et du Mozambique à fin septembre 2018.
S’agissant des exportations du secteur minier, elles ont connu une forte hausse 25,6% (+21,2% pour les minerais de manganèse et +4,4% pour le ferro-sillico manganèse). Cette évolution a été favorisée par une augmentation des commandes des industries sidérurgiques émanant, notamment de la Chine (pour le minerai de manganèse) ainsi que de la Norvège et du Vietnam (pour le ferro-silico manganèse), d’une part, et une augmentation de la valeur taxable au niveau du cordon douanier de ce produit, d’autre part.
Les commandes des produits dérivés du pétrole ont également augmenté de 4% suite, notamment, à l’amélioration des achats des pays du continent européen (Pays-Bas, Grande-Bretagne, etc..) et du continent africain (Congo, Bénin et Maroc).
Stéphane Billé
Après quatre années d’exécution, la Banque mondiale évalue le PPIC du Gabon
Approuvé en mars 2014, et mis en œuvre en 2015, par le gouvernement gabonais, avec le soutien de la Banque mondiale, le Projet de promotion de l’investissement et de la compétitivité (PPIC), a fait l’objet d’un bilan à mi-parcours, cette fin de semaine.
En présence d’Elisabeth Huybens, et d’Alice Ouédraogo, respectivement, Directrice des opérations de la Banque mondiale et Représentant pays de la Banque mondiale au Gabon, le comité technique opérationnel du Projet de promotion de l’investissement et de la compétitivité (PPIC) a présenté, les premiers résultats clés dudit projet et leur impact sur l’amélioration du climat des affaires.
Ces résultats jugés satisfaisants par les différentes parties partenaires dudit projet concernent : la conception et l’opérationnalisation de l’ANPI-Gabon, et du Haut conseil de l’investissement (HCI), la modernisation du Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM), la construction du bâtiment annexe de la Chambre de commerce et l’accompagnement de 58 projets du concours national du plan d’affaires 2014, 2018, avec un financement de près d’un milliard de francs CFA.
Le PPIC revendique également le financement des missions de promotion de la destination Gabon, notamment en Chine, à Dubaï, au Maroc, à Cuba et en Afrique du sud.
Le guichet unique de création d’entreprises, le développement d’un programme de Partenariats publics-privés, la mise en place d’un pôle d’expertise en développement des chaînes de valeur, l’appui à l’amélioration du deux réformes du Doing Business, le développement de trois nouveaux centres de services aux entreprises au niveau de la Chambre de commerce de Libreville, constituent également les fruits de ces quatre premières années du PPIC.
Evalué à près de 9 milliards FCFA (18 millions de dollars), le PPIC a pour objectifs principaux, de favoriser le développement institutionnel pour améliorer le climat des affaires, d’appuyer le développement des entreprises et de promouvoir le dialogue public-privé.
Outre les partenaires de la Banque mondiale, cette rencontre a vu la participation des ministres de l’Industrie, de l’Entreprenariat national, Estelle Ondo, de sa collègue de la Promotion des Investissements, Madeleine Edmée Berre, et du coordonnateur général du Bureau de coordination du Plan stratégique Gabon émergent (PSGE), Liban Soleman.
Les premiers bénéficiaires dudit projet ont également présenté les produits de leurs investissements au cours de cette cérémonie et, ont en même temps, évoqué les points à améliorer.
Stéphane Billé
La BAD va financer les études de faisabilité des projets du Plan national stratégique Gabon digital 2025
Le projet d’élaboration d’un Plan national stratégique (PNS) « Gabon Digital 2025 », vient de recevoir un coup de pouce de la Banque africaine de développement (BAD).
A travers ce financement, l’institution financière panafricaine s’engage ainsi à couvrir les coûts des études complémentaires du projet de la dorsale à fibre optique d’Afrique centrale CAB, à hauteur de de 325 000 USD, sous forme de don, à travers le Fonds fiduciaire de coopération Afrique-Corée (KOAFEC).
L’accord a été acté ce 5 décembre 2018, entre l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (ANINF) et le Groupe de la Banque africaine de développement.
De manière concrète, cette assistance financière permettra entre autres d’élaborer des études de faisabilité exhaustives techniques et économiques, pour la mise en place d’un portail internet gouvernemental ; d’un Système national d’identité digitale (SNID) ; d’une plateforme d’interopérabilité, de mutualisation et de gestion de données, des services administratifs en ligne ainsi qu’un système de paiements digitaux de l’administration.
Ce financement permettra également l’intégration et la migration des systèmes d’information sectoriels ; l’implémentation d’une plateforme d’Open Data opérationnelle ; la Revue du cadre juridique et règlementaire applicable à la régulation et protection des données personnelles au droit à l’information et la mise en place d’un écosystème favorable à l’innovation et la gouvernance digitale.
Par ailleurs, elle complétera les études de faisabilité des volets infrastructurels (fibre optique, Datacenter et plateformes CSIRT/SOC/PKI) du même projet CAB-Gabon et qui sont également financées par la BAD dans le cadre d’un don d’un montant de 855 000 USD, grâce au Fonds spécial IPPF-NEPAD.
L’on indique que ces différentes études permettront de réunir tous les prérequis (vision, stratégie, plan d’actions, études de faisabilité des projets prioritaires, etc.) pour lancer un programme d’envergure de transformation digitale du Gabon sur la base des résultats des études susmentionnées. La durée de cette mission est de quatre mois à compter de la date de signature du contrat.
Stéphane Billé
Le nombre de diabétiques triple au Gabon en 25 ans
C’est au cours des travaux scientifiques du 5ème congrès de la Société francophone africaine de diabétologie (SFAD) que les experts ont communiqué ces statistiques inquiétantes.
« Nous avons, en 25 ans, triplé le nombre de diabétiques, passant de 2 à près de 10 %. Et si rien n’est fait dans les 20 ans à venir, nous serons à 14 % de diabétiques. A ce jour, un Gabonais sur dix est diabétique ou ignore qu’il l’est. Ces chiffres sont éloquents et inquiétants », explique Eric Baye, endocrinologue, à la presse locale.
Des chiffres qui font dire aux experts que le Gabon est aujourd’hui l’un des pays les plus touchés avec 10 % de la population atteinte de diabète. Une progression qui tient au changement de mode de vie selon les médecins.
« La prévalence et surtout l’incidence de l’explosion du diabète dans nos pays sont liées aux modifications brutales de notre mode de vie. On mange trop sucré, trop salé, trop gras ; on ne fait pas beaucoup de sport et tout cela entraîne l’explosion du diabète dans nos villes », explique-t-il.
D’après l’OMS, le diabète est en passe de devenir la 7ème cause de mortalité dans le monde. Aussi plaide-t-on de ce côté pour une baisse des coûts du traitement.
PcA
Eramet et le Gabon revisitent les 70 ans de coopération
L’Etat gabonais et le groupe Eramet, maison mère de la Compagnie minière de l’Ogooue (Comilog), ont entamé ce 6 décembre à Libreville, l’examen des questions relatives à l'amélioration de leur partenariat, s’agissant des activités dans les secteurs miner et ferroviaire dans notre pays.
Les travaux concernent l’ensemble des filières de la multinationale française au Gabon, notamment les filières minières avec la Comilog et Maboumine, le tourisme, la pêche et la gestion des parcs naturels avec la société d’exploitation du parc de la Lekedi (Sodepal), située dans le Haut-Ogooue, (Sud-Est du Gabon), et le transport ferroviaire avec la Setrag, devront être bouclés dans un délai de trois mois. Ce qui permettra, selon les deux parties, d’envisager la perspective mutuellement bénéfique de la consolidation et de l'amélioration de leurs intérêts économiques.
«La filière manganèse est un secteur qui est important dans le développement du secteur minier. Nous estimons qu’il était temps de faire un bilan par rapport à la coopération telle qu’elle a eu lieu pendant 70 ans entre Eramet et le Gabon ; réécrire une nouvelle lettre de mission et se fixer de nouvelles ambitions de développement autour de ce partenariat stratégique.», souligne Christian Magnagna, ministre des Mines.
Le secteur minier pèse un peu plus de 4% du PIB du Gabon. Il est question de porter cette contribution à 8% du PIB dans les années à venir, selon les deux parties.
Pour Kleber de Souza Silva, directeur général adjoint en charge des branches minières chez Eramet, il est question de développer l’activité minière dans le long terme.
«C’est une commission de travail entre le gouvernement et Eramet qui vise à aller plus loin, développer des activités de long terme et supporter l’activité minière dans le pays.», explique le Dg adjoint pour qui la nomination de Leod Paul Batolo comme administrateur directeur général, permettra de relever des défis à court, moyen et long terme.
La commission ad hoc mise en place pour cette mission, va plancher pendant trois mois sur les questions de concession, de licence et d’autorisation d’exercer.
PcA
La FAO plaide pour une meilleure gestion durable des sols au Gabon
C’est à la faveur de la journée mondiale des sols que Helder Mutéia, coordinateur du bureau sous-régional de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), a invité les populations et les autorités gabonaises à œuvrer pour une gestion efficace et durable des sols.
« Les sols sont le support des êtres vivants, animaux et végétaux. Ils sont la base de toute production alimentaire et des services écosystémiques de la matière et de l'énergie entre l'atmosphère, les eaux souterraines et la couche végétale.», explique-t-il à la presse locale.
Pour lui, à l’heure des changements climatiques et des difficultés de plus en plus accrues des communautés à se nourrir et à cultiver sur des sols fertiles, il est temps que tout le monde s’active pour en assurer une gestion durable.
« Ils jouent un rôle-clé dans le changement climatique en tant que deuxième réservoir naturel de carbone après les océans. Ils abritent une extraordinaire biodiversité très utile au cycle de la vie sur notre planète.», poursuit Helder Mutéia.
PcA
Le secteur pétrolier gabonais en proie à de fortes fluctuations
Le secteur pétrolier gabonais a durement subi les impacts du déclin naturel de ses champs matures, des interruptions de production pour travaux de maintenance des machines et du retard enregistré dans la mise en œuvre de certains projets de développement, au cours des trois premiers trimestres de l’année en cours.
Durant cette période, le secteur s’est caractérisé par un fléchissement de son activité. En effet, la production nationale de pétrole brut a baissé de 10,2% pour se situer à 7,143 millions de tonnes métriques.
Dans le même temps, les exportations se sont contractées de 8,9% à 6,594 millions de tonnes métriques, orientées principalement vers l’Asie (77,7% des exportations).
A contrario, les cours de pétrole brut se sont appréciés, enregistrant des hausses respectives de 38,3% et 40,8% pour le Brent (71,79 dollars le baril) et le prix moyen des bruts gabonais (70,41 dollars le baril) dans un contexte international marqué par des risques de tension sur l’offre.
Dans le même temps, le taux moyen de change du dollar par rapport au franc CFA s’est également déprécié de 7% à fin septembre 2018, pour s’établir à 549,36 FCFA pour un dollar américain contre 590,5 FCFA en septembre 2017.
Stéphane Billé avec le Direction générale de l’économie.