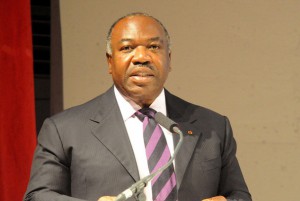Le Nouveau Gabon
Nouveau port international d’Owendo : tumultueuse cohabitation entre la GSEZ Port et le groupe Bolloré
La cogestion du nouveau port d’Owendo entre la GSEZ Port et le groupe Bolloré, gérant du terminal à conteneurs de ladite infrastructure, semble essuyer ses premiers revers.
En effet, depuis près de trois mois, du fait des problèmes liés à la logistique ainsi qu’au transport, la nouvelle infrastructure portuaire éprouve des difficultés à approvisionner ses principaux clients asiatiques en facettes d’Okoumé, leur principale matière première. Ainsi, du fait d’une gestion peu optimale du terminal par Bolloré Transport & Logistics, de nombreuses unités n’auraient plus d’espaces disponibles aujourd’hui pour stocker leurs caisses en placages, indique-t-on.
À ces griefs, s'ajoute le scénario d’une logistique locale lourde qui se traduit par le long délai de livraison aux principaux acheteurs et qui met en péril, «le calcul des bénéfices lorsque nous avons acheté des terrains coûteux et des usines bien établies», a récemment déclaré un producteur confronté à cette situation.
Selon certaines sources, cette situation vient clairement poser le problème de la difficile cohabitation entre la GSEZ Port et Bolloré Transport & Logistics, deux entreprises aux visions économiques peu communes. Une situation qui, malheureusement obère les efforts fournis par la GSEZ, pour un meilleur flux portuaire, avec la conséquente production de la Zone économique spéciale de Nkok, destinée en grande partie à l’exportation.
Or, le Gabon qui peut actuellement exporter de 300 à 350 conteneurs de facettes d’Okoumé par mois sur le marché indien et partant international, est confronté à l’épineux problème de la disponibilité des cargos et des conteneurs.
Une situation que déplorent les industriels indiens du contreplaqué et les acheteurs commerciaux, qui sont en attente de leurs commandes enregistrées depuis près de deux à trois mois.
Stéphane Billé
L’Aganor prépare l’entrée sur le marché européen de l’huile de palme produite au Gabon
C’est au cours d’une rencontre avec le vice-président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Nicaise Moulombi, le 1er octobre 2018, à Libreville, que le directeur général de l’Agence gabonaise de normalisation (Aganor), Joseph Ngowet, a indiqué que le Gabon prépare l’entrée sur le marché européen et ailleurs de l’huile de palme produite au Gabon.
Mais, pour y parvenir, le produit doit répondre aux exigences normatives de ce marché. C’est pourquoi une réflexion est en cours pour permettre à cette huile issue du processus de diversification de l’économie du pays de générer des devises, au même titre que le pétrole, le bois et les différents minerais exploités au Gabon.
« Le Gabon a décidé de diversifier son économie autour du palmier à huile et il fallait voir avec l’agence de normalisation comment elle se prépare pour l’entrée du produit sur les marchés européens et autres. Cela nous a permis à la fois d’évaluer les capacités de l’agence au niveau des ressources humaines, ses capacités techniques et surtout financières », explique le vice-président du CESE.
3000 tonnes d’huile de palme ont été exportées au mois de mai dernier, au départ du terminal portuaire d’Owendo, selon Olam Palm Gabon.
PcA
Blanchiment d’argent : le Gabac met à l’index l’immobilier et les transferts de fonds
Le directeur des affaires juridiques et du contentieux du Groupe d’action pour le blanchiment d’argent en Afrique centrale (Gabac), Saturnin Bitsy, a jeté un pavé dans la mare lors de la séance plénière d’ouverture des travaux de la réunion du 28 septembre dernier à Libreville, dédiée à l’harmonisation des textes de l’institution avec l’environnement international.
D’après lui, le blanchiment des capitaux existe «bel et bien» au Gabon sous différentes formes. «C’est vraiment à déplorer (…) Vous voyez tous les immeubles qui poussent; des immeubles dont la valeur contraste avec les revenus déclarés du citoyen.», rapporte-t-il à la presse locale.
Ce haut responsable poursuit son propos en indiquant que les circuits de blanchiment utilisés vont de l’immobilier à la création d’écoles privées en passant par les transferts de fonds et les unités de production industrielles.
«Vous avez aussi les écoles privées qui sont des canaux de blanchiment, des transferts de fonds. Il y a beaucoup de canaux qui permettent de blanchir de l’argent. Il est vrai, comme on dit au Gabon, on paie bien, il y en a qui ont beaucoup d’argent ; mais est-ce que ces immeubles qui sont construits, ces structures, ces unités de production qui sont créées sont en adéquation avec les revenus déclarés des citoyens?», s’interroge le haut responsable du Gabac.
Du coup c’est un faisceau de préoccupations qui donne «matière à réfléchir ». Car, souligne-t-il, en dépit de la présence d’une agence nationale d’investigation financière qui reçoit des dénonciations de la part des établissements bancaires, des poursuites judiciaires n’ont encore jamais été initiées contre un individu pour blanchiment de capitaux au Gabon.
PcA
Pour cause de grève des magistrats en 2017, la justice gabonaise va programmer des audiences exceptionnelles pour vider les affaires
Lors de la rentrée judiciaire présidée le 1er octobre 2018 à Libreville par le premier président de la Cour de cassation, Jean-Jacques Oyono, au nom de toute la corporation, et à laquelle a pris part le chef de l'Etat, Ali Bongo Ondimba, des mesures d’urgence ont été annoncée afin de rattraper le retard dans le traitement des dossiers des justiciables.
Ainsi, assure-t-il, du fait des longues grèves qui ont émaillé l’année judiciaire 2017 au Gabon, de nombreux dossiers sont restés sans traitement. Ce qui a eu pour conséquence de rallonger le temps de détention de certains prévenus et des détenus dont le sort aurait pu connaître meilleur destin.
Pour Jean-Jacques Oyono, la Justice va programmer des audiences exceptionnelles afin de rattraper le retard pris dans la liquidation des dossiers. Mais avant la programmation de ces audiences exceptionnelles, elle tiendra une assemblée générale qui permettra de faire un inventaire des dossiers en souffrance.
PcA
Le Gabac veut actualiser ses textes à l'environnement international de lutte contre le blanchiment d'argent
Selon Etienne Tabi Mbang, directeur des études et de la prospective au sein du Groupe d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique centrale (Gabac), les dispositifs réglementaires de l’institution ne sont pas suffisamment adéquats pour les adapter à la lutte contre le blanchiment d’argent dans l’espace communautaire au regard des innovations régulières qui interviennent dans le secteur financier.
«Il y a de nouveaux produits qui arrivent sur le marché de manière régulière alors même que nos différents textes sont plus ou moins caducs.», explique-t-il à la presse locale.
Au regard du nombre de méthodes et de stratégies que déploient les criminels en zone Cemac afin de blanchir les capitaux, le renforcement des dispositifs règlementaires adaptés s’avère nécessaire afin d’en circonvenir les dégâts.
C’est ce qui a motivé la tenue d’une réunion des responsables du Gabac en fin de semaine dernière à Libreville, dont l’objectif visait la prise de certaines décisions devant désormais s’appliquer à l’ensemble de la sous-région. Et parmi celles-ci, il y a l’opérationnalité des agences nationales d’investigation financière.
«Nous avons abordé un certain nombre de points, à savoir la modification de certaines dispositions du règlement qui porte prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme.», confie Saturnin Bitsy, directeur des affaires juridiques et du contentieux au Gabac à la presse locale.
PcA
Ali Bongo annoncé au Forum de Paris sur la Paix en novembre prochain
La première sortie du nouvel ambassadeur de la République française près le Gabon, Philippe Autié devant ses compatriotes installés au Gabon, il y a quelques jours, aura été annonciatrice du calendrier diplomatique à court terme, du chef de l’Etat gabonais, Ali Bongo Ondimba (photo).
Dans son message, le diplomate français a laissé entendre que le président de la République gabonaise et son homologue français, Emmanuel Macron, allaient se retrouver en novembre prochain, à l’occasion du Forum de Paris sur la paix, mais aussi pour les commémorations du Centenaire de l’armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale (1914 à 1918).
Pour rappel, le Forum de Paris sur la Paix, organisé dans la continuité des cérémonies commémoratives du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, aura lieu du 11 au 13 novembre 2018 à la Grande Halle de La Villette à Paris.
D’après le comité d’organisation, il constitue une réponse à la montée des tensions dans le monde contemporain. Son objectif est de faire avancer la paix par une meilleure gouvernance mondiale et de favoriser tout ce qui concourt à faire baisser les tensions internationales à savoir : la coopération des États pour faire face aux défis transfrontaliers, la gestion collective des biens publics mondiaux, une meilleure régulation de l’Internet et des échanges, etc.
Il a également pour vocation à devenir le rendez-vous annuel des projets, idées et initiatives qui contribuent de manière effective, à une meilleure coopération internationale sur les grands enjeux globaux, à une mondialisation plus juste et plus équitable et à un système multilatéral plus efficace.
Cette rencontre est structurée autour de cinq thématiques : paix et sécurité, environnement, développement, numérique et nouvelles technologies, économie inclusive.
De nombreux chefs d’État et de gouvernement, des représentants des grandes organisations internationales, mais aussi des acteurs issus de la société civile - soit plusieurs milliers de participants - y sont attendus.
Stéphane Billé
L’Etat gabonais annonce des recettes de l’ordre de 853,6 milliards FCFA au premier semestre 2018
Selon les livres de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor (DGCPT), sur un objectif prévisionnel annuel de 1 842,6 milliards FCFA, le montant total des recettes recouvrées par L’Etat gabonais, à la fin du premier semestre de l’année en cours, est de 853,6 milliards FCFA, soit un taux de réalisation de 46%.
Comparées à juin 2017, où le niveau atteint était de 813,2 milliards FCFA, ces recettes ont connu une augmentation de 40,4 milliards, représentant une progression de 5%, précise la même source.
De manière détaillée, la DGCPT fait savoir que dans ces recouvrements, les recettes fiscales s’élèvent à 536,1 milliards FCFA, et représentent une exécution de 44% par rapport aux prévisions initiales évaluées, à 1 205,3 milliards. Et qu’en glissement annuel, ces encaissements sont en augmentation de 15%, grâce essentiellement à l’exécution des recettes pétrolières à 74,1 milliards FCFA, soit une hausse de 53 milliards FCFA.
Quant à l’impôt sur les sociétés du secteur hors pétrole, il s’établit à 137,2 milliards FCFA, contre 131,1 milliards un an plus tôt. Pour la DGCPT, ce rendement de 66%, par rapport aux prévisions annuelles, s’explique essentiellement par les performances remarquables réalisées sur les sociétés minières à hauteur de 60,9 milliards FCFA.
S’agissant des recettes douanières, elles ont été recouvrées à cette période étudiée à hauteur de 121, 2 milliards FCFA, soit un taux d’exécution de 34%, par rapport aux estimations initiales. Ce résultat serait en partie lié, indique-t-on, à la baisse de 2,1% du niveau général des importations taxables.
Les recettes non-fiscales connaissent quant à elles, une baisse de 8% comparativement à juin 2017 (317,5 en 2018, contre 345,2 milliards en 2017). Ce résultat est principalement imputable au faible rendement des revenus tirés des contrats de partage de production, et ceux des domaines pétrolier, minier et forestier. Lequel rendement est en recul de 55,3 milliards par rapport au niveau atteint à fin juin 2017.
Stéphane Billé
33 villages des provinces du Haut-Ogooue et de l’Ogooue-Ivindo désormais connectés
18 000 habitants de 33 villages situés sur l’axe Makokou-Okondja respectivement dans les provinces de l’Ogooue-Ivindo et du Haut-Ogooue, sont désormais connectés au monde grâce au projet de téléphonie rurale.
Selon la présidence de la République, le projet qui a livré sa première phase ce 29 septembre 2018, va permettre aux populations vivant ou de passage sur cet axe, de bénéficier d’un réseau de téléphonie mobile performant et surtout d’une connexion internet haut débit.
Lancé en 2016 dans une localité de la province de l’Ogooue-Ivindo, le projet vise la réduction de la fracture numérique à travers l’accès facilité des populations à la technologie GSM ainsi que la couverture de la zone en Internet 4G.
Outre ces aspects, il y a également le développement de l’économie numérique et des TIC dans les zones reculées.
Le projet qui a nécessité la mobilisation de 3,7 milliards Fcfa, permettra dans sa seconde phase, de réaliser une couverture additionnelle de 204 villages sur l’étendue du territoire.
Financé par le Fonds spécial du service universel des télécommunications, le projet vise la couverture de la grande partie du territoire gabonais en téléphonie mobile et en TIC, question de donner corps au volet numérique du Plan stratégique Gabon Emergent qui entend à l’horizon 2025, atteindre la majorité des localités du pays.
PcA
La Zone économique de Nkok va mettre sur place un guichet unique électronique
L’amélioration de la balance courante du Gabon et la transformation industrielle de l’économie passe par une amélioration des exportations plus compétitives des produits «made in Nkok ». Aussi l’Autorité administrative de la Zone économique à régime privilégié de Nkok s’est-elle réunie avec la société singapourienne VCC, afin de peaufiner la mise en place d’un guichet unique électronique des opérations au sein de la zone.
La rencontre qui s’est déroulée en présence des représentants du gouvernement de Singapour, avait pour objectif de regrouper l’ensemble des systèmes impliqués dans les opérations d’Import/Export en une seule plateforme accessible à tous les acteurs.
Il est question pour les administrations et les opérateurs économiques de réaliser les opérations au sein de la zone de manière fluide, car à terme, il est question pour ce guichet de contribuer à la levée des goulots d’étranglement, faciliter et réduire de façon significative le traitement des opérations.
PcA
La CAISTAB crée des emplois dans le circuit de la commercialisation du gaz domestique pour lutter contre le chômage des jeunes
Afin de prêter main-forte à l’Etat dans le cadre de la lutte contre le chômage des jeunes, la Caisse de stabilisation et de péréquation (CAISTAB), en partenariat avec Total Marketing vient de lancer un concept singulier, baptisé programme ‘’ACTIONGAZ’’.
Selon le directeur général de CAISTAB, Ismaël Ondias Souna, cette initiative revêt deux principales composantes. La première consiste à autonomiser 300 jeunes Gabonaises et Gabonais afin qu’ils deviennent un maillon essentiel de la chaîne de distribution de gaz butane en République gabonaise, grâce à la vente de bouteilles de gaz butane.
Ce programme d'une durée de deux ans, permettra par ailleurs à ces derniers «de bénéficier d’un métier et d’un revenu mensuel estimé à 120 000 francs CFA minimum», a poursuivi Ismael Ondias Souna, lors du lancement de ce programme à Franceville dans la province du Haut-Ogooué.
L’autre effet porteur de cette initiative tel que résumé par Christian Nyama, le représentant de Total marketing Gabon, est qu’il « a pour finalité de contribuer à ce que ces jeunes entrepreneurs deviennent propriétaires de leurs fonds de commerce à court terme».
Quant à la seconde composante de ce programme ‘’ACTIONGAZ’’, elle repose sur l’harmonisation du prix de vente du gaz butane sur toute l’étendue du territoire, à travers un mécanisme de péréquation. Ce programme permettra également, a-t-il poursuivi, de répondre efficacement à la distribution de bouteilles de gaz butane dans les zones reculées du pays.
Pour la phase pilote de ce programme, ce sont les provinces du Haut-Ogooué et de l’Ogooué-Lolo qui ont été choisies. Il s’étendra par la suite dans les autres provinces du pays, avec notamment celles de l’Ogooué-Maritime (Omboué et Gamba) et de l’Estuaire, dans les prochains jours.
Stéphane Billé