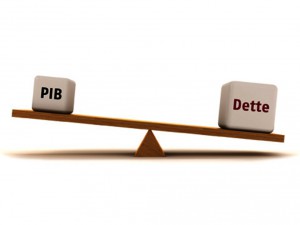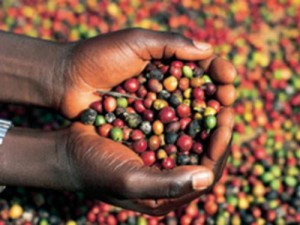Le Nouveau Gabon
Les conseils économiques et sociaux d'Afrique en quête de visibilité à Libreville
Les conseils économiques, sociaux et culturels, réunis à Libreville depuis le 28 novembre 2018, veulent faire face aux défis relatifs au financement de leurs activités ainsi qu’à l’adaptation des Etats et de leur structure au changement climatique.
L'assemblée générale de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique (UCESA), qui se tient dans la capitale gabonaise plaide aussi pour une plus grande visibilité de leurs activités et de leurs structures au sein de l’appareil étatique sur le continent.
Boulkassoum Haidara (photo), président du bureau de l’Ucesa, face au premier ministre, a décliné les missions et le rôle des conseils économiques et sociaux. Ainsi, apprend-on, l’Ucesa vise une implication des conseils économiques et sociaux dans le processus d’intégration des Etats; la promotion du dialogue social; l’organisation de rencontres périodiques de réflexion et une coopération féconde avec les organisations internationales partenaires ou sœurs.
Au Gabon, indique Issoze Ngondet, à la faveur de la tenue du dialogue politique l'année dernière, le gouvernement a entériné les réformes du Conseil économique, social et environnemental et décidé du renforcement du rôle de cette institution.
En accord avec les responsables de l’Union des conseils économiques et sociaux, il est également favorable à une plus grande visibilité à accorder à ces institutions « qui sont d'une grande utilité pour la vitalité de la démocratie » en Afrique.
PcA
Le groupe pharmaceutique cubain Labiofam veut booster la mise en œuvre de son accord avec le gouvernement
Depuis 2013, le groupe pharmaceutique cubain Labiofam, a conclu un contrat de services portant sur la lutte contre les vecteurs de maladie.
Mais, depuis un certain temps, les difficultés observées dans le règlement des créances de l’Etat en vue de faire fonctionner le programme, handicapent l’opérationnalisation de l’accord et le déroulement des travaux du groupe pharmaceutique.
Le groupe, selon le gouvernement, a mis en place un procédé qui aide à contrôler les rats, les souris ainsi que les larves de moustiques, sans dommage pour l’environnement ni danger pour les êtres humains.
Ce procédé qui a fait sensation en Asie et en Amérique latine, est un atout indéniable pour le Gabon en termes de prévention des maladies, des épidémies, des pandémies et des épizooties et peut contribuer à la réduction des dépenses très élevées de santé, notamment pour ce qui est des achats de médicaments chaque année par le gouvernement.
Aussi, ont-ils été voir le Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondet à l’effet d’examiner les voies et moyens de remettre la mise en œuvre efficace des accords de coopération que le Gabon a signés avec Cuba.
Au regard de l’importance de cet accord, le Premier ministre a tenu à rassurer les responsables du groupe Labiofam, notamment sa responsable régionale, sur le respect de l'engagement du Gabon concernant cet accord bilatéral et l’apurement des créances gouvernementales pour la poursuite efficace du programme.
PcA
Afrique centrale : la BAD, la CEEAC et la FAO promeuvent l'employabilité des jeunes dans les chaines de valeur agricoles
Dans le but de favoriser la promotion d’une agriculture de marché à travers l’entrepreneuriat agricole en Afrique centrale, la BAD, la CEEAC et la FAO ainsi que plusieurs autres bailleurs de fonds et partenaires au développement multiplient des initiatives.
C’est dans cette optique qu’une rencontre s’est tenue, il y a quelques jours à Libreville, entre le Coordonnateur du bureau sous-régional pour l’Afrique centrale et représentant de la FAO au Gabon, et à Sao Tomé et Principe, Helder Muteia et l’économiste principal du travail de la Banque africaine de développement (BAD), Amadou Bassirou Diallo.
Cette rencontre entrait dans le cadre d’une mission de la BAD qui vise l’identification du projet régional pour l’employabilité des jeunes dans les chaînes de valeur agricoles en Afrique centrale (PREJAC). Laquelle mission vient en appui à la CEEAC, et dont la FAO est partie prenante avec la mise à disposition de la Facilité de coopération technique (TCP-Facility).
Ces organismes justifient le développement de cette approche par le fait que, les chaînes de valeur agricoles sont des maillons essentiels du développement économique et offrent de grandes possibilités pour les jeunes dans la sous-région.
Aussi, ajoutent-ils, « exploiter les opportunités offertes par l’entrepreneuriat et les innovations de l'agro-industrie, tout au long des chaînes de valeur, devrait contribuer à améliorer l'image du secteur, augmenter la productivité et les bénéfices produits par les investissements et offrir de nouvelles possibilités d'emploi et par là-même attirer davantage des jeunes ».
Au cours de ces échanges, les différentes parties se sont accordées à mettre en place une plateforme de collaboration avec les différents autres partenaires associés à la formulation du projet en particulier ceux du système des Nations Unies (UNESCO, BIT). Cela, afin de pouvoir créer des synergies pour mieux adresser le sujet de l’employabilité des jeunes dans les chaînes de valeur agricoles.
Stéphane Billé
Le groupe indien Rashtriya Chemicals and Fertilisers, en association avec Olam, veut investir dans le gaz
Les représentants de la société publique indienne, Rashtriya Chemicals and Fertilisers, ont eu un entretien avec le Premier ministre, Emmanuel Issoze Ngondet, dans son cabinet en compagnie du ministre du Pétrole et des Hydrocarbures, Pascal Houangni Ambourouet, sur l’exploitation du gaz.
Le groupe industriel indien souhaite investir dans le domaine gazier, notamment en compagnie de la filiale locale de la multinationale singapourienne Olam (Olam Gabon) dans le développement de la pétrochimie et de la production d'engrais dans le pays.
Le Premier ministre a rassuré les investisseurs indiens du soutien total des autorités gabonaises dans ce projet qui revêt un caractère stratégique. Aussi permettra-t-il, par ailleurs, de l’avis du chef du gouvernement, de pérenniser l'activité pétrolière dans notre pays.
PcA
La société sucrière SUCAF Gabon, filiale du groupe SOMDIAA, signe un partenariat avec le géant local de la vente des surgelés SAN Gel
Les Sucreries africaines-Gabon (SUCAF), filiale locale de la multinationale sucrière française SOMDIAA, et la Société alimentaire de la Nomba (SAN Gel), géant local de la distribution des produits congelés et surgelés, ont signé à Libreville une convention de partenariat, apprend-on dans la presse locale.
Par cet accord, SAN Gel ouvre les rayons de ses cinq enseignes basées à Libreville aux produits de la compagnie sucrière.
Pour Benoît Simon, directeur général de SUCAF, ce partenariat contribue à apporter une meilleure visibilité aux produits de la société d’une part, et une opportunité idéale pour la promotion de ceux-ci sur l’étendue du territoire.
Au cours de l’année 2017, la compagnie a réalisé une production de 24 376 tonnes de granulés de sucre de 50 kg et transformé plus de 19 000 tonnes de sucre. Les chiffres affichent ainsi une hausse du fait de la baisse des importations de sucre bien que le chiffre d’affaires ait été en repli de 5,5%, à 19,2 milliards FCFA.
PcA
Selon la Cour des comptes, le Gabon enregistre un taux d’endettement de 64% du PIB
Mis à l’index comme faisant partie des insuffisances et irrégularités liées à l’exécution du budget de l’Etat en mode Budget par objectif de programme, l’endettement du Gabon constitue une réelle épine pour la stabilité économique, selon la Cour des comptes.
Ainsi, l’encours de la dette du Gabon s’élève par exemple en 2016, à 4 093 milliards FCFA. Celle-ci se compose de 3 107 milliards FCFA au titre de la dette extérieure, et de 986,06 milliards FCFA pour la dette intérieure. Ce qui représente un taux de 49,25% du PIB.
Mais, poursuit le rapport de la Cour au président de la République, « en intégrant les avances statutaires de la BEAC au Trésor public, les remboursements de TVA, les instances du Trésor, les obligations assimilables du Trésor ainsi que les bons du Trésor, ce taux atteint 64% du PIB ».
Ceux-ci sont largement au-dessus du seuil d’endettement de 34% du PIB fixé par la stratégie d’endettement du gouvernement et se rapprochent davantage du seuil communautaire fixé à 70% du PIB.
PcA
Une réunion bipartite entre le gouvernement et le patronat en vue
La situation des entreprises gabonaises suscite une vive préoccupation. Cette crainte s’est une fois de plus manifestée, ce 28 novembre 2018, au cours d’une rencontre entre le Premier ministre, Emmanuel Issoze Ngondet, et les responsables du patronat.
Au cours de cette audience, le président de la Confédération patronale gabonaise (CPG), Alain Bâ Oumar (photo, gauche), et son vice-président chargé de l’entrepreneuriat national, Alain-Claude Kouakoua, ont exposé leurs préoccupations au chef du gouvernement.
La dette intérieure de l'Etat, la situation financière de la CNAMGS, les initiatives engagées avec l'appui de la Banque mondiale en vue du renforcement des capacités des opérateurs économiques ont ainsi constitué la trame de leurs soucis.
Au terme de ces échanges, Emmanuel Issoze Ngondet a pris l'engagement de convoquer une réunion bipartite entre le gouvernement et le bureau de la CPG afin d'examiner toutes ces questions.
Stéphane Billé
La France consolide ses positions dans les secteurs de la distribution, des activités financières et des TIC en Afrique centrale
Malgré un net recul des Investissements directs étrangers (IDE) de la France en Afrique centrale, les entreprises françaises consolident leurs positions dans la distribution, les activités financières et les TIC.
Selon la Direction générale du Trésor, en dehors du secteur extractif, les IDE français en Afrique centrale se concentrent majoritairement dans les secteurs du commerce avec 461 millions d’euros en 2017 ; de la banque et des assurances avec 422,3 millions d’euros, et de l’information et de la communication pour 259,7 millions d’euros.
L’institution financière française souligne également que les positions des entreprises françaises se sont nettement améliorées en 2017 (+15,3 %), mais plafonnent depuis le début des années 2010, oscillant entre 1,5 milliard d’euros et 21,5 milliards d’euros sans jamais parvenir à dépasser ce seuil de manière significative.
Sur cette période, le stock d’IDE français a surtout varié en fonction de l’évolution de l’activité des banques (Société générale, BPCE) et des compagnies d’assurance (AXA, Gras Savoye). Le secteur avait été marqué en 2011 par la vente par le Crédit Agricole, de ses parts (51 %) dans la banque SCB Cameroun au profit du groupe marocain, Attijariwafa Bank. Le groupe BPCE a également annoncé début 2018, son intention de se séparer de la BICEC, sa filiale camerounaise.
Pour autant, les IDE dans le secteur du commerce ont renoué avec la croissance en 2017 (+8,9 %) après quatre années de baisse quasi continue. On peut s’attendre à une poursuite de cette tendance à moyen terme compte tenu de l’offensive lancée par les groupes français sur le continent, et notamment du partenariat signé en 2013 entre les groupes CFAO et Carrefour dont le plan de développement, ambitionne de positionner la coentreprise dans huit pays d’Afrique dont le Cameroun, le Congo, le Gabon et la RDC. Rien qu’au Cameroun, CFAO/Carrefour devrait installer deux centres commerciaux et quatre supermarchés et compte investir 88 millions d’euros dans les années à venir.
Les investissements français dans le secteur de l’information et de la communication ont quasiment été multipliés par dix entre 2010 et 2017, passant de 27 millions à 260 millions d’euros. Bien implanté au Cameroun et en RDC, Orange a réalisé des investissements conséquents afin de développer les réseaux mobiles et Internet. En RDC, le groupe français s’était implanté en 2012 en rachetant les activités de Congo Chine Télécoms et avait consolidé sa position en 2016, grâce à l’acquisition de Tigo, filiale du groupe Millicom.
Les IDE dans les autres principaux secteurs sont tous orientés à la baisse. On observe notamment un repli de 27,3 % sur un an dans l’industrie manufacturière, probablement lié au projet de Total de se défaire de son parc de raffineries en Afrique centrale : en octobre 2016, le groupe avait vendu pour un franc symbolique, ses parts (44 %) dans la Société gabonaise de raffinage (SOGARA) et il projette de se désengager au Cameroun de la Société nationale de raffinage (SONARA) dont il détient 19,7 % des parts.
Stéphane Billé
L’OIAC adopte la « Déclaration de Libreville » pour relancer le café
Réunie du 20 au 27 novembre 2018 à Libreville, dans le cadre de ses Assemblées annuelles, l’Organisation interafricaine du café (OIAC) vient d’adopter d’importantes recommandations pour booster la filière café, à travers une feuille de route baptisée « Déclaration de Libreville ».
Cette déclaration qui se résume en quatre mesures est destinée non seulement à la communauté internationale, mais aussi aux Etats membres ainsi qu’au secrétariat général de l’OIAC.
Dans un premier temps, il s’agit d’une invitation à la communauté internationale à participer à la recherche de solutions, face à la baisse continue des prix et à l’impact du changement climatique sur la production de café. Cela, en vue de contribuer à améliorer les moyens de subsistance des producteurs de café.
La deuxième mesure qui va à l’endroit des Etats membres consiste à créer un environnement propice à des chaines de valeur efficaces, à la création de la valeur ajoutée et à la consommation intérieure, en tant que mesures d’atténuation de la volatilité des prix.
Il s’agira également de soutenir et promouvoir le commerce régional et continental du café, sous les auspices de la zone de libre-échange continentale afin de stabiliser les prix et de réduire les risques potentiels découlant de la baisse des prix internationaux pour les producteurs africains de café.
Les Etats membres sont enfin appelés à fournir un cadre continental pour l’intégration et la collaboration dans la recherche sur l’impact du changement climatique sur la production et la productivité du café.
En dernier ressort, l’OIAC a exhorté le Secrétariat général à mettre en place un mécanisme efficace de suivi et d’évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre de cette déclaration de Libreville.
Stéphane Billé
Les dépenses de personnel de l’Etat ont atteint 525,1 milliards FCFA au troisième trimestre 2018
Dans son troisième rapport trimestriel d’exécution budgétaire de l’année 2018, le ministère du Budget et des Comptes publics indique que les règlements au titre des dépenses de personnel ont atteint 525,1 milliards de francs CFA. Soit 82% du taux d’exécution, au regard de la prévision de 640,8 milliards de francs CFA pour l’année.
Ce rapport souligne, par ailleurs, que la solde permanente a représenté 484,5 milliards FCFA, soit 92% du poids de l’ensemble. Les autres éléments de rémunération, notamment la main-d’œuvre non permanente (MONP), les capitaux décès, les services rendus et autres indemnités servies aux agents publics, les vacations des enseignants et autres primes se sont élevés à 40,6 milliards FCFA, soit 95% de la prévision.
Par ailleurs, l’on a enregistré une baisse de 1 543 agents publics, passant de 105 667, à fin septembre 2017, à 104 124 à la même période en 2018, poursuit ledit rapport.
Il convient néanmoins de noter que ces tendances ne prennent pas en compte l’effet des mesures d’ajustement dont la mise en œuvre n’a démarré qu’au début du second semestre.
Stéphane Billé