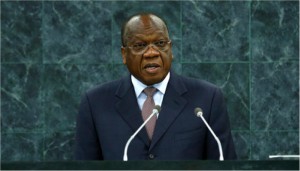Le Nouveau Gabon
Le rapport d’exécution budgétaire du premier trimestre 2017, désormais disponible
Dans le cadre du principe de bonne gouvernance et de performances budgétaires en matière de finances publiques, le ministère du Budget et des Comptes publics vient de publier le rapport d’exécution budgétaire du premier trimestre 2017.
Selon ledit rapport, le solde général d’exécution au 31 mars 2017 s’établit à 115,1 milliards de francs CFA, soit un niveau inférieur par rapport au solde d’exécution à la même période de l’année précédente (134,6 milliards de francs CFA). Dans ce cadre, la prise en compte du solde déficitaire des opérations de trésorerie et de financement (-44,3 milliards de francs CFA) a amené à un solde net global de 70,8 milliards de francs CFA.
Le ministère du Budget et des Comptes publics précise toutefois que « ce calcul ne prend pas en compte le niveau des recettes affectées du premier trimestre de près de 40,3 milliards de francs CFA. L’intégration de ces recettes, qui représentent une dépense de trésorerie, devant être reversées aux correspondants du Trésor, devrait ramener le solde net global à près de 30 milliards de francs CFA ».
A ce stade de l’année, l’excédent constaté s’explique par un effet calendaire. « Les recettes sont encaissées dès le début de l’année, alors que les paiements ne sont en général constatés que plus tardivement, en raison notamment d’un retard dans la mise en place de la chaîne managériale d’exécution des dépenses. Ce solde n’est donc pas une donnée significative », indique le rapport.
Dépenses
A fin mars, les dépenses effectivement payées ont atteint 247,9 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution de 14% par rapport à la Loi de finances (LF), supérieur à celui observé au 31 mars 2016 (10%). Toutefois, à ce stade de l’année, l’évolution des dépenses est peu significative et soumise à des effets calendaires importants.
Recettes
Les recettes (brutes) du budget général s’établissent à près de 363 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution de 20%, supérieur à celui observé l’an dernier, à la même période (17%). Le niveau d’encaissement des recettes du budget général est en revanche sensiblement inférieur aux prévisions trimestrielles sous-jacentes à la Loi de finances avec 80% de réalisation sur la prévision trimestrielle.
Selon le ministère du Budget, « Cette moins-value résulte de deux effets de sens contraires : d’une part, une sous-exécution des recettes fiscales par rapport à la prévision du trimestre considéré, du fait d’une reprise plus tardive que prévu de la croissance économique. D’autre part, une plus-value significative sur le rendement des recettes pétrolières sous l’effet de la remontée des prix ».
Comptes spéciaux
Quant au solde des comptes spéciaux, il est négatif (avec -9,3 milliards de francs CFA), tandis que les dépenses du compte d’affectation spéciale (CAS) « Promotion du sport » ont été significatives à cette période sus-citée, en raison de l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations, au mois de janvier 2017.
Pour rappel, le rapport trimestriel de l’exécution budgétaire est fondé sur les principes de redevabilité et de transparence du gouvernement. Avec pour objectif premier, d’informer le Parlement et le public, ce rapport trimestriel vise à la fois à porter une appréciation sur la qualité de l’exécution au regard, non seulement de la Loi de finances votée, mais aussi des normes budgétaires et comptables en vigueur.
Stéphane Billé
François Louncény Fall présente le quatorzième rapport du SG des Nations Unies, sur la situation en Afrique centrale
Le 14e rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur la situation en Afrique centrale et sur les activités de l'UNOCA sera présenté ce 13 juin 2018 au Conseil de sécurité par François Louncény Fall, représentant spécial et chef du Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA).
Ce document de 20 pages rend compte des faits majeurs survenus sur les plans politique et sécuritaire en Afrique centrale durant les six derniers mois. Par ailleurs, l’évolution de la situation humanitaire est aussi passée en revue, ainsi que celle relative aux droits de l’homme.
En outre, ledit rapport met en relief les activités menées par le Bureau dans le cadre de son mandat, y compris celles mises en œuvre avec la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), son principal partenaire dans la sous-région.
Au-delà des efforts déployés en matière de prévention et de soutien à la lutte contre les menaces terroristes et les groupes armés (Boko Haram ; Armée de résistance du seigneur/LRA, etc.), un accent est également mis sur les bons offices et des actions de diplomatie préventive.
Stéphane Billé
Compétition nationale 2018 JA Gabon : le Cours secondaire Ambourouet décroche la timbale
Les lampions se sont éteints sur la 5ème édition de la finale de la compétition nationale des « Mini-entreprises », le 9 juin dernier.Pour cette édition qui mettait aux prises, 19 projets, il était question d’en choisir les trois meilleurs, et c’est le Cours secondaire Ambourouet qui a enlevé la timbale.
Selon le jury, qui a visiblement eu du mal à départager les finalistes, «les projets étaient excellents. L’on a dû se pencher sur les notes d'écriture de leurs rapports, du speech, puis de la présentation des stands. Les trois premiers sont ceux qui ont obtenu les meilleures notes en combinant ces trois éléments.», a précisé Nathalie Bingangoye, la présidente.
En clair, les trois premiers ont été primés pour l’originalité et la pertinence de leurs projets qu’ils ont défendu devant un jury de professionnels.
Le premier prix de cette édition 2018, d’une valeur d’un million de francs CFA offert par Citibank, est ainsi revenu au Cours Secondaire Ambourouet, pour son projet JERI entreprise. Ce projet consiste en la fabrication des pare-soleils pour automobiles, à base de cartons recyclés et de pagne africain.
Pour la deuxième fois consécutive, le lycée Mabignath est arrivé sur la deuxième marche du podium avec la « Mini-entreprise de Bracelets » qui comme son nom l'indique, fait dans la fabrication de bracelets à base de bidons recyclés. Les lauréats ont reçu un bon d’achat de fournitures scolaires d'une valeur de 500 000 francs CFA offert par AXA Gabon.
Le troisième prix est enfin également revenu à la seconde mini-entreprise du Cours Secondaire Ambourouet « Innovative saun », qui fabrique des tables basses à base de pneus recyclés. Les heureux élus ont eu droit à cinq boxes wi-fi, offertes par Airtel Gabon et un lot de tee-shirts de la marque « Empreinte Bantu » offerts par Yannick Obame, créateur de la marque et ancien mini-entrepreneur du Lycée Mabignath.
La cérémonie a été rehaussée par la présence de la ministre en charge de l'Industrie et de l’Entrepreneuriat national, Carmen Ndaot, venue encourager la jeunesse gabonaise à se lancer dans l’entrepreneuriat.
A ses côtés, la ministre déléguée auprès du ministre des Eaux et Forêts chargé de l'environnement et du développement durable, Léa Mikala, ainsi que le Coordonnateur général du BCPSGE, Liban Soleman et la secrétaire générale du ministère des PME.
Stéphane Billé
Eximbank China et le gouvernement examinent les projets prioritaires
Le vice-président du groupe bancaire public d’import-export chinois Eximbank, Sun Ping, a longuement échangé, le 11 juin 2018, avec le Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondet, à Libreville.
En fait, la banque chinoise entend renforcer son partenariat avec le gouvernement, à travers le financement de projets prioritaires et l’examen de nouveaux projets de développement qui nécessitent d’importants moyens financiers.
Si le vice-président d'Eximbank apprécie la qualité de la coopération avec le Gabon qu’il juge très « fructueuse », il reste que, pour lui, il faut renforcer le partenariat stratégique qui existe entre Pékin et Libreville.
Pour le groupe bancaire chinois, les priorités se portent sur la construction des routes nationales ainsi que la réalisation et le financement de trois nouveaux centres de formation professionnelle, à Libreville, au sein de la zone économique spéciale de Nkok.
« Eximbank accompagne le gouvernement depuis plusieurs années dans la mise en œuvre et la transformation économique du Gabon », assure le ministre de l’Economie Jean-Marie Ogandaga.
Le Premier ministre indique que les « appuis multiformes » de la Chine constituent un soutien de poids pour le pays, à un moment où le gouvernement est engagé dans la matérialisation du plan de relance économique qui vise un retour de la croissance.
PcA
Le Gabon a reçu 974 milliards FCFA de ses partenaires financiers, en 2017
Contrairement à l’exercice 2016 où les décaissements sur financements extérieurs ont été faibles, le Gabon a réussi à mobiliser des tirages de l’ordre de 974 milliards FCFA contre 394 milliards FCFA, un an plus tôt.
Avec près de 80% des montants décaissés pour le pays au cours de l’année 2017, les financements extérieurs observent cette évolution du fait de la progression des montants des bailleurs de fonds. Ceux-ci ont atteint plus de 95% des tirages globaux.
La forte progression des tirages multilatéraux s’explique, suivant le ministère de l’Economie, essentiellement par les tirages effectués auprès de la Banque mondiale à travers le guichet de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), de la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (BDEAC) et le Fonds d’investissement et de développement agricole (FIDA).
Les projets bénéficiaires de ces fonds sont la construction de la Dorsale de télécommunications, le programme de promotion de l’investissement et de la compétitivité, la phase II du programme de développement des infrastructures locales, l’accès aux services de base en milieu rural, le développement du système des statistiques du Gabon, le projet E-Gabon, l’appui à l’employabilité des jeunes, l’aménagement de la route PK5-PK12 sur financement de la BDEAC.
Les stades d’Oyem et de Port-Gentil ont bénéficié des financements de la Commercial bank of China tandis que l’Agence française de développement a mobilisé des ressources pour l’agriculture avec le projet de développement agricole, l’assainissement de la ville de Port-Gentil et du bassin versant de Gué Gué ou encore la réhabilitation du Transgabonais.
Grâce aux banques locales, au marché financier de la BEAC et de la BVMAC, le pays a pu tirer, sur le plan domestique, près de 197 milliards FCFA.
PcA
Le Gabon à la recherche d’un label industriel
La ministre de l’Industrie et de l’Entrepreneuriat national, Carmen Ndaot (photo), a annoncé ce 11 juin à Libreville que le Gabon, malgré le début des opérations d’importations d’huile de palme par la filiale locale de la multinationale agroalimentaire, Olam Palm Gabon, le pays, du fait de certaines lenteurs et pesanteurs, était encore à la recherche d’un label industriel propre.
Une situation qui ne favorise pas l’essor de la filière agroalimentaire pourtant pourvoyeuse d’emplois, à travers les plantations du groupe Olam à Awala près de Kango à 80 kilomètres de Libreville, Mouila dans le sud du pays et Lambaréné dans le centre du pays.
« L’industrie agroalimentaire ne peut pas pour le moment être évoquée au Gabon […]; le Gabon n’a pas encore de label, mais les services du ministère travaillent dans ce sens, notamment la direction générale de l’industrie, l’Agence gabonaise des normes, l’organisation gabonaise de la propriété intellectuelle pour avoir un label gabonais. Pour l’instant, le gouvernement fait dans la promotion », indique la ministre.
D’après elle, l’impact de l’industrie dans l’économie nationale est aujourd’hui perceptible si l’on en juge par les performances réalisées par les unités de transformation du bois dans la zone économique spéciale de Nkok où une soixantaine d’usines produisent et exportent du bois, le complexe métallurgique de Moanda, les usines de production d’huile de palme de Mouila et Kango.
« Il est déjà important de mettre une norme à nos produits », souligne-t-elle. Cela devrait permettre de générer davantage de croissance du PIB, multiplier le volume des exportations en quantité et en qualité et assurer plus de création d’emplois.
PcA
La ZERP de Nkok a produit 114 480 m3 de feuilles de placage et 286 697m3 de bois plaqués en 2017
Entre 2016 et 2017, la production gabonaise de feuilles de placage s’est accrue de 13,7% pour s’établir à 286 697 m3. C’est ce que révèle le rapport sur l’impact économique des activités de la société Olam au Gabon, réalisé par l’économiste, May Mouissi.
Ce rapport indique que la Zone économique à régime privilégié de Nkok a produit à elle seule, près de 114 480 m3 de feuilles de placage en 2017. En outre, poursuit ledit rapport, ces performances sont appelées à connaitre une tendance haussière avec la fréquence des approvisionnements en grumes, mais également avec l’installation de nouvelles usines.
Dans le même temps, la production nationale de bois plaqués est ainsi passée de 196 804 m3 en 2010 à 286 697 m3 en 2017, soit une hausse de 46%. Quant à la production de feuilles de placage de la Zone économique à régime privilégié de Nkok, elle représente environ 40 % de la production nationale.
Sur le plan financier, le chiffre d’affaires du segment placage s’est accru de 48% entre 2013 et 2016. Il est ainsi passé de 33 milliards FCFA, à 49 milliards FCFA en 2016. Cette hausse illustre la tendance observée sur ce segment au cours des cinq dernières années. Dans cette dynamique, la valeur ajoutée du secteur est passée de 8 milliards FCFA à 12 milliards FCFA entre 2014 et 2016 (+50%).
A pleine capacité, les unités de placage installées dans la ZES pourraient produire 189 380 m3 et monter à 66% de la production nationale actuelle. Laquelle devrait également s’accroître avec l’entrée en production de nouvelles usines actuellement en construction dans la Zone économique à régime privilégié de Nkok.
La production de bois plaqués dans la ZES pourrait alors s’établir à 366 980 m3.
Stéphane Billé
Le Gabon s’active à améliorer son rang dans le classement ‘’Doing Business’’
La position du Gabon dans le classement ‘’Doing Business’’ constitue une véritable préoccupation pour les autorités. En vue d’améliorer ce classement qui a subi une régression l’année dernière, le 7 juin 2018, la ministre de la Promotion des investissements et des Partenariats public-privé, Madeleine Berre (photo), a présidé une séance de travail portant sur le plan d'action et les réformes sur le ‘’Doing Business 2019’’.
Cette réunion, qualifiée de constructive, à laquelle prenaient également part, Liban Soleman et Nina Alida Abouna, respectivement PCA et Directeur général de l'Agence nationale de promotion des investissements (ANPI), a été élargie aux notaires, avocats et conseils juridiques. Elle a ainsi permis à Madeleine Berre d’évaluer les forces et les faiblesses de l'ANPI, vitrine de l'investissement au Gabon.
Pour rappel, dans le classement ‘’Doing Business 2018’’, le Gabon est arrivé à la 167ème position sur les 190 pays évalués. Afin de rectifier le tir, le 15 janvier 2018, le pays a ouvert un guichet de l’investissement au sein de l’ANPI. Cet outil qui vise à simplifier ainsi qu’à booster les investissements au Gabon, concentre toutes les étapes nécessaires à la création d’une entreprise en un seul lieu.
Cela, dans le but de réduire significativement le parcours de l’investisseur dans le processus de création d’entreprise. Cette institution abrite 30 administrations délivrant des agréments et des autorisations d'exercices dans les activités relevant des codes spécifiques.
Stéphane Billé
Le chiffre d’affaires de la Sogara en chute de près de 40 milliards FCFA, sur un an
Au cours de l’exercice 2017, les performances réalisées par les exportations de kérosène ont permis au chiffre d’affaires à l’export de la société gabonaise de raffinage (Sogara) de s’apprécier de 21,3% à 92,4 milliards FCFA.
Mais, malgré cette bonne tenue, sur le plan commercial, les ventes de tous les produits pétroliers raffinés sur les marchés domestiques et extérieurs ont fortement régressé durant toute l’année. Ce qui a induit une baisse du chiffre d’affaires de la société de 15% à 220 milliards FCFA.
Quant à la production, le volume de bruts traités a fortement diminué, en raison de l’arrêt de fonctionnement de l’usine dans le cadre de son entretien quinquennal qui dure un mois. « Ainsi, ce volume a régressé de 20,7% pour s’établir à 812 611 tonnes métriques contre 1 025 010 tonnes en 2016 », rapporte le ministère de l’Economie.
La baisse de production a entraîné une augmentation des importations des produits pétroliers (gasoil, butane, essence et kérosène) pour un volume de 254 432 tonnes métriques contre 178 696 tonnes en 2016, soit une augmentation de 42,4%.
PcA
Le Gabon veut conclure un accord de coopération agricole avec le Bénin pour la culture du riz
Le ministre gabonais de l’Agriculture, Biendi Maganga Mousssavou, a effectué une visite de travail dans la région de Covè au Bénin, à l’invitation de son collègue Cossi Gaston Dossouhoui.
Pendant son séjour, il a visité une exploitation rizicole de 250 ha, animée par 12 coopératives constituées de 203 agriculteurs. Avec un rendement de 6 tonnes à l'hectare pour deux récoltes annuelles, la production irriguée de cette exploitation culmine à 3 000 tonnes par an.
«Le Bénin produit près de 300 000 t de riz padi par an avec un encadrement scientifique et technique issu de ses lycées et écoles agricoles et l'appui des chercheurs du cru; le tout renforcé par Africa Rice, initiative CARD.», indique le ministre gabonais de l’Agriculture.
D’après lui, il y a deux ans que des démarches ont été initiées pour l’admission du Gabon dans le projet « Coalition pour le développement de la riziculture en Afrique » plus connue sous le nom d’initiative CARD.
Proposée par l’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA) et l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), cette initiative vise à faire face à l’importante croissance de la production rizicole en Afrique et à servir de cadre international en vue d’appuyer l’effort personnel des pays africains à accroître la production de riz.
Dans son déploiement, elle s’appuie sur les structures existantes, les politiques et les programmes tels que le Centre du riz pour l’Afrique (ADRAO), le Programme global africain pour le développement de l’agriculture (CAADP) et l’Initiative africaine sur le riz (ARI).
«Dans tous les cas, la redéfinition de nos axes de coopération, notamment sud-sud, par un accord de coopération agricole, permettrait de tirer profit des enseignements de ce pays frère.», conclut Biendi Maganga Moussavou.
PcA