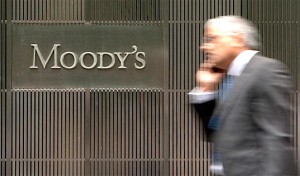Le Nouveau Gabon
Des ONG gabonaises appellent l’Etat à combattre l’enrichissement illicite
En inscrivant la gouvernance au cœur des actions prioritaires à développer sur la période 2018-2022, les Nations unies envisagent de donner plus de visibilité, de traçabilité et de relief à la dépense publique et à l’amélioration des conditions de vie des populations.
C’est dans cette optique que les ONG gabonaises, dans un souci de transparence et d’équité, ont appelé l’Etat à accentuer l’éradication du phénomène d’enrichissement illicite qui fausse les objectifs de développement, trahit la lutte contre la pauvreté, non sans gangréner la société gabonaise. «Il faut remettre rapidement la loi sur la question de l’enrichissement illicite ; nous avons vu qu’il y a des faiblesses au niveau de la commission nationale de l’enrichissement illicite», confie Nicaise Moulombi (photo), président de l’ONG gabonaise Croissance saine environnement.
D’après lui, tout le système financier et comptable de l’administration doit être remis en cause ; car, pour ce qui concerne, par exemple, le financement des projets par les institutions internationales et les partenaires financiers, tout doit être mis en œuvre pour plus d’impact au niveau des populations. «La société civile veut s’assurer que si le Gabon a un nouveau programme avec nos partenaires que sont les Nations unies, nous avons effectivement mener la politique de nos moyens, de telle sorte que nous puissions mettre en œuvre tout ce qui va être décidé», rappelle-t-il.
Si les premières arrestations opérées depuis quelques jours arrivent un peu tard, celles-ci, indique Nicaise Moulombi, sont le fait de dénonciations du public, alors que le Parlement aurait dû se saisir de ces affaires et mettre la pression sur le gouvernement, afin d’interpeller les concernés et les soumettre au devoir de reddition.
«Les premières arrestations qui sont faites concernent les proches collaborateurs du président de la République alors qu’il y a le Parlement qui est payé à ne rien faire. Pareil pour la commission d’enrichissement illicite. Avec ces arrestations, nous avons tout le système financier et comptable qui est remis en cause», tranche-t-il.
Auxence Mengue
Le Gabon et la République du Congo pourraient solliciter une aide du FMI en 2017, selon une analyste de Moody's
Le Gabon et le Congo, deux pays membres de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, pourraient solliciter un appui du Fonds Monétaire International en 2017, a fait savoir Lucie Villa, une des vices présidente et analyste des situations pays au sein de l'Agence de Notation américaine Moody's. Ils « font face à des pressions de liquidité, et ne sont pas encore sous un programme avec le FMI », a fait savoir Mme Villa, selon des propos rapportés par Bloomberg.
L'analyste explique que ces deux pays, comme le Mozambique et la Zambie, font face à de sérieux défis de liquidité. Au Gabon et au Congo, la principale source des revenus reste encore le pétrole, et la baisse des prix de cette matière première accentue la pression sur des recettes publiques. Or leurs gouvernements doivent financer des plans d'émergence, les dettes déjà existantes et un déficit public croissant, ajouté à la gestion financière des crises sociales latentes, à la suite des difficiles élections qu’ils ont connues en 2016.
Les pressions de liquidités se sont faites principalement sentir sur le Congo. Ses réserves de recettes fiscales [déposées à la BEAC (Banque Centrale de la CEMAC) et en dollars US dans des banques en Chine] qui étaient de 34% du PIB en 2014, n’en représentaient plus que 23% à la fin 2015. Dans sa note d'analyse souveraine d'octobre 2016 sur le pays, Moody's indiquait que cela devrait encore descendre entre 2016 et 2017.
Au Gabon, le plan de diversification de l'économie mis en place par le président Ali Bongo, tarde encore à porter des fruits et des perspectives encore incertaines sur les prix du pétrole, font penser que le pays sera contraint une fois de plus comme en 2015, de puiser dans ses réserves fiscales (logées à la BEAC). Cela devrait aider à supporter les coûts d'organisation de la Coupe d’Afrique des Nations qui s'y déroule en ce moment, et aussi de reconstruire la cohésion et les infrastructures sociales, après des élections qui ont divisé le pays l'an dernier.
Au terme d'une rencontre qui s'est tenue à Yaoundé (Cameroun) à la fin 2016, il avait été recommandé aux pays de la CEMAC d'entreprendre des discussions avec le FMI, afin d'obtenir une assistance financière et aborder la question de la mise mise en œuvre des plan d'ajustement de leurs économies. Une recommandation qui est arrivée alors que le Tchad était (et est toujours) sur un programme avec l'institution basée à Washington, sans grand succès.
La conférence de Yaoundé a aussi recommandé que soit développé le marché des capitaux, afin de soutenir les stratégies de développement des pays. Mais l'épargne dans la sous-région reste assez faible, comparée à ses besoins financiers. Par ailleurs, en raison d'une régulation stricte du secteur bancaire, les banques sont sous pression et pourraient ne pas réussir à satisfaire les besoins des financements des Etats.
Idriss Linge
L’ANPN répond aux ONG Mighty et Brainforest
Le 12 décembre 2016, l’organisation américaine à but non lucratif Mighty, publiait un rapport intitulé «La boite noire du commerce de l’huile de palme» : Ou comment l’émergence du géant de l’agrobusiness Olam, parmi les acteurs majeurs du commerce de l’huile de palme, « menace l’avenir des forêts d’Asie du Sud-Est et du Gabon. »
Pour l’Agence nationale des Parcs nationaux (ANPN) que dirige le professeur Lee White, ce «rapport (…) est une critique particulièrement fallacieuse et injuste du développement de l’agriculture durable au Gabon».
«Le ton de ce rapport partial insinue que le Gabon est en train de détruire intentionnellement ses forêts. Mighty méconnaît la situation exceptionnelle du Gabon – une nation qui a la couverture forestière par habitant la plus importante (avec une forêt couvrant 88 % du pays) et l’un des taux de déforestation les plus bas de la planète», souligne l’ANPN dans sa réponse à l’ONG américaine.
Aussi l’Agence situe-t-elle le contexte du développement des plantations de palmier à huile au Gabon qui, selon elle, découle de la volonté des autorités, à sortir de la dépendance alimentaire de l’extérieur.
«Le choix des plantations de palmier à huile a été une décision stratégique pour le gouvernement. Les plantations extensives de palmiers à huile ont à un moment fait partie de l’histoire du Gabon – dans des zones maintenant occupées par la forêt tropicale », relève l’Agence.
Plus loin, l’Agence donne à voir sur le rapport du Gabon aux forêts. Car, rappelle l’ANPN, «tandis que tous les pays développés ont perdu la majorité de leurs forêts au cours de leur essor économique, le Gabon s’engage à établir un nouveau modèle de développement durable qui préservera les forêts».
S’agissant de l’Approche Haut Stock de Carbone (HCSA), l’ANPN démontre en quoi celle-ci ne correspond pas aux besoins du Gabon. Car, « le guide de l’HCSA de 2015 ne traite pas des pays qui ont une superficie forestière importante, comme le Gabon, et le guide de nouvelle « convergence » n’a pas été publié ; nous croyons qu’elle ne concerne pas les cas comme le Gabon et qu’elle n’a pas été testée. Par conséquent, nous pensons que cette insistance sur la HCSA n’est pas justifiée».
Auxence Mengue
Le groupe américain Carlyle rachète les actifs de Shell Gabon SA
C’est finalement le géant américain du capital-investissement Carlyle qui va reprendre les actifs terrestres de Shell Gabon, après un long feuilleton riche en suspense, avec le groupe français Pérenco, présent au Gabon depuis 1960, l'année de l'indépendance.
La vente ne porterait que sur les activités on-shore de Shell-Gabon SA qui exploite cinq champs dans la région de Port-Gentil, la capitale économique et pétrolière du pays.
Selon la presse locale, ce contrat serait signé de manière imminente, a indiqué à un porte-parole de la filiale gabonaise du groupe pétrolier anglo-néerlandais Shell.
Le montant de la revente de champs pétroliers est compris entre 600 millions et un milliard de dollars. Un accord officiel de vente des actifs de Shell Gabon devrait être signé au courant de ce mois de janvier avec Carlyle.
Cette transaction suscite des inquiétudes de la part de ses 400 anciens salariés qui ont menacé lundi de durcir une grève lancée le 12 janvier, jusqu'à l'arrêt total de la production.
Synclair Owona
L’ouverture du CHU Jeanne Ebori de Libreville préoccupe le gouvernement
L’examen des conditions de mise en service définitive du Centre hospitalier universitaire Fondation Jeanne Ebori, était au centre d’une rencontre tenue dans cette infrastructure sanitaire le 16 janvier 2017, entre le chef du gouvernement et certains ministres de son cabinet.
Entre autres points de préoccupation, les conditions organisationnelles liées à l’ouverture au public de cet établissement de santé et les modalités de déploiement d’un nouveau système managérial. Celles-ci ont été soumises à l’étude des membres du gouvernement présents à cette rencontre. Aussi le Premier ministre recommande-t-il de multiplier les efforts «pour répondre aux nombreuses attentes des populations». Une exhortation qui s’accompagne de la promesse d’«apporter progressivement des réponses aux problèmes liés aux contraintes structurelles et techniques» de cet hôpital.
Comme mesures adoptées, il y a au plan organisationnel, la publication des listes de personnels administratif, médical, paramédical et technique affectés dans cette formation hospitalière de haut niveau dans les jours à venir. Cette opération vise à outiller les nouveaux personnels à l’utilisation et à l’appropriation des nouveaux équipements et matériels. D’autre part, le niveau du plateau technique ainsi que les équipements technologiques utilisés dans cette structure sanitaire de référence, nécessitent une formation préalable des personnels soignants.
Pour faciliter le fonctionnement et la prise en charge salariale des équipes de soignants, le ministère du Budget et des Comptes publics devra, dans un délai de trois mois, inscrire cet établissement public dans la loi des finances en cours d’exécution. Ce qui permettra de résoudre les contraintes liées à l’intendance.
Inscrite dans la liste des engagements prioritaires pris par le gouvernement dans la feuille de route des 100 jours, l’ouverture du CHU Fondation Jeanne Ebori, construit sur une superficie de 1,5 ha, pour plus de 276 lits, commence à préoccuper. La structure dispose d’une pharmacie, des salles de formation, des urgences, trois blocs opératoires, une salle de réveil, une buanderie, des salles d’accouchement, des services techniques et de maintenance, une maternité d’une capacité de 50 lits.
Auxence Mengue
L’African Music Institute de Libreville lance ses activités
L’African Music Institute, école supérieure dédiée à l’apprentissage de la musique, a lancé ses premiers ateliers du 9 au 13 janvier 2017 à l’Ecole Ruban Vert de Libreville.
Organisée en partenariat avec le Berklee College of Music de Boston, la première université d'éducation musicale contemporaine a été dirigée par le directeur académique du corps professoral de l’établissement américain, Alain Mallet.
Pendant les ateliers qui ont touché une variété de sujets à l’instar de l'harmonie, l'improvisation et la théorie, les apprenants ont reçu des cours sur les différents métiers que l’on retrouve dans la musique contemporaine. «On a la chance de rencontrer des professionnels qui sont très humbles. Qui prennent le temps pour nous expliquer les bases et répondre à nos questions, aussi, bizarres soient-elles», a déclaré Kevin Lewis Mintsa Mebale, batteur, par ailleurs responsable de l’école musicale gabonaise Awax Music School.
Pour les artistes gabonais présents à cette session de formation, les ateliers ont rempli leur objectif. «Les formations comblent nos attentes pour la simple raison que les formateurs nous enseignent le rythme, comment un artiste doit développer son art, avoir le sens du rythme. Les formateurs nous apprennent à composer un texte, selon qu’il s’agit du jazz ou du blues», indique un artiste.
Pour mémoire, c’est à l’issue de la 3ème édition du New York Forum Africa que Fréderic Gassita, président de l’African Music Institute et Larry Simpson, recteur du Berklee College of Music de Boston, ont signé un mémorandum d’entente avec le gouvernement gabonais pour la création d'une école de musique panafricaine à Libreville.
L'African Music Institute s’intéresse à la musique populaire contemporaine, la musique et la danse africaines traditionnelles. Elle a pour mission de créer des ponts avec Berklee College of Music de Boston. La première rentrée de cette école en construction à Akanda, dans la banlieue de Libreville, aura lieu en septembre de 2017.
Auxence Mengue
La Banque mondiale prévoit une embellie de la croissance, de 2017 à 2019, pour 3 pays sur 6 de la Cemac
La croissance économique de la majorité des pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) devrait s’accélérer modestement de 2017 à 2019, selon les perspectives économiques publiées ce mois de janvier par la Banque mondiale (BM).
Le leader de la zone, le Cameroun, part de 5,6% en 2016 à 5,7% en cette année 2017.
Ce scénario, explique le BM, est dû au fait que les pays en développement comme ceux de la Cemac s'adaptent progressivement à la baisse des prix des produits de base.
Le Tchad part de -3.5 en 2016 à -0.3% en 2017. Mais en 2018, ce taux va se situer à 4.7% et à 6.3% en 2019.
La BM prévoit pour le Gabon des taux de croissance crescendo sur les même périodes : 3.2%, 3.8%, et 4% en 2018 et 2019.
En revanche, le Congo va connaître plutôt une décélération de sa croissance au cours de ces quatre années-là avec respectivement 4.6%, 4.3%, 3.7%, 3.7%.
La Guinée équatoriale va continuer à faire face à sa crise économique (-5.7% en 2016, -5.7%, cette année, -6.6%, l’année suivante et -6.6% en 2019).
La République centrafricaine n’a pas été prise en compte dans la base des calculs de la BM, comme c’est le cas depuis plusieurs années maintenant, depuis que ce pays est en proie à des troubles sociopolitiques quasi-permanentes.
SA
La grève déclenchée à Shell Gabon aurait déjà causé une perte de 4,5 millions de dollars
Depuis le 12 janvier 2016, date du déclenchement de la grève par les employés de la société Shell Gabon SA une partie de la production pétrolière de Shell Gabon SA est en arrêt depuis 4 jours, soit en moyenne 22.500 barils jour.
Suite à cette situation, la société Shell Gabon SA aurait déjà perdu plus de 90 000 barils, ce qui correspond à une perte financière minimale de 4,5 millions de dollars, indique l’Organisation nationale des employés du pétrole (ONEP).
Le 14 janvier dernier, une proposition de sortie de crise a été transmise au facilitateur, le ministre du Pétrole et des Hydrocarbures. Un accord sur cette dernière proposition était vivement attendu par les employés ce lundi 16 janvier 2017. En absence d’un retour satisfaisant, l’ONEP se réserve le droit de durcir la grève dès demain mardi 17 janvier 2017.
Synclair Owona
Le Gabon et les Nations unies définissent leur coopération future
Le système des Nations unies au Gabon et le ministère de l’Economie, ont défini les axes prioritaires du Plan cadre des Nations unies pour l’aide au développement (UNDAF) qui couvrira la période 2018-2022. La planification stratégique de ces axes prévoit de s’étendre sur les domaines liés à la durabilité environnementale, les problèmes de croissance et d’exclusivité.
«Le rôle des Nations unies, en appuyant le gouvernement gabonais, devait se centrer sur la gouvernance. La gouvernance certes économique et financière, mais également la gouvernance liée à tous les droits économiques et sociaux», indique Marie Evelyne Petrus Barry (photo), coordinatrice du système des Nations unies au Gabon.
L’adoption de ce nouveau cadre de coopération intervient au moment où les deux parties viennent de convenir de la prorogation pour 2017 du dernier accord de coopération qui devait arriver à échéance en 2016. Les deux parties ont placé le nouvel accord sur le mode d’emploi des moyens à mettre en œuvre afin de continuer à travailler et assurer le développement, l’accès aux services de base ainsi qu’à l’amélioration des conditions de vie de 30% des personnes pauvres, avec les moyens du gouvernement et des partenaires. «Les Nations unies ne sont pas des bailleurs de fonds, mais des organisations faites d’agences et de fonds qui apportent leurs expertises au gouvernement du Gabon», rappelle la coordinatrice du système des Nations unies.
Pour permettre de toucher un maximum de personnes vulnérables atteintes par la pauvreté, question de contribuer efficacement à l’amélioration de leurs conditions de vie, le système des Nations unies insiste pour une collecte minutieuse des données statistiques.
Pour Ibouili Maganga, directeur de la prospective au ministère de l’Economie, les axes de développement fixés devront correspondre aux possibilités de financement. «Il faudrait que nous veillions à ce que les interventions retenues soient compatibles avec les possibilités de financement que nous allons avoir tout au long de l’année», prévient-il.
Auxence Mengue
La Banque de développement de Chine prête 26 milliards de FCFA à la Bdeac pour développer les PME de la Cemac
La Banque de développement d’Afrique Centrale (Bdeac) informe que son président, Abbas Mahamat Tolli (photo), et Zhou Qingyu, vice-président de la Banque de développement de Chine (CDB), ont signé le 12 décembre 2016 à Beijing, en Chine, une convention de prêt sous la forme d’une ligne de crédit de 40 millions d’euros (environ 26 milliards de FCFA), en faveur de la Bdeac et destinée au financement des Petites et moyenne entreprises (PME) du secteur privé dans la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac).
« Il convient de relever que la stratégie ainsi mise en place est en phase avec la politique de diversification des économies enclenchée par les pays de la Cemac, la chute vertigineuse du prix du pétrole ayant montré la vulnérabilité des économies des pays de la Cemac », explique la Bdeac. Qui ajoute que la signature de cette convention de prêt apportera également des retombées au plan social puisque les PME éligibles à cette ligne de refinancement pourront créer de nouveaux emplois au bénéfice des ressortissants de l’espace communautaire.
Sur l’élargissement de la coopération entre la CDB et la Bdeac, les deux parties sont disposées à l’étendre au-delà du refinancement des PME. Cette extension constituera l’acte 2 de leur coopération. Elle portera sur le financement des projets de grande envergure, ainsi que sur l’utilisation d’autres formes d’intervention, en l’occurrence : le refinancement, le cofinancement et l’arrangement des financements par la Bdeac pour une intervention de la CDB.
S.A