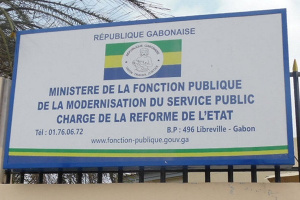Le Nouveau Gabon
Pour Ali Bongo, la Zlecaf est déterminante pour les générations futures
Le président de la République Ali Bongo Ondimba a pris part le 5 décembre au 13e sommet extraordinaire des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine. Une rencontre organisée en visioconférence en prélude à la mise en œuvre effective de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), prévue pour le 1er janvier 2021.
Pour le chef de l’État gabonais, les Africains doivent saisir l’opportunité de la Zlecaf pour produire davantage et accroitre les échanges intracontinentaux. « Si l’Afrique produit davantage ce qu’elle consomme, nous y parviendrons. Dans ce processus, le Gabon prendra toute sa part », affirme-t-il.
Le chef de l’État gabonais a rappelé que la Zlecaf est le « plus grand projet du 21e siècle en Afrique ». Elle est la zone de libre-échange « la plus vaste au monde au regard du nombre de ses États membres. Elle créera un marché continental de biens et services pour une population de plus d’un milliard d’habitants. L’enjeu pour notre continent est historique. Il est déterminant pour les générations futures », a-t-il indiqué.
La Zlecaf qui prévoit une élimination des droits de douane ainsi que toutes les barrières pouvant entraver le commerce vise en effet à stimuler la croissance des pays africains et élargir l’inclusion économique sur le continent. Elle devrait également stimuler la compétitivité et développer des partenariats dans le secteur privé. Ce qui permettra aux secteurs de production de devenir compétitifs et faire face à la concurrence.
SG
Relance économique : le gouvernement gabonais met en place sa stratégie post Covid-19
Au cours du Conseil de cabinet à la Primature le 3 décembre 2020, le ministre de l’Economie et de la Relance, Jean-Marie Ogandaga et ses collègues concernés par le Plan de relance de l’économie (PRE) ont défini les axes de la stratégie de relance de l’économie post Covid-19.
Cette stratégie va s’appuyer sur sept secteurs identifiés comme porteurs de croissance, notamment les mines, les hydrocarbures, l’agriculture, la pêche, le commerce, le tourisme et l’énergie.
« Le ministère dont j’ai la charge a pour mission de proposer au gouvernement un Plan de relance de l’économie au sortir de la Covid, je dirai même pendant la Covid. Il était important qu’autour de madame le Premier ministre, que l’on sache chacun ce qu’il a à faire, comment le faire et dans quel laps de temps, de telle sorte que nous mettions en place un plan cohérent et chiffré », a déclaré Jean-Marie Ogandaga.
La question du financement était également évoquée lors de ce Conseil de cabinet. Pour le ministre en charge de la Relance, l’Etat gabonais doit compter sur ses propres moyens.
« Nous comptons d’abord avec nos propres forces. Et nos propres forces, c’est la mobilisation des ressources intérieures. Et cette mobilisation se fait par le truchement de la Douane, par le truchement de l’Impôt. Donc, nous taxons les marchandises, nous taxons les déplacements, nous taxons tous les produits. Donc c’est ça notre première source », a indiqué Jean-Marie Ogandaga.
Il ajoute : « Nous devons savoir où trouver les financements, à quelle échéance, à quels taux, de telle sorte que nous n’ayons pas des financements très chers, que nous n’ayons pas des financements qui ne soient pas disponibles au moment où il faudra payer les entreprises ».
Tout ce qui est prévu devrait être réalisé à partir de 2021, jusqu’en 2023, afin de redynamiser l’activité économique et améliorer le quotidien des populations.
Brice Gotoa
Lire aussi:
Stratégie de relance post-Covid-19 : ces réformes des finances publiques envisagées
Relance de l’économie : du fait de leur proximité avec les PME, les microfinances pourraient jouer un rôle majeur
Grâce à ses activités au Gabon, Panoro Energy devrait augmenter sa production de pétrole dans les prochains trimestres
« De nombreuses initiatives opérationnelles devraient augmenter la production nette de Panoro au cours des prochains trimestres », annonce, la société pétrolière norvégienne dans un communiqué publié le 23 novembre dernier, sans donner plus de précisions sur l’ordre de cette augmentation. Parmi ces initiatives, la multinationale cite de nombreuses activités localisées au Gabon où Panoro Energy détient 7,5% dans le permis de Dussafu Marin, au sud du pays.
On append notamment que les puits DTM-6H (foré, mais non lié) et DTM-7H (à forer) seront mis en production vraisemblablement au cours du premier semestre 2021. Dans cette optique, Panoro Energy annonce d’ailleurs la reprise à la même période de ses activités de forage. L’entreprise avait interrompu ses activités dans le pays au mois de juin dernier en raison de la crise sanitaire de la Covid-19.
« Le retraitement sismique à Dussafu a confirmé le potentiel d’une multiplication par trois des volumes d’hydrocarbures sur le champ Hibiscus au large du Gabon », ajoute l’entreprise norvégienne. Selon l’évaluation faite par la société américaine Netherland, Sewell & Associates Inc. en fin 2019, les réserves de pétrole prouvées de ce champ sont estimées à 31,2 millions de barils, les réserves prouvées et probables à 45,4 millions de barils et les réserves prouvées, probables et possibles à 58 millions de barils.
À tout ceci, il faut ajouter les économies de 100 millions de dollars (autour de 55 milliards de FCFA) réalisées grâce à un plan de développement alternatif des champs Hibiscus et Ruche. Ce nouveau plan utilise des plateformes autoélévatrices à la place d’une plateforme de tête de puits.
SG
Le Gabon veut revaloriser les salaires des travailleurs du secteur agricole
Le ministre de la Fonction publique, Madeleine Berre, son collègue de l’Agriculture, Biendi Maganga Moussavou, et les représentants de la société Olam se sont rencontrés le 3 décembre 2020 pour étudier les moyens du relèvement des salaires des travailleurs du secteur agricole.
Selon des employés du secteur agricole formel, les salaires payés restent en deçà du SMIG, soit de 80 000FCFA pour 40 heures de travail. Selon Olam, en réalité, avec le versement des primes, actuellement les salariés du groupe ne gagnent pas moins de 150 000 FCFA.
« Nous conduisons, dans le cadre de la mise en œuvre de la vision du chef de l’État, plusieurs réformes. Celle de constituer une inspection spéciale du travail dédié au secteur agricole. Avec mes collègues en charge du Travail, nous avons examiné les conditions de mise en œuvre d’une réforme qui vise à améliorer encore cette attractivité du secteur agricole, améliorer la compétitivité de la filière sur les aspects de rémunération », a déclaré Biendi Maganga Moussavou, ministre gabonais de l’Agriculture.
Les dispositions législatives qui régissent la grille salariale dans le secteur agricole sont caduques. Pour une meilleure visibilité du Gabon vert prôné par le président, Ali Bongo Ondimba, les réformes entreprises par le gouvernement visent à adapter ce système de rémunération à celui en vigueur en République gabonaise, c’est-à-dire à l’application du SMIG (150 000 FCFA).
En outre, les partenaires de ce secteur demandent de faire une adaptation qui prend également en compte les saisons de récolte ou de productivité. Au sein de cette application de la nouvelle grille, ils parlent de bonus de performance en plus du salaire brut qui sera appliqué.
Brice Gotoa
Conformité aux normes : le patronat gabonais demande un assouplissement
Dans deux mois, le Gabon va étendre les contrôles de conformité aux normes à tous les produits qui entrent et sortent du territoire gabonais. Un arrêté, signé le 16 juillet 2020, fixe les conditions d’application de l’évaluation de la conformité aux normes des produits.
Une décision qui n’est pas du gout du patronat gabonais qui « préconise la poursuite d’un cadre de concertation plurisectoriel à même d’aboutir à un assouplissement de cette mesure préjudiciable à une relance de l’économie considérablement affaiblie par la crise sanitaire mondiale », selon un communiqué rendu public par le nouveau bureau exécutif de la Confédération patronale gabonaise (CPG), réuni ce 4 décembre 2020.
D’après la CPG, la mise en œuvre de ce texte en l’état actuel ne sera pas favorable aux entreprises. Ce d’autant plus qu’il va entrainer des coûts supplémentaires chez les importateurs et les exportateurs et par conséquent sur le consommateur final.
« Il n’y a pas de refus à ce que l’Aganor remplisse ses missions. Mais, l’on constate tout de même que l’Aganor n’a pas la technicité nécessaire pour le contrôle de certains produits et ne dispose pas de laboratoires non plus. Je pense qu’il faut que cet arrêté ne soit pas appliqué à tous les produits », charge un opérateur économique.
Au niveau de l’Aganor, l’on explique que la mise en œuvre de cette mesure est aujourd’hui nécessaire dans la mesure où la zone de libre-échange continentale (Zlecaf) va entrer en vigueur en 2021. « Dans un tel contexte, on doit tout mettre en œuvre pour être compétitif sur le marché africain. En plus, notre objectif est de protéger la santé et de la sécurité des consommateurs contre tout produit dangereux, non conforme aux normes ou contrefait, protéger l’industrie nationale contre la concurrence déloyale et la contrefaçon, assurer la traçabilité des produits et promouvoir la culture de la qualité », soutient un agent de l’Aganor.
Pour plusieurs produits, l’Aganor a mandaté des sociétés internationales afin de procéder aux inspections, évaluations et contrôles pour la délivrance des certificats de conformité.
Sandrine Gaingne
Lire aussi:
Le Gabon rend obligatoire l’application des normes sur des produits fabriqués localement
Le Gabon travaille à faire de la Zlecaf un levier de croissance de ses exportations vers Afrique
En 45 ans d’existence, la BDEAC revendique un investissement de 1 449 milliards de FCFA au bénéfice de la Cemac
A l’occasion de la commémoration de ses 45 ans d’existence le 3 décembre, la Banque de développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC) a fait le point sur ses interventions financières dans la zone Cemac (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad).
« Les interventions de la BDEAC ont eu un large impact socio-économique dans les six États membres de la Cemac, à travers un volume global de financement qui s’élève à 1 449 279 milliards de FCFA, dans les domaines aussi variés que l’éducation, la santé, l’industrie et l’agro-industrie, le développement agricole et rural, les télécommunications, les infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires et l’énergie », déclare l’institution bancaire.
Aujourd’hui, la BDEAC estime qu’elle est une alliée de choix pour le financement des projets de développement économiquement viables, socialement inclusifs, écologiquement neutres et financièrement rentables, dans la sous-région Cemac et dans les autres pays membres non régionaux si son intérêt l’exige.
Dans la prospective, la Banque ambitionne de jouer un rôle prépondérant dans la gestion des écosystèmes de la sous-région et la recherche de solutions économiques efficaces dans la lutte contre les effets du changement climatique en Afrique centrale. À cet égard, elle est engagée dans un processus d’accréditation au Fonds Vert pour le Climat (FVC) qui permettra in fine de mobiliser des ressources adaptées en faveur du développement durable en Afrique centrale.
Avec un capital social de 1 200 milliards de FCFA, l’actionnariat de la Banque est composé des actionnaires de catégories A et B. Les titulaires des actions de la catégorie A sont les pays de la Cemac qui détiennent 50,88% des parts, soit 610,56 milliards de FCFA.
Ceux de la catégorie B représentent les institutions et États non régionaux. Il s’agit de : la Banque africaine de développement (BAD), la Banque des États de l’Afrique centrale (Beac), la Commission de la Cemac, la France, le Koweït, la Libye, le Royaume du Maroc, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea) et le Fonds de solidarité africain (FSA). Ils détiennent 35,50% des parts. Le reste des 13,62% n’a pas encore été souscrit.
S.A.
Les agents de la direction générale de l’économie sociale à l’école pour un rendement professionnel plus performant
Trente agents publics de la direction générale de l’économie sociale renforcent leur capacité opérationnelle dans l’appropriation des techniques de gestion administrative, comptable et financière d’une entreprise sociale.
Placé sous le thème « les outils nécessaires pour le conseil et l’accompagnement des entreprises dans leur processus de développement », cet atelier donnera l’occasion aux agents d’approfondir davantage leur connaissance sur le secteur économie sociale et solidaire. Il est aussi une opportunité pour mieux s’approprier les outils théorique et pratique de l’économie sociale et solidaire.
« Le but étant d’améliorer la qualité des prestations rendues aux usagers de notre administration que sont les associations, les coopératives, les ONG, les mutuelles et les fondations, qui attendent beaucoup de nos agents dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques de soutien et d’encadrement en vue de réduire la précarité dans notre pays », a indiqué Gisèle Béatrice Mpemba, directrice générale adjointe de l’économie sociale.
Au sortir de cette formation, les apprenants pourront donner chaque jour davantage le meilleur d’eux-mêmes dans l’exercice de leur activité professionnelle.
Ce programme est inspiré de la politique du chef de l’État, Ali Bongo Ondimba, relatif au développement du capital humain, vecteur primordial de compétence et puissant levier du développement d’un pays. Il s’organise sur la base des modules préalablement élaboré par un expert et validé par la direction générale de l’économie sociale.
Bric Gotoa
Fonction publique : entre 2019 et 2020, la situation de 5385 agents a été régularisée au Gabon
Selon la ministre de la Fonction publique, Madeleine Berre, la situation administrative de 5385 agents a été régularisée entre 2019 et 2020 dans la fonction publique. Ces intégrations ont concerné quatre secteurs prioritaires que sont la santé, l’éducation nationale, la sécurité pénitentiaire entre autres. Et elles ont permis d’accroitre le nombre de fonctionnaires gabonais. Selon les chiffres de la direction générale du budget et des finances publiques, les effectifs du secteur public ont augmenté pour s’établir à 99 885 agents au premier semestre 2020.
La régularisation des situations administratives a été effectuée en dépit des réformes d’ajustement et de maitrise des effectifs de la fonction publique décidées par le gouvernement. Ces réformes concernent la suspension des reclassements et avancements automatiques dans l’administration centrale, ainsi que des recrutements et le non-remplacement systématique des départs à la retraite.
Malgré l’existence de ces réformes, la ministre de la Fonction publique indique que les régularisations vont se poursuivre et un plan a pour cela été mis en place pour la période 2020-2021. Un plan de régularisation qui se veut progressif pour les agents en présalaires dans tous les secteurs et les diplômés de toutes les écoles nationales, les reclassements après les stages dans tous les secteurs de l’administration. Ce plan fait partie des 144 propositions adoptées par les responsables de l’administration publique et les organisations syndicales lors du forum de la fonction publique, organisé en janvier dernier à Libreville.
Sandrine Gaingne
Lire aussi:
Au Gabon, les primes des fonctionnaires seront désormais distribuées au mérite
BGFI Holding corporation obtient les notes A+ et A1- de Bloomfield avec une perspective stable
Le Groupe BGFIBank a annoncé ce 3 décembre que l’agence de notation Bloomfield Investment Corporation a attribué la note de A+ à BGFI Holding Corporation pour la deuxième année consécutive. C’est une note d’investissement à long terme avec une perspective stable. Sur le court terme, l’entreprise reçoit la note A1-, avec une perspective stable également.
D’après la structure bancaire, cette notation positive traduit la cohérence de la stratégie mise en œuvre, ainsi que la résilience organisationnelle du Groupe BGFIBank dans son ensemble. Elle signifie par ailleurs un risque faible.
« Nous nous réjouissons de cette nouvelle reconnaissance qui consacre l’attachement du Groupe BGFIBank aux principes de transparence financière et se traduit par l’exigence faite à l’ensemble de nos entités bancaires de se soumettre au même exercice. Ainsi, après BGFIBank Gabon, BGFIBank Côte d’Ivoire et BGFIBank Europe, cette démarche est désormais engagée pour nos filiales du Congo-Brazzaville et du Cameroun » a déclaré́ le président directeur général du Groupe BGFIBank, Henri-Claude Oyima, dans un communiqué.
La notation attribuée par Bloomfield s’appuie entre autres sur le renforcement continu du cadre de gouvernance et du dispositif de gestion des risques ainsi que sur la performance globale et une solidité́ financière qui se confirment, en dépit de la crise sanitaire liée à la Covid-19.
Lire aussi:
BGFIBank Europe décroche une note AA+ et A1 de la part de Bloomfield Investment Corporation
Investissements : la Russie montre de plus en plus son intérêt pour le Gabon
La Russie semble déterminée à renforcer ses relations de coopération avec le Gabon et multiplie ces derniers mois des rencontres avec les autorités gabonaises. Ce 3 décembre 2020, Ilias F. Iskandarov, ambassadeur de Russie au Gabon, a été reçu par le tout nouveau directeur général de l’Agence nationale de la promotion des investissements (ANPI), Ghislain Moandza Mboma.
Les échanges entre les deux hommes « ont porté sur le renforcement des relations bilatérales et sur la mise en place des stratégies d’appui au développement de la diplomatie économique entre les deux pays. Ceci, en vue de trouver de nouveaux formats de coopération et d’identifier des intérêts communs relatifs aux opportunités d’affaires et d’investissement offertes réciproquement », indique l’ANPI.
Avant cette rencontre, le diplomate russe avait été reçu en audience par le Premier ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda, le 10 novembre 2020. Il avait également proposé que les deux pays mettent en place des mesures novatrices susceptibles de créer des liens plus approfondis dans les domaines politiques, économiques, commerciaux, culturels et militaro-techniques.
Par ailleurs, d’après les autorités russes, plusieurs sociétés opérant dans les secteurs de l’énergie, du pétrole, de l’automobile et des BTP ont manifesté l’intérêt d’investir au Gabon.
La mise en place d’une nouvelle stratégie dans la collaboration entre Libreville et Moscou devrait apporter un coup d’accélérateur à une relation de coopération aujourd’hui en veilleuse du fait de la pandémie de la Covid-19, selon Johanna Rose Mamiaka, ambassadrice du Gabon en Russie dans une récente sortie.
SG
Lire aussi:
Diplomatie : les pistes de dynamisation de la coopération entre Libreville et Moscou