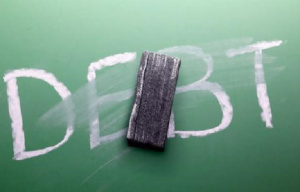Le Nouveau Gabon
Anpi : Ghislain Modza Mboma pour booster la création d’entreprises dans un contexte de crise
Depuis le 20 novembre Ghislain Modza Mboma est le nouveau directeur général de l’Agence nationale de promotion des investissements (Anpi). Il remplacement Gabriel Ntougou.
Ghislain Modza Mboma prend les rênes de cette structure dans un contexte de crise et devra donc relever plusieurs défis pour la promotion des investissements au Gabon. Dans la continuité de son prédécesseur, il devra mettre en œuvre des actions pour améliorer le climat des affaires dans le pays.
Le guichet numérique d’investissement (GNI), lancé en juin 2020 par son prédécesseur, a permis d’accroitre considérablement le nombre d’entreprises créées dans le pays en quelques mois seulement. Selon des chiffres de l’Anpi, plus 1600 entreprises ont été créées en l’espace de deux mois (entre juin et aout 2020). Aujourd’hui, malgré les effets de la crise sanitaire sur les entreprises, il devra relever le défi d’accroitre ces taux.
Et son expérience au sein de cette structure sera un atout. Depuis 2016, Ghislain Modza Mboma est le directeur de la promotion des investissements à l’Anpi. Et à ce poste, il a contribué à la conception et à l’opérationnalisation de l’Agence.
Avant d’intégrer l’Anpi, il a été directeur régional en charge des pays francophones pour le groupe turc Yildirim Holding, spécialisé dans les mines et l’énergie. Son rôle consistait à conseiller le groupe dans sa stratégie de développement en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest, rechercher des partenaires et construire des relations entre les autorités publiques et le secteur privé pour le groupe.
Il a également été le country manager de la filiale de IELS Global (une structure de service aux sociétés pétrolières) ; DG de l’établissement de microfinance Loxia en 2010 et directeur Western Union BGFI Bank de 2001 à 2010. Une grande expérience qu’il devra mettre au profit de l’Anpi et de l’économie gabonaise.
SG
Lire aussi:
L’Anpi met fin à la mesure de solidarité Covid et rétablit les tarifs de création d’entreprises
Gabriel Ntougou, Dg de l’ANPI, une nouvelle dynamique à la création d’entreprise
À fin septembre 2020, l’État du Gabon rembourse 185,4 milliards de FCFA de dettes
Sur une prévision de 276,5 milliards de FCFA, arrêtée dans la loi de finances rectificative 2020, le gouvernement annonce avoir déboursé près de 185,4 milliards de FCFA, pour le règlement des charges de la dette au cours des neuf premiers mois de l’année en cours. Ce qui fait un taux de réalisation de 67% par rapport aux prévisions.
L’information est contenue dans le rapport d’exécution budgétaire pour le compte du troisième trimestre 2020. Selon ce document, ce niveau d’exécution supérieur à celui enregistré à la même période en 2019. À cette date-là l’année dernière, le pays avait remboursé 139,1 milliards de FCFA de dettes.
De manière détaillée, ces règlements sont composés de charges d’intérêts sur la dette extérieure pour 124,8 milliards de FCFA et 60,6 milliards pour ceux de la dette intérieure. S’agissant de la dette extérieure, les intérêts de la dette bilatérale s’élèvent à 14, 6 milliards, ceux de la dette multilatérale à 14,4 milliards ; la dette envers les marchés financiers se situe à 89,8 milliards et les intérêts des banques commerciales se chiffrent à 6 milliards.
Pour les intérêts sur la dette intérieure, on enregistre 49,6 milliards de FCFA pour la dette intérieure conventionnée. Ils se composent notamment de 28,9 milliards au titre des intérêts bancaires ; 3,2 milliards sur les moratoires et 17,5 milliards sur les marchés financiers.
Les intérêts liés à la gestion de la trésorerie de l’État, quant à eux, se chiffrent à près de 11 milliards de FCFA. Ils se répartissent entre 2 milliards de facilités de caisse ; 8,9 milliards sur les intérêts des Bons du Trésor assimilables (BTA) et 192 millions sur les autres frais bancaires.
Marcel Saint-clair Eyene
Avec l’appui de la FAO, le Gabon veut développer une pêche artisanale durable
Le bureau sous-régional de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture au Gabon et pour l’Afrique centrale et le gouvernement gabonais sont à pied d’œuvre pour la densification des activités de pêche dans le pays.
Plusieurs missions sont organisées dans des localités du pays en vue d’identifier les appuis nécessaires au développement des centres de pêches maritimes et continentales. À la suite des localités de Mouila et de Mayumba, une délégation d’experts s’est rendue la semaine dernière dans la localité de Coco Beach, située à une centaine de kilomètres au de Libreville.
À l’instar des précédentes descentes de terrain, il a une fois de plus été question d’évaluer les atouts, les opportunités ainsi que les contraintes liées au développement de la pêche dans cette localité. Les échanges avec les parties prenantes ont, par exemple, permis à la délégation de la FAO « de mieux cerner les problèmes rencontrés, leurs causes ainsi que les défis et les opportunités, pour définir des appuis techniques ciblés qu’elle envisage d’apporter au gouvernement à travers son programme de coopération technique ».
Ce projet en cours de maturation visera le développement et l’encadrement des chaines de valeurs des produits halieutiques de la pêche artisanale de manière durable, efficace et inclusive sur les sites de Coco Beach, Mayumba, Mouila, Makokou et Franceville. Cela, à travers les renforcements des capacités des centres de pêche et des services rendus aux Organisations de producteurs.
Dans la cadre de l’encadrement de la pratique de la pêche et de l’aménagement des ressources halieutiques, le gouvernement a pris un certain nombre d’initiatives ces dernières années. Celles-ci ont abouti à la création des centres de pêche artisanale dans les villes de Libreville, Port-Gentil et Lambaréné. D’autres sont en cours de construction, notamment à Cocobeach.
Selon le gouvernement, « la construction de ces centres de pêche traduit la volonté d’améliorer la pratique de la pêche et les conditions de travail des pécheurs artisanaux en apportant certains services essentiels aux usagers des ressources halieutiques tout en luttant contre la cherté de la vie en favorisant une meilleure mise en marché des produits de la pêche ».
Marcel Saint-clair Eyene
Crédits bancaires : au 1er semestre 2020, le Gabon affiche les taux d’intérêt les plus élevés de la Cemac
Entre janvier et juin 2020, les banques gabonaises ont été très exigeantes dans l’octroi des crédits. Sur les crédits de long terme (remboursables sur 80 mois en moyenne, 6% du volume total des nouveaux crédits), où les taux d’intérêt ont été les plus élevés du marché, elles tiennent le haut du pavé, avec des taux d’intérêt moyens allant jusqu’à 14,5%, au cours de la période sous revue. Le pays est suivi par la République centrafricaine (RCA, 10,7%), le Cameroun (10,3%).
En ce qui concerne les crédits à moyen terme (remboursables sur 42 mois en moyenne, 15 % du volume total des nouveaux crédits), très prisés par les opérateurs économiques, le pays affiche des taux d’intérêt moyens de 14,23. C’est également le taux le plus élevé de la Cemac. Le Gabon est suivi par la RCA (12,47%) et le Cameroun (11,93%).
En plus d’être les champions en matière de cherté des crédits de long et moyen termes, le Gabon et la RCA gardent le même statut sur les conditions d’octroi des emprunts de court terme (11 mois en moyenne, 79% du volume total des nouveaux crédits). Pour ces emprunts, les banquiers gabonais et centrafricains ont pratiqué des taux d’intérêt moyens respectifs de 12, 46 et 11,58%, apprend-on.
BRM
Fonction publique : un pas de plus vers le reclassement et la régularisation de certains agents et diplômés
Des 144 propositions adoptées par les responsables de l’administration publique et les organisations syndicales lors du forum de la fonction publique, organisé en janvier dernier à Libreville, 31 ont été validées par le gouvernement en Conseil des ministres le 20 novembre.
Parmi ces propositions se trouve l’adoption du plan de régularisation progressif des situations administratives qui concerne l’année 2020-2021 pour les agents en présalaires de tous les secteurs et les diplômés de toutes les écoles nationales. Ce plan de régularisation des agents publics prévoit également les reclassements après les stages dans tous les secteurs de l’administration, après les concours professionnels et ceux des enseignants admis au Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (Cames).
« Les travailleurs doivent se rassurer que les choses vont bientôt commencer et que l’inquiétude justifiée des uns et des autres doit s’apaiser aujourd’hui vu notre implication dans ce travail. À aucun moment, nous n’allons permettre que leurs intérêts soient menacés. Nous comptons sur l’ensemble des partenaires sociaux pour que ce qui va être fait intègre tout le monde. Nous avons en idée les jeunes qui attendent, ceux qui sont en activité et les retraités », a indiqué le vice-président du Comité de pilotage du forum de la Fonction publique, Joël Ondo Ella, au cours d’une rencontre avec les partenaires sociaux le 24 novembre à Libreville.
En plus des régularisations, les 31 propositions contiennent la mise en place de la commission interministérielle (ministère du Budget, et de la Fonction publique) sur les modalités d’arrimage des pensions au nouveau système des rémunérations (soutenabilité financière du système de pension, délais de faisabilité, et conditions d’éligibilité) ; ainsi que la réflexion sur l’instauration de cadres de discussion matérialisant le dialogue social au sein des départements ministériels.
« Toutes ces propositions ont été retenues par le gouvernement parce qu’elles ont été jugées faisables. Elles vont être mises en place progressivement en fonction de la situation économique et financière de l’État », apprend-on.
Engagée par l’État à travers le Plan stratégique Gabon émergent, la réforme de la Fonction publique gabonaise vise à rendre l’administration gabonaise plus performante et efficace. Ce, par la mise en place d’une politique de dématérialisation de l’administration, la planification objective des recrutements, la vulgarisation du code déontologique de la fonction publique, la dépolitisation de l’administration publique, la priorisation des recrutements par voie de concours.
SG
Lire aussi:
Dématérialisation et recrutements : 144 propositions pour réformer la fonction publique gabonaise
Diffamations des institutions et de ses représentants : l’État du Gabon annonce un recours systématique à la justice
Dans un communiqué rendu public ce 26 novembre 2020, la présidence de la République gabonaise annonce qu’elle poursuivra désormais en justice les auteurs de messages diffamatoires contre les institutions républicaines et leurs représentants.
« Face à la recrudescence de la diffusion d’informations à caractère mensonger et diffamatoire visant notamment les institutions de la République et les personnes qui les incarnent, des poursuites judiciaires seront désormais engagées systématiquement contre toute personne auteure ou complice de cette diffusion au Gabon et à l’étranger conformément aux textes en vigueur », lit-on dans ledit communiqué.
Cette décision a été prise suite à une information diffusée par La Lettre du continent au sujet du troisième fils du président de la République et jugée mensongère par les autorités.
Se réservant le droit de poursuivre ce média, la présidence de la République soutient que les libertés d’expression et de l’information, consacrées par la constitution, ne sauraient justifier que des actes portant atteinte à l’honneur et à la dignité des institutions et des citoyens, tout aussi protégés par la constitution, demeurent tolérés et impunis. Car « le respect des lois ne saurait être à géométrie variable », selon le porte-parole de la présidence Jessye Ella Ekogha.
Le Code pénal gabonais sanctionne la diffamation et les infractions connexes d’une peine de prison pouvant attendre 5 ans et d’une amende pouvant aller jusqu’à 5 millions de FCFA.
Selon le rapport Afrobarometer 2020 publié au mois de septembre, 57% des Gabonais seraient favorables à l’interdiction par le gouvernement de toute critique et injure à l’encontre du chef de l’État, même si 62% de la population estimaient ne pas être suffisamment libres de s’exprimer, notamment sur les questions politiques.
SG
Lire aussi:
Derniers réglages avant le lancement de plusieurs chantiers routiers, d’infrastructures scolaires et sanitaires
Dans le cadre de la construction et de la réhabilitation de plusieurs infrastructures routières, scolaires et sanitaires, le Premier ministre a rencontré le 24 novembre les entreprises adjudicatrices d’appels d’offres lancés par le gouvernement.
L’objectif de cette rencontre était de faire le point des différents projets, d’échanger sur les modalités pratiques de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation de ces projets et d’élaborer les nouvelles procédures de paiement.
« À la demande du Premier ministre, nous avons élaboré les différents projets et leur situation physique. Il s’agit de voir ensemble les problèmes les plus importants et les règlements. Le problème le plus important est celui du Boulevard Triomphal. Il fallait donc voir dans les mois qui viennent comment ce problème sera résolu », a expliqué le directeur général de Socoba-Edtpl, Jean-Claude Baloche Ondimba.
« Nous intervenons dans le cadre de la réhabilitation du lycée technique de Ntoum, plus précisément au niveau des internats. Le Premier ministre nous a rassurés du paiement imminent des travaux à venir. Ils doivent être réalisés pour février 2020, elle nous a garanti le démarrage des travaux dès que les financements seront disponibles », a souligné pour sa part M. Mayabi, directeur général de la société de construction plomberie et chaudronnerie, entreprise adjudicataire chargée de réhabiliter le lycée technique de Ntoum.
Il est également prévu le démarrage des travaux d’entretien de l’axe Makokou-Lac Mouniandji entre le PK80 et le PK160 dans la province de l’Ogooué-Ivindo, la réhabilitation du centre de santé régional d’Oyem… Tous ces projets sont financés par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement.
SG
Secteur pétrolier : la fuite des documents « confidentiels » fait réagir le ministère de l’Économie
Ce 25 novembre 2020, plusieurs documents jugés « confidentiels » ont été envoyés à plusieurs médias. Le stratagème vise à mettre en cause le ministre de l’Économie, Jean-Marie Ogandaga (photo), accusé d’être au cœur d’un nouveau scandale d’exemption et d’accords transactionnels, au bénéfice de plusieurs entreprises pétrolières. Des agents des régies financières, qui ne digèrent pas la nouvelle méthode d’attribution des primes, sont soupçonnés d’être à l’origine des fuites.
En réaction à la diffusion de ces documents administratifs sur les réseaux sociaux, le ministère de l’Économie et de la Relance vient de faire une mise au point. Dans un communiqué commis à cet effet, le département ministériel parle d’informations erronées. « En effet, ces derniers (auteurs des fuites) estiment, à tort, que ces entreprises avaient manifesté la volonté de s’acquitter de leurs pénalités réglementaires qui fixent au plus haut niveau le seuil d’amende prévu par le code des douanes », indique le communiqué.
« Dans les faits, face à l’incapacité de ces sociétés de payer ces sommes très importantes, des accords transactionnels leur ont été accordés dans le strict respect dudit code (article 327 du code des Douanes) », soutient le ministère. Un accord transactionnel est une entente entre deux parties litigantes : les sociétés d’une part, et l’administration des Douanes ou des Impôts d’autre part.
En conséquence, « au vu du caractère diffamatoire du contenu diffusé, les autorités du ministère de l’Économie et de la Relance se réservent le droit d’ester en justice les auteurs de ces informations malveillantes », conclu ledit communiqué.
Marcel Saint-clair Eyene
Covid-19 : fin de la gratuité du transport pour le personnel de santé engagé dans les soins au Gabon
A partir du 30 novembre prochain, le personnel de santé ne bénéficiera plus de la gratuité du transport instaurée par le gouvernement depuis le début de la crise sanitaire pour limiter les contacts avec les populations et faciliter les déplacements de ceux-ci.
« Dans le cadre des mesures de veille et de riposte contre la Covid-19, le gouvernement avait mis gratuitement à la disposition du personnel de santé engagé dans les soins, 28 bus de la société Trans’Urb pour leur transport pendant une période de six mois. Conformément aux instructions du Premier ministre, je vous informe de la suspension de cette mesure à compter du 30 novembre 2020 », informe Patrice Ontina, secrétaire général du ministère de la Santé, dans une note de service.
Cette mesure est suspendue comme plusieurs autres mises en place par le gouvernement au début de cette pandémie. Il s’agit, entre autres, de la fin de la gratuité du transport pour les élèves de terminale et de la réduction des tarifs de création d’entreprises.
Ces décisions sont prises dans un contexte où la pandémie est sous-contrôle sur le territoire gabonais avec 96 cas actifs et un taux de guérison de plus de 98% au 23 novembre 2020.
Lire aussi:
L’Anpi met fin à la mesure de solidarité Covid et rétablit les tarifs de création d’entreprises
Cemac : trois projets financés par la BDEAC à hauteur 176 milliards de FCFA bénéficient au Gabon
Des 470 millions € (308 milliards de FCFA) prévus par la Banque de développement de l’Afrique centrale (BDEAC) pour financer la mise en œuvre des projets intégrateurs prioritaires de la Cemac, 176,29 milliards de FCFA vont aller aux projets touchant le Gabon.
Il s’agit de la construction des tronçons manquants de la route Ndendé-Doussala-Dolisie du corridor Libreville-Brazzaville à hauteur de 61,18 millions €, soit 40,13 milliards de FCFA ; de la construction de la route Kogo-Akurenam du corridor Bata-Libreville (200 millions €, soit 131,2 milliards de FCFA) ; et enfin, de l’interconnexion du réseau de fibre optique entre le Gabon et les autres pays de la Cemac (7,56 millions €, soit 4,96 milliards FCFA).
Les autres projets à financer par la BDEAC dans la sous-région sont l’aménagement du corridor Brazzaville-Ouesso-Bangui-Ndjamena, liaison Congo-Tchad-Centrafrique (178 millions €, soit 116,77 milliards de FCFA) ; la construction d’un pont sur le fleuve Ntem, facilitation du transport et sécurité routière sur la route transnationale Kribi-Campo-Bata, sur le corridor Yaoundé-Bata (13,59 millions €, soit 8,9 milliards FCFA) ; la construction de la voie express Lolabé-Campo entre le Cameroun et la Guinée équatoriale (9,40 millions €, soit 6,16 milliards de FCFA).
Rappelons que la Cemac (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad) a levé la somme de 2 492 milliards de FCFA pour 11 projets intégrateurs prioritaires les 16 et 17 novembre dernier à Paris. Outre la BDEAC, d’autres partenaires bilatéraux et multilatéraux traditionnels et émergents, publics et privés, vont financer la mise en œuvre de tous ces projets.
SG
Lire aussi:
À Paris, la Cemac lève 2 492 milliards de FCFA pour 11 projets intégrateurs