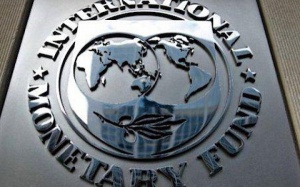Le Nouveau Gabon
Application de la nouvelle réglementation de change de la Cemac : un 3e moratoire accordé aux entreprises pétrolières et minières
Après plusieurs concertations, la Banque des États de l’Afrique centrale (Beac), institut d’émission des six pays de la Cemac (Cameroun, Congo, Gabon, Tchad, Guinée Équatoriale et RCA), a décidé de donner un délai supplémentaire aux entreprises pétrolières et minières pour l’application de la nouvelle réglementation de change.
Concrètement, après deux premiers renvois, notamment au 1er septembre et au 10 décembre 2019, cette réglementation, officiellement entrée en vigueur depuis mars 2019, ne sera opposable aux entreprises pétrolières et minières en activité dans la Cemac qu’à partir du 31 décembre 2020.
Le gouverneur de la Beac, Abbas Mahamat Tolli (photo), a fait cette révélation le 18 décembre 2019 dans la capitale économique camerounaise, au sortir du dernier Comité de politique monétaire (CPM) de cette banque centrale, pour le compte de l’année 2019.
Pour rappel, l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation de change a été suivie par une pénurie des devises dans la zone Cemac, à cause du non-respect des règles par les banques commerciales. Des concertations entre ces établissements de crédit, les opérateurs économiques et la Beac ont abouti à la prise de mesures d’assouplissement, qui ont finalement permis de mettre un terme à cette crise des devises et de fluidifier les transferts internationaux.
Défis
Au demeurant, six mois après l’entrée en vigueur de cette réglementation, qui permet de mieux tracer la circulation des devises dans l’espace Cemac, les entreprises pétrolières et minières n’y sont toujours pas soumises. Et pour cause, ces dernières s’opposent à l’obligation de rapatriement des devises issues de leurs exportations, comme l’impose la nouvelle réglementation de change.
Ces entreprises, du fait de la particularité de leurs activités, bénéficient en effet de facilités accordées par les États de la Cemac, et qui leur permettent de ne pas rapatrier les fonds issus de leurs activités d’exportation.
Afin de trouver un terrain d’entente sur cette question, la Beac, tout en soulignant la nécessité pour tous de respecter les dispositions de la nouvelle réglementation de change (posture soutenue par le FMI), a engagé des concertations avec ces opérateurs pétroliers et miniers.
Selon nos sources, la banque centrale des États de la Cemac a d’ailleurs recruté un cabinet de renom, pour aider à la prise de décisions idoines et aux réajustements nécessaires devant conduire au respect de cette réglementation de change par les sociétés pétrolières et minières, sans que cela n’entrave le bon déroulement de leurs activités.
Brice R. Mbodiam
La FAO et l’ANPI livrent leur première cuvée des formateurs gabonais en entrepreneuriat agricole
Cinq jeunes agri-preneurs, acteurs des chaines de valeurs agricoles, viennent d’achever une formation en entrepreneuriat agricole. Il s’agit spécifiquement d’une formation des jeunes conseillers et conseillères en entrepreneuriat agricole. Cette formation repose notamment sur des techniques de formation et de suivi-conseil en gestion de la micro, petite et moyenne entreprise agricole.
Le développement des compétences entrepreneuriales, en matière agricole chez des jeunes gabonais, est le nouvel objectif que se sont fixé l’Agence de promotion des investissements (ANPI) et le bureau de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) au Gabon. Cette approche, en cohérence avec les priorités de son Cadre de programmation pays (CPP), s’inscrit dans le cadre de l’objectif stratégique d’élimination de la faim d’ici à 2030 (faim Zéro) de la FAO.
Les bénéficiaires, soigneusement sélectionnés par la FAO et l’ANPI, ont acquis des compétences en plan marketing, en planification de la production, des achats et des approvisionnements, en gestion des stocks, en choix des investissements, en plan de trésorerie et en la TVA. Cette première cuvée de conseillers aura pour mission, d’animer à leur tour, des séminaires de formation des formateurs et à accompagner des groupes des jeunes agri-preneurs.
L’objectif visé par la FAO étant de renforcer la structuration et les compétences des acteurs de l’appui/conseil en création et gestion d’entreprises dans les chaines de valeur agricoles. De plus, il s’agit également pour l’institution d’opérer un saut qualitatif en matière de gestion entrepreneuriale aux producteurs et transformateurs agricoles.
À terme, selon la programmation, dans chaque province du pays les nouveaux agri-preneurs devront à leur tour, apporter des conseils et des services appropriés en création et gestion d’entreprises agricoles aux jeunes porteurs de projets agricoles.
Au Gabon, la FAO promeut le développement des entreprises coopératives et l’agriculture familiale qui représentent des acteurs clés pour la diversification économique, la lutte contre le chômage et la pauvreté rurale.
Stéphane Billé
Des institutions internationales s’inquiètent du bas niveau de crédit accordé au secteur privé en zone Cemac
La rentabilité des banques de la zone Cemac ne profite pas à tous les pans de l’économie. Selon une récente analyse de la Banque de France, malgré leur rentabilité, le volume des crédits demeure faible dans l’ensemble. Pire, il reste très peu orienté vers le secteur privé pour bien financer l’économie.
Dans leurs opérations de crédits, les banques ont toujours privilégié les États ou les agents économiques qui leur sont liés ainsi qu’aux crédits garantis par l’État. Selon la Commission bancaire d’Afrique centrale (Cobac), cette stratégie est souvent amplifiée par le traitement préférentiel de ces actifs, dans le cadre des règles de supervision bancaire et par la présence de l’État au capital des banques locales.
Toujours dans ce procès fait aux banques, la Banque mondiale indique quant à elle qu’en 2018, le niveau du crédit au secteur privé en pourcentage du PIB dans l’ensemble reste bas. Il varie selon les pays de la sous-région. Il s’établit par exemple à 21,4 % au Congo ; 14,5 % au Cameroun ; 10,7 % en République centrafricaine et 9,8 % au Tchad. Des statistiques qui se révèlent bien en deçà de la moyenne des pays d’Afrique subsaharienne qui s’établit à 28,7 %. Il en de même des pays asiatiques de niveau de développement équivalent ou le niveau du crédit peut atteindre jusqu’à 80 % (Népal) ou 85 % (Cambodge).
Pour la Banque mondiale, la faiblesse du crédit envers le secteur privé s’explique par plusieurs facteurs. Il s’agit d’abord de la forte exposition au risque souverain. Il en est de même de la faiblesse du marché interbancaire qui ne permet pas de transferts efficaces des banques excédentaires vers les banques déficitaires de trésorerie. Une situation qui traduit clairement l’excédent structurel de liquidité des banques sous régionales. Il témoigne des difficultés de l’offre à rencontrer la demande.
En dernière analyse, les banques de la Cemac sont également accusées de souvent user des stratégies de financement traditionnelles au lieu de nouvelles techniques financières, à l’instar de la syndication qui permettrait une meilleure diversification des risques et un renforcement de leur exposition au secteur privé.
Stéphane Billé
La production gabonaise de caoutchouc continue sa tendance baissière observée depuis le début de l’année 2019
La production du caoutchouc du Gabon observe une tendance baissière depuis le début de l’année en cours. Selon les données du ministère de l’Économie. Même la mise en exploitation des plantations d’hévéa d’Olam Rubber, en début d’année, n’a pas permis de compenser la baisse enregistrée par l’ancien opérateur SIAT.
Ainsi au troisième trimestre 2019, le curseur de la production nationale en fonds de tasse, affiche 13 345 tonnes, contre 18 576 à la même période, il y a un an. Soit un repli de 28,2%. La même tendance est observée dans l’usinage du caoutchouc humide en granulés de 50 kg. Elle est passée de 10 313 tonnes au troisième trimestre 2018, à 6 302 tonnes au troisième trimestre 2019, soit une baisse de 38,9%.
Autre détail relatif à cette contreperformance, le repli des exportations de granulés. Du fait de la faiblesse des cours mondiaux, elles affichent 7 234 tonnes au cours de la période sous revue, contre 9 326 tonnes un an plus tôt. Soit une contreperformance de (-22,4%) qui induit également une régression du chiffre d’affaires de 14,5% à 6,1 milliards de FCFA.
Seul le nombre des effectifs est venu mettre du baume au cœur des exploitants de la filière. En effet, la mise en exploitation des plantations d’Olam a entrainé une forte hausse des effectifs de la filière (+118%) à 1 177 agents.
Stéphane Billé
Le FMI projette la croissance de la Cemac à 3,5% en 2020, si la Guinée Équatoriale et la RCA entrent sous programmes
Le Fonds monétaire international (FMI) vient de publier une note relative à ses entretiens annuels concernant les politiques communes de la Cemac (Cameroun, RCA, Congo, Gabon, Guinée Équatoriale et Tchad) et les politiques communes à l’appui des programmes de réforme des pays membres.
« À moyen terme, une nouvelle hausse des réserves régionales est prévue, en supposant que les pays de la Cemac restent attachés aux objectifs de leurs programmes et que de nouveaux programmes avec la Guinée Équatoriale et la RCA débutent bientôt. La croissance globale devrait accélérer à 3,5% en 2020, portée principalement par le secteur non pétrolier, qui devrait profiter de la mise en œuvre des stratégies gouvernementales d’apurement des arriérés », écrit le FMI.
L’institution ajoute que la croissance du secteur pétrolier de la zone resterait stable en 2020 avant de ralentir les années suivantes conformément aux tendances du passé. Au-delà de 2020, la croissance hors secteur pétrolier devrait s’accélérer progressivement, car il est supposé que les réformes visant à améliorer la gouvernance et le climat des affaires se mettent en place lentement. L’inflation devrait rester voisine de 2,5% à moyen terme, soit en deçà du critère de convergence régional, car la politique monétaire resterait à juste titre restrictive.
L’institution précise que pour 2019, la croissance régionale globale a été légèrement supérieure, à 2,5%, portée par une accélération dans le secteur pétrolier.
SA
Un mort et quatre personnes enlevées dans des attaques de pirates au large des côtes gabonaises
Jusque-ici épargnées par les actes de pirateries maritimes, régulièrement perpétrées dans le golfe de Guinée, les côtes gabonaises viennent d’être le théâtre de ces activités mafieuses.
Selon un communiqué du gouvernement gabonais, des attaques de pirates ont été perpétrées au large des côtes gabonaises, dans la nuit du 21 au 22 décembre 2019 contre quatre navires. Elles sont l’œuvre des individus non identifiés à bord d’embarcations rapides. Deux de ces bateaux appartiennent à une société sino-gabonaise, Sigapêche et l’autre est la propriété de la société Satram, spécialisée dans transport maritime et la logistique. Le dernier navire est un cargo.
Le bilan, selon le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, Edgard Anicet Mboumbou Miyakou (photo), fait état d’une perte en vie humaine. Il s’agit du commandant du navire de la société Satram, Mboumba Mbina Aymar. Quatre membres de l’équipage de la société Sigapêche, de nationalité chinoise, ont aussi été enlevés.
Au cours de cette sortie, le ministre Mboumbou Miyakou a également exprimé l’engagement des forces de défense et de sécurité à sécuriser la zone et rechercher les auteurs avec la collaboration d’Interpol et des organismes sous régionaux.
Une réunion de crise a également été initiée par le Premier ministre, Julien Nkoghe Bekale. Cela, aux fins d’exprimer la compassion à la famille du commandant Mboumba Mbina qui a perdu la vie et de rassurer les autres victimes de tout l’accompagnement des autorités du pays. Dans le même temps, une enquête judiciaire a été ouverte par le procureur de la République, près le tribunal judiciaire de première instance de Libreville.
Stéphane Billé
Sinohydro-Chongqing négocie le marché de construction du barrage hydroélectrique de Kinguele aval au Gabon
À la suite de l’appel d’offres international lancé en janvier 2018 pour la construction du barrage hydroélectrique de Kinguele Aval, le gouvernement gabonais vient de retenir l’offre de Sinohydro-Chongqing. Cette décision a été actée, le 19 décembre 2019, par Asonha Energie, détenue par Meridiam et Gabon Power Company (GPC, une filiale du Fonds gabonais d’investissements stratégiques [FGIS]).
Pour la suite du programme, Sinohydro-Chongqing et Asonha Energie ont entamé des négociations. Sinohydro-Chongqing, attributaire pressenti, pour la réalisation de ce chantier, est appelé à fournir les garanties acceptables par le maître de l’ouvrage, notamment en ce qui concerne les engagements environnementaux, sociaux et en termes d’intégrité, avant de se voir attribuer définitivement le marché.
Selon les termes du contrat, la société Asonha Energie assurera le financement, l’assistance technique et le suivi de l’exécution des travaux, suivant les termes du contrat de concession signé le 24 octobre 2019 avec la République gabonaise.
Pour rappel, le futur barrage hydroélectrique de Kinguele aval sera doté d’une capacité de 35 MW. Il sera construit sur la rivière Mbei, en aval de deux centrales hydroélectriques existantes, à savoir celles de Tchimbélé et Kinguélé. Il alimentera le réseau interconnecté de Libreville. En outre, ce projet vise à renforcer le pôle énergétique de la vallée de la Mbei [dans la localité de Kango, située à une centaine de km de Libreville], afin de répondre à la croissance de la demande en énergie.
Stéphane Billé
La BAD va investir 91,7 milliards de FCFA dans la construction d’infrastructures au Gabon, dont le pont frontalier avec le Congo
La Banque africaine de développement (BAD) va continuer à financer la première phase du projet d’appui au secteur des infrastructures (Pasig) au Gabon. L’accord d’un nouveau prêt d’un montant de 140 millions d’euros (91,7 milliards de FCFA) a été décidé lors de Conseil d’administration tenu à Abidjan (Côte d’Ivoire), le 19 décembre 2019.
Cette phase du Pasig concerne trois principaux chantiers : la construction et le bitumage de la section Ndendé-Doussala (49 km), la construction du pont frontalier entre le Gabon et le Congo, sur la rivière Ngongo, et la construction et le bitumage de quelque 21 kilomètres de voiries à Libreville.
Pour Racine Kane, directeur général adjoint de la banque pour la région Afrique centrale, ce projet revêt une importance capitale non seulement pour la banque, le Gabon et la sous-région Afrique centrale. « En contribuant aux efforts visant à relier le Gabon et le Congo par une infrastructure routière pérenne, praticable en toutes saisons, le projet permettra à la banque de consolider son rôle d’accompagnement dans la mise en œuvre du Plan directeur consensuel des transports en Afrique centrale adopté en janvier 2004 », a-t-il ajouté.
Autrement dit, le projet Pasig devrait ainsi faciliter les déplacements entre villes et communautés, en améliorant l’efficacité de la chaîne logistique de transport, en réduisant les coûts d’acheminement entre Libreville et Brazzaville, en améliorant les conditions de déplacement à Libreville et en contribuant à l’amélioration de l’accès des populations de la zone d’influence du projet aux infrastructures socio-économiques de base.
La nouvelle opération permettra de relier le sud du Gabon au Transgabonais, s’est pour sa part félicité Robert Masumbuko, représentant-pays de la BAD au Gabon. De plus, « c’est un projet inclusif qui concernera quelque 100 000 habitants, dont plus de la moitié sont des femmes », a-t-il souligné.
Dans le cadre de cette première phase du Pasig, en 2012, la BAD avait déjà approuvé un financement de plus de 250 millions d’euros (165 milliards de francs CFA), pour l’aménagement des sections Fougamou-Mouila, Ndendé-Lébamba et Laléyou-Lastoursville.
Stéphane Billé
Protection de la biodiversité : le Gabon et la RDC désormais liés par un mémorandum d’entente
Le Gabon et la République démocratique du Congo (RDC) sont désormais liés par un mémorandum d’entente pour la protection de la biodiversité. Il a été signé, le 19 décembre 2019, par le ministre gabonais des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l’Environnement, chargé du plan climat, des objectifs de développement durable et du plan d’affectation des terres, le Prof. Lee White, et le ministre congolais de l’Environnement et du Développement durable, Claude Nyamugabo Bazibuhe.
Le mémorandum d’entente pour la protection de la biodiversité a pour but de renforcer la coopération entre les deux pays, dans les domaines de l’environnement, la gestion durable des écosystèmes forestiers, l’industrialisation de la filière bois, la conservation et la gestion des aires protégées, ainsi que dans la lutte contre les changements climatiques.
Pour sa matérialisation, il est prévu la mise en place de programmes de renforcement des capacités techniques et scientifiques dans lesdits domaines au profit des États et des institutions partenaires.
Selon le Pr Lee White, cet accord réaffirme la volonté des chefs d’État gabonais (Ali Bongo Ondimba) et congolais (Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo) d’œuvrer pour le développement durable du bassin du Congo.
« Il y a beaucoup à gagner pour une exploitation contrôlée, une meilleure croissance économique et une bonne gestion durable des ressources forestières. La RDC pourrait bénéficier de l’expérience gabonaise dans ces domaines », a déclaré Claude Nyamugabo Bazibuhe.
Stéphane Billé
Les Nations unies et l’Union africaine saluent la réforme de la CEEAC, conduite par Ali Bongo Ondimba
Au lendemain de la tenue du sommet extraordinaire, des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), le chef de l’État gabonais, Ali Bongo Ondimba, a reçu en audience, ce 19 décembre 2019, le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et le représentant spécial du secrétaire général pour l’Afrique centrale, François Lounceny Fall.
Les échanges entre Ali Bongo et ses hôtes ont essentiellement porté sur des questions relatives à la réforme institutionnelle de la CEEAC, actée le 18 décembre dernier lors du sommet de chefs d’État, ainsi que sur l’agenda africain 2063. À l’occasion, Moussa Faki a rassuré le chef l’Etat gabonais du soutien de l’Union africaine à l’ensemble des réformes qui ont été mises en œuvre au sein de la CEEAC. Les questions liées à la sécurité de la sous-région et le dossier de la Zone de Libre-échange continentale ont également été abordés.
Avec François Lounceny Fall, il a également été question des résolutions de cette récente session extraordinaire du sommet des chefs d’État et de gouvernement de la CEEAC. Porteur d’un message du secrétaire général des Nations unies, António Guterres, François Lounceny Fall a aussi exprimé au chef de l’État gabonais, toute la satisfaction de l’Organisation des Nations unies pour la réussite de ce sommet extraordinaire de la CEEAC. Chemin faisant, il a également félicité Ali Bongo Ondimba, pour sa forte implication dans le pari gagné des réformes mises en œuvre pour hisser la CEEAC aux exigences de l’heure.
Stéphane Billé