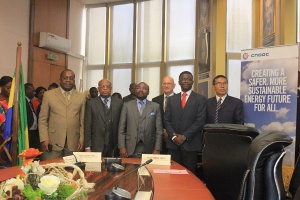Le Nouveau Gabon
Charges de la dette : le Gabon tient à seulement 54% de ses engagements au 3e trimestre 2019
Le ministère de l’Économie vient de publier le rapport d’exécution budgétaire pour le compte du troisième trimestre 2019. Selon ce document, sur les 255,6 milliards de FCFA, prévus pour les charges de la dette dans la loi de finances 2019, les règlements de l’État se sont globalement élevés à hauteur 139 milliards de FCFA pour le compte du 3e trimestre 2019, soit un taux de réalisation de seulement 54,4%.
Le niveau de règlement pour la période sous-revue reste inférieur à celui exécuté à fin septembre 2018 qui avait atteint 154,6 milliards de francs CFA, fait d’ailleurs observer le rapport.
Ces règlements comprennent 84,4 milliards de FCFA de charges d’intérêts sur la dette extérieure et 54,6 milliards de FCFA sur la dette intérieure.
Les intérêts sur la dette extérieure se répartissent en 15,8 milliards de FCFA sur la dette bilatérale ; 18 milliards de FCFA sur la dette multilatérale ; 42,1 milliards de FCFA sur la dette envers les marchés financiers et enfin 8,5 milliards de FCFA sur les intérêts banques commerciales.
Ceux de la dette intérieure se répartissent quant à eux, en intérêts intérieurs conventionnés pour 41,6 milliards de FCFA et ceux liés à la gestion de la trésorerie de l’État à hauteur de 13 milliards de francs CFA.
Au titre des intérêts sur la dette intérieure conventionnée, le gouvernement annonce 20,9 milliards de FCFA pour les banques ; 5,1 milliards de FCFA sur les moratoires et 15,6 milliards de FCFA sur les marchés financiers.
Au titre des charges de trésorerie de l’État, le ministère annonce 3,9 milliards de FCFA de facilités de caisse ; 8 milliards de FCFA sur les intérêts bons du trésor assimilables (BTA) et enfin 1,1 milliard de FCFA sur les autres frais bancaires.
Stéphane Billé
Hydrocarbures : Shell cède ses derniers actifs détenus au Gabon à Cnooc International
Shell se désengage totalement du Gabon. L’entreprise anglo-néerlandaise a cédé ses actifs (75%) dans deux blocs (BC 9 et BCD 10), situés au large de Port-Gentil, à son partenaire Chinois Cnooc International. Il s’agit de ses seuls intérêts au Gabon après la cession, en novembre 2017, de ses actifs pétroliers en exploitation au Britannique Assala energy pour 354,24 milliards de FCFA. On ignore pour l’instant le montant de la transaction.
À travers sa filiale africaine, Cnooc Africa Holding, le groupe chinois contrôle désormais à 100% les deux blocs dont l’un a notamment fait l’objet d’une importante découverte de gaz en eau profonde.
De ce fait, Cnooc Africa Holding et l’État du Gabon ont paraphé, le 26 novembre 2019, deux avenants aux contrats d’exploration et de partage de production (CEPP) qui liait précédemment Shell et son partenaire Cnooc International à la partie gabonaise.
Selon le ministre gabonais des Mines, du Pétrole, des Hydrocarbures et du Gaz, cet heureux dénouement est à inscrire à l’actif du nouveau code pétrolier. Le qualifiant de gagnant-gagnant à la fois, pour opérateurs et pour le gouvernement gabonais, Noël Mboumba a également précisé ce dispositif consacre le potentiel du bassin sédimentaire gabonais. Lequel a d’ailleurs été reconnu par les administrateurs de Cnooc Africa Holding.
Stéphane Billé
Le Gabon dans le top 3 des pays de la Cemac qui possèdent des devises dans les banques à l’extérieur
Selon les chiffres de l’Agence Ecofin compilés sur la base des données publiées par la Banque des règlements internationaux (BRI), les avoirs extérieurs non rapatriés des ménages et des entreprises non financières de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (Cemac) ont atteint 3,5 milliards $ (2043 milliards FCFA) à la fin du mois de juin 2019.
Dans le détail, les devises détenues par les ménages sont de 910,9 milliards FCFA (soit 44,6%) et celles des sociétés non financières se chiffrent à 1144,4 milliards (soit 56,4%).
La République du Congo est le pays dont les ménages disposent de la plus importante valeur des avoirs extérieurs à cette période (329,9 milliards FCFA). Il est suivi du Gabon (213,1 milliards FCFA), du Cameroun (204,4 milliards FCFA), de la Guinée Équatoriale (61,3 milliards de FCFA) et du Tchad (22,2 milliards de FCFA).
Les entreprises non financières installées au Cameroun détiennent la valeur la plus importante des avoirs financiers extérieurs non rapatriés (492,8 milliards FCFA). Elles sont suivies par celles du Gabon (367,8 milliards FCFA) et de Guinée Équatoriale (137,8 milliards FCFA).
Au total, les avoirs des individus et organisations résidant en zone Cemac dans le système bancaire international représentent la somme de 5,2 milliards $ (3036,3 milliards FCFA) à fin juin 2019.
Les données de la BRI ne permettent pas d’avoir des détails sur le type d’avoirs (prêts ou dépôts) avec précision. Mais elles mettent en exergue la difficulté qu’il y a à mettre en œuvre le renforcement de la politique de rapatriement de devises détenues par les résidents de la Cemac, en dehors du système de consolidation de sa Banque centrale.
La sous-région est parvenue à stabiliser l’équilibre extérieur de sa monnaie, mais devra poursuivre ses efforts dans ce sens, selon le communiqué final qui a sanctionné la rencontre extraordinaire des chefs d’État des pays membres.
À la période de référence, le Cameroun est le pays qui compte le plus d’avoirs financiers dans le système bancaire international (992,3 milliards FCFA). Il est suivi de la République congolaise (840,8 milliards FCFA) et du Gabon (770,7 milliards FCFA).
Pour expliquer cette situation, des experts proches de l’administration citent le besoin d’une plus grande flexibilité ou encore l’obtention de meilleurs rendements sur les placements. Mais l’absence de communication des gouvernements est de nature à semer la confusion au sein de l’opinion publique.
Idriss Linge
Les premières équipes de la 15e édition de la Tropicale Amissa Bongo sont connues
La liste des 13 premières équipes retenues pour la 15e édition de la Tropicale Amissa Bongo, qui se court du 20 au 26 janvier 2020, a été dévoilée ce 26 novembre 2019, par le comité d’organisation.
En attendant la désignation des deux dernières équipes dans les prochains jours, le plateau sportif de cette édition est provisoirement composé des équipes World Tour, UCI Continentale Pro et de 10 formations africaines.
La Team Cofidis sera la tête d’affiche. L’équipe française qui évoluera en première division mondiale revient au Gabon après son dernier passage en 2014.
Pour la 13e année consécutive Total Direct Energie de Jean-René Bernaudeau sera au rendez-vous. Une autre formation française, Delko-Marseille, prendra part à la compétition.
Pour la première fois, il y aura au départ deux équipes professionnelles africaines de la division Continentale UCI : les Sud-Africains de Pro-Touch et les Angolais de BAI-Sicasal. Ils s’ajouteront aux huit sélections nationales du continent.
Stéphane Billé
Au sommet de la Cemac, le président de la Bad exhorte les chefs d’État à rester « ambitieux » et à garder le cap des réformes
On en sait un peu plus sur le contenu de la communication spéciale du président de la Banque africaine de développement (Bad), Akinwumi Adesina, délivrée lors du huis clos des chefs d’État à l’occasion du sommet extraordinaire de la Cemac, tenu le 22 novembre à Yaoundé au Cameroun. L’institution financière africaine en a dévoilé quelques extraits.
Dans son adresse aux chefs d’État, « le président a relevé les signaux positifs pour la relance des économies de la sous-région même si d’importants défis restent encore à relever », rapporte la Bad. Aussi a-t-il exhorté les chefs d’État à rester « ambitieux » et à garder le cap des réformes.
Depuis trois ans, la Bad accompagne les pays de la sous-région dans la mise en œuvre des programmes convenus avec le Fonds monétaire internationale (FMI) en vue d’assurer une gestion macro-économique de qualité. Dans ce cadre, la Banque africaine de développement dit avoir déjà accordé des appuis budgétaires pour un montant de plus d’un milliard de dollars aux pays de la Cemac.
Lors de sa communication spéciale, le Nigérian a par ailleurs présenté les outils essentiels utilisés par la Banque pour accélérer la croissance et le développement dans la région. Il a ainsi indiqué que le portefeuille de la Bad en Afrique centrale s’élève à plus de 6 milliards de dollars américains.
Le président de l’institution financière africaine a, en plus, assuré que « la création d’un bureau régional et le lancement du nouveau Document de stratégie pour l’intégration régionale (DSIR) pour la période 2019-2025 permettront certainement à l’institution d’être plus proche des pays de la Cemac et de répondre à ses besoins ».
Stéphane Billé
Grâce à un prêt de la Bad de 49,5 milliards de FCFA, le Gabon va permettre à 400 000 ménages d’avoir accès à l’eau potable
Le Premier ministre, Julien Nkoghe Bekale, a lancé, le 25 novembre 2019, le Programme intégré pour l’alimentation en eau potable (Piaepal). L’un de ses objectifs est de réduire les pénuries d’eau à Libreville, dans la capitale gabonaise.
En effet, dans sa sous-composante « eau potable », le projet vise entre autres le renforcement des capacités institutionnelles du secteur de l’alimentation en eau potable ; le renforcement et l’extension de 280 kilomètres du réseau d’eau potable dans les communes de Libreville, Akanda, Owendo et Ntoum ; l’augmentation de la capacité d’eau disponible pour les populations, la lutte contre les fuites et l’harmonisation des installations.
La mise en œuvre du Piaepal devra se traduire par une augmentation de la capacité de production et de stockage de l’eau potable et, in fine, pallier à la pénurie constatée dans la capitale et ses environs. Elle devrait également porter le taux de rendement du réseau de distribution du Gabon de 52% à 80%. Ce qui permettrait à 400 000 ménages de plus d’avoir accès à l’eau potable à travers le pays.
Pour le ministre de l’Énergie et des Ressources hydrauliques, Emmanuel Norbert Tony Ondo Mba, « ce programme va contribuer à assurer une meilleure qualité de la desserte en eau potable à travers un taux de rendement supérieur du réseau de distribution et le renforcement de la capacité des différents acteurs du secteur eau ».
D’un coût de 77 milliards FCFA, le projet sera financé à hauteur de 49,5 milliards de FCFA par la Banque africaine de développement (Bad). Selon le représentant-résident de la Bad au Gabon, Robert Masumbuko, les travaux, qui démarrent au mois de mars 2020, devraient s’achever en juin 2023.
« Les réalisations envisagées dans le cadre de ce vaste programme émanent de l’ambition du président de la République, Ali Bongo Ondimba, de garantir à l’horizon 2025 un accès durable à l’eau potable et à l’assainissement dans un cadre de vie sain et amélioré sur l’ensemble du territoire national », a indiqué le Premier ministre.
Stéphane Billé
Le pétrolier néerlandais One Dyas conserve ses droits de production dans le projet Kowe au Gabon jusqu’en 2036
One Dyas a conclu un accord avec le gouvernement gabonais. Cet accord permet à la société pétrolière néerlandaise de conserver ses droits dans la production du projet Kowe jusqu’en 2036 et lui donne la possibilité d’y augmenter ses intérêts. Le projet Kowe est cogéré avec le producteur franco-britannique Perenco.
Au terme des négociations, la société indique qu’un régime fiscal spécial sera désormais appliqué aux opérations du bloc offshore, sans en préciser la teneur.
Le bloc Kowe est situé à environ 20 kilomètres au large des côtes du Gabon, par une profondeur d’eau de 100 mètres. Il abrite trois champs : Tchatamba Marin, Tchatamba Sud et Tchatamba Ouest qui sont regroupés dans le complexe Tchatamba. Quatre ans se sont écoulés entre la découverte et le développement pour un début de la production en 1998.
Le pic de production de 43 000 barils par jour y a été atteint en 2001. Très peu d’informations sont disponibles sur le niveau actuel de la production. Toutefois, la société a fait savoir que la production de l’ensemble de son portefeuille (au Gabon et en mer du Nord) s’établit à 35 000 bep/j. Cela suggère que Kowe est devenu un projet marginal.
Olivier de Souza
Lire aussi :
16/12/2012 - Gabon : Perenco confirme une pollution pétrolière offshore « rapidement nettoyée »
Entre janvier et août 2019, les États de la Cemac sollicitent le marché local des capitaux pour près de 1982 milliards FCFA (+92%)
Entre janvier et août 2019, les États membres de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale (Cemac) ont sollicité le marché des capitaux de la sous-région à hauteur pour 1982 milliards FCFA, pour le financement de leurs économies, a appris l'Agence Ecofin d'un document récent publié par la Banque centrale. Cela représente une progression de 92%, en comparaison aux sollicitations effectuées pour la même période en 2018.
Cette évolution est conforme aux nouvelles orientations en matière de financement public dans la Cemac. Elles imposent aux États de s'adresser au marché des titres publics émis par adjudication pour avoir de la trésorerie courante plutôt que d'attendre des avances de trésorerie de la Banque centrale. Mais les choses se mettent en place assez progressivement. L’année 2019 a surtout été marquée par une forte augmentation des émissions des titres à moyen et long termes (obligations du Trésor).
Alors qu'entre janvier et août 2018, seul le Gabon avait émis ces instruments pour un peu plus de 62 milliards FCFA, il a été rejoint cette fois par trois autres pays, notamment le Congo, la Guinée Équatoriale et le Cameroun. Ce qui a porté le total des émissions sur ce compartiment à 573,3 milliards FCFA. Ainsi les titres ayant moins d'un an de maturité dominent encore sur ce marché avec une préférence pour ceux qui sont remboursés dans les délais situés entre 13 et 26 semaines.
Cette pression de la demande des pays membres de la Cemac pour les ressources du marché des capitaux de la sous-région a eu pour conséquence, une hausse des taux moyens qui sont passés de 4,48% à 4,61% pour les 8 premiers mois de l'année 2018. Cette hausse est appréciée par les banques commerciales qui participent à ces différentes opérations. En effet, les établissements de crédit qui mobilisent leurs ressources via les appels d'offres de la Banque centrale ne payent à cette dernière qu'un taux de 3,5%.
Par contre, on a noté qu'échanger les titres sur le marché secondaire est devenu moins rentable, avec un rendement sur les bons du Trésor de seulement 5,02% contre 5,91% au cours de la même période en 2018. Avec l'engagement de la Beac de poursuivre avec sa stratégie monétaire restrictive et la fin des programmes économiques avec le FMI pour certains pays, il est fort probable qu'on assiste à une hausse des émissions de titres publics par adjudication dans la sous-région.
Idriss Linge
Les pays de la Cemac s’arment contre la chenille légionnaire d’automne
Un atelier sous régional de formation, pour la gestion intégrée de la Chenille légionnaire d’automne (CLA) dans les pays de la Cemac, se déroule à Franceville au Gabon du 26 novembre au 1er décembre 2019.
Il est organisé et financé par le bureau de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour l’Afrique centrale. Il consiste à renforcer les connaissances sur ce ravageur à travers l’approche champs-école-paysans, la conduite en laboratoire et dans les champs de maïs de même que des exercices pratiques. Outre sa dimension pédagogique, cet atelier permettra d’élaborer et de mettre à disposition des supports de formation et des stratégies de gestion de cette chenille.
Il est à noter que cet atelier vient en complément des activités du projet « Assistance d’urgence pour la détermination de la répartition géographique et l’évaluation de l’incidence de la chenille légionnaire d’automne ». Lequel vise à apporter un appui pour faire face à ce phénomène en zone Cemac.
Ces travaux verront la participation d’une trentaine de délégués venant des ministères en charge de l’Agriculture et de la Recherche agricole du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la Guinée Équatoriale, de la République centrafricaine, de la République Démocratique du Congo, de Sao Tomé & Principe et du Tchad.
Pour rappel, la chenille légionnaire d’automne (Spodoptera frugiperda) est un ravageur endémique des cultures du continent américain apparu en Afrique en 2016. Compte tenu de ses dégâts et de sa grande capacité de dispersion sur les plantes hôtes, il constitue une menace de grande ampleur pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, en particulier pour le maïs qui est la culture la plus attaquée.
Stéphane Billé
Les fonds propres libres de la Beac chutent de 52% en 2018
Selon des documents officiels obtenus par l’Agence Ecofin en marge du sommet extraordinaire des chefs d’État de la Cemac, les fonds propres libres de la Banque des États de l’Afrique centrale (Beac) sont en baisse. En 2018, ces réserves libres ont chuté de 52%.
Deux principales raisons sont présentées pour justifier cette situation. D’une part, la Beac, qui envisage de renforcer sa coopération déjà existante avec des acteurs financiers internationaux, a optimisé le mode de calcul de son exposition sur les États. Ce changement a conduit la Banque centrale à comptabiliser comme perte près de 212 milliards FCFA de créances détenues sur les trésors publics nationaux. D’autre part, les placements effectués par l’institution sont arrivés pour une grande majorité à échéance et les plus-values qu’ils généraient ne sont plus possibles.
Les résultats financiers de l’institution pour l’année 2019 devraient apporter plus de détails et de précisions. Mais les responsables de la Banque centrale estiment qu’un recouvrement des fonds propres libres à leur niveau d’avant 2018 reste assez difficile. Et cela du fait de la baisse des revenus tirés des avoirs extérieurs. Conformément à ses statuts, la Beac est en effet contrainte d’investir sur des produits financiers portant de fortes garanties.
Le défi est que ce type de produits financiers, localisé sur des marchés développés, est tellement sollicité par de nombreux investisseurs que ses rendements ont baissés. Pour l’institution, il est question de travailler en urgence sur ce problème.
La Beac est encore sollicitée par certaines institutions de la Cemac pour résoudre leurs problèmes de financement. En plus, elle a besoin de rassurer les États qu’elle peut les accompagner efficacement sur le placement de leurs avoirs extérieurs nets excédentaires.
Idriss Linge