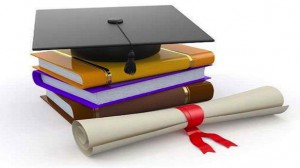Le Nouveau Gabon
L’Etat circonscrit le champ de la subvention des produits pétroliers
Selon Pascal Houangni Ambouroue (photo), ministre du Pétrole, du Gaz et des Hydrocarbures, les marges de manœuvre de l’Etat en matière de subvention des produits pétroliers se sont amenuisées depuis des années.
Mais dans l’optique de préserver et maintenir la paix sociale et de contenir les variations des cours du baril de pétrole en chute libre depuis 2014, bien que l’on ait noté une évolution positive en fin d’année 2018, l’Etat a décidé de ne plus subventionner que le gaz domestique et le pétrole lampant, cette année.
La mesure qui découle des orientations budgétaires édictées par les bailleurs de fonds, notamment le FMI, procède de la poursuite de deux objectifs.
Dans un premier temps, d’après le ministère du Pétrole, il est question, entre autres, de dégager des recettes additionnelles pour le financement des chantiers du gouvernement, à l’instar de la construction des infrastructures et des équipements sociaux de base ; assurer la gratuité de l’accouchement ou encore le règlement de la masse salariale…
Le gouvernement, à travers cette option, veut aussi faire face à la baisse continue de la production pétrolière nationale passée de 240 000 barils en 2014, à moins de 200 000 barils en 2019 au quotidien.
Du coup, souligne le ministre du Pétrole, l’Etat ne peut donc « plus subventionner les liquides blancs, excepté le gaz butane et le pétrole lampant ». Car, s’agissant du gaz domestique par exemple, la vérité des prix fait ressortir un coût réel de 10 000 FCFA pour la bouteille de 12,5kg de butane, mais l’Etat supporte 4050 FCFA et la met en vente au prix de 5950 FCFA.
Le pétrole lampant vendu à la pompe à 395 FCFA est subventionné à hauteur de 105 FCFA par l'Etat.
Pour mémoire, les subventions des produits pétroliers ont dépassé la barre de 220 milliards FCFA en 2013. Celles du gaz domestique et du pétrole lampant étaient plafonnées à 9 milliards FCFA.
PcA
La société camerounaise Hydrac vend son expertise dans la lutte contre la fraude sur les produits pétroliers au Gabon
Des responsables de la société Hydrocarbures Analyses et Contrôles (Hydrac), basée à Douala au Cameroun, viennent de séjourner au Gabon dans le cadre d’un partenariat multisectoriel. Il s’agit, selon le ministère gabonais du Pétrole, du Gaz et des Hydrocarbures, d’accompagner l’Etat dans la construction des pipelines et le marquage chimique des produits pétroliers.
En fait, il est question pour la société camerounaise, filiale de la Société nationale des hydrocarbures en charge du contrôle et de la qualité des produits pétroliers, de proposer son expertise dans la lutte contre la fraude sur les produits pétroliers en circulation dans le pays.
Celle-ci concerne, entre autres, les entrées frauduleuses des produits blancs dans le pays et les mélanges de ces derniers, à l'origine de la mauvaise qualité de ce qui est commercialisé en Afrique de manière générale.
Pour y parvenir, Hydrac propose le marquage chimique des produits blancs commercialisés dans les stations-service.
Le partenariat sollicité par la société camerounaise avec l'Etat gabonais a trouvé un écho favorable auprès des autorités qui ont apprécié la dynamique d'échange d'expertises.
PcA
Selon la présidence de la République, la facture actuelle des importations de produits alimentaires représente 400 milliards FCFA
Cette année, la présidence de la République tire la sonnette d’alarme au sujet des importations de denrées alimentaires. Celles-ci, d’après l’institution, représentent 400 milliards FCFA, actuellement.
Le pays, s’agissant des vivres, importe par exemple 600 000 tonnes de bananes-plantain du Cameroun. Pour les viandes animales, les statistiques de la direction générale des douanes et des droits indirects indiquent que 122,5 millions de tonnes de viandes animales sont importées en moyenne d’Amérique et d’Asie.
Ces statistiques montrent dans le détail que 24,2 millions de tonnes de découpes de viande de bœuf, plus de 10 millions de tonnes de viande porcine et 87,7 millions de tonnes de viande de poulet ont été nécessaires à l’alimentation d’environ 2 millions de personnes.
L’année dernière, par exemple, au cours du forum économique organisé en partenariat avec la Banque islamique de développement (Bid), le gouvernement avait annoncé que les importations de denrées alimentaires du pays s’établissaient depuis un moment à 1,5 milliard de dollars, soit 800 milliards FCFA.
Pour le gouvernement, cette situation contribue à réduire les réserves de change du pays et accentue l’exportation des emplois dans le secteur agricole.
Notons que l’objectif des autorités demeure la réduction de moitié de cette facture, à l’horizon 2020.
PcA
De nouveaux textes de la COBAC vont réguler les activités autour de la monnaie électronique
Deux nouveaux textes sont en préparation par la Commission Bancaire d'Afrique Centrale (COBAC), en vue de compléter la régulation déjà existante, des activités d'émission et de paiement de monnaie électronique. L'un des textes consiste à définir les normes prudentielles qui seront applicables aux établissements de paiement.
La montée en puissance des porte-monnaies via le mobile, a vu se créer une multitude d'acteurs non bancaire, dont les activités sont soit de collecter des dépôts d'argent, soit de permettre des retraits d'argent depuis les téléphones portables. Si cela a contribué à la généralisation du mobile money, il subsiste néanmoins un risque latent que le régulateur bancaire de la CEMAC veut anticiper.
Avec ce projet de régulation qui est d'ordre prudentiel, on devrait s’attendre désormais à ce qu’il faille immobiliser un certain montant d’argent en fonds propres, pour exercer cette activité. Il existe en effet un risque, qu'une situation de faillite ou de détournement, pousse un établissement à ne plus honorer ses engagements de paiements. Une situation qui pénaliserait aussi bien les déposants que les émetteurs de monnaie électronique.
Ce risque concerne aussi les prestataires de services de paiement autre que les établissements de paiement, qui vont de la petite PME à des individus dans des quartiers. Sur ce deuxième point aussi, un texte est en cours de préparation, en vue de réguler les obtentions d'agréments et leurs modifications de statuts.
Les nouveaux textes pourraient redistribuer les cartes dans le secteur, notamment du mobile money, qui a mis à mal les opérateurs classiques de transfert d'argent que sont au Cameroun Express Union et Express Exchange. L'obligation de disposer d'un matelas de fonds propres en couverture des risques potentiels, pourrait exclure de nombreuses personnes qui proposent ce service en tant qu'individus, et repositionner les leaders déchus, notamment avec l’introduction prochaine de l’interopérabilité dans la sous-région.
Selon un récent rapport de la BEAC, le volume d'argent circulant dans les comptes de mobile money, et non encore décaissé, a atteint à la fin 2018, l'encours de 125,7 milliards de FCFA, soit trois fois son encours de la fin 2016. Aussi, le nombre d'utilisateurs actifs de services de monnaie électronique a atteint les 6,7 millions. Enfin, la valeur des transactions de monnaie électronique a atteint les 8300 milliards de FCFA, soit 7 fois le montant de 2016.
Idriss Linge
Le gouvernement fixe l’âge limite d’obtention de la bourse pour les séries techniques et professionnelles à 27 ans
Au cours du Conseil interministériel tenu le 11 avril dernier, le gouvernement est revenu sur le délicat dossier d’attribution des bourses.
Dans la panoplie de projets de textes législatifs et réglementaires qui étaient soumis à l’appréciation des membres du gouvernement, celui émanant du ministère de l’emploi, de la jeunesse, de la formation professionnelle, de l’insertion et de la réinsertion, a retenu une attention particulière.
En effet, il a décidé que l’âge limite retenu, pour prétendre à l’obtention d’une bourse dans les séries techniques et professionnelles, est désormais fixée à 27 ans. Ce projet de décret devrait être adopté lors du prochain Conseil des ministres.
Selon le gouvernement, « c’est un changement de paradigme. L’Etat favorise davantage les études professionnelles et techniques. Cela va changer puisque l’Etat va encourager les jeunes gabonais à embrasser les filières de l’enseignement où il y a des métiers plus techniques et professionnels ».
Pour ce faire, l’on indique qu’il faudra au préalable adapter les curricula en misant sur la formation en fonction des métiers qu’offre le marché national de l’emploi.
Stéphane Billé
Karine Arissani en VRP de l'Association africaine des offices et agences de tourisme à Brazzaville
C’est en sa qualité de Secrétaire générale de l'Association africaine des offices et agences de tourisme (AONT), la Directrice générale de l’Agence gabonaise de tourisme (AGATOUR), que Karine Arissani vient d’effectuer une mission de promotion de cette organisation au Congo.
Dans le cadre de cette démarche, Karine Arissani a eu des séances de travail avec les autorités congolaises en charge du tourisme. Notamment la ministre du Tourisme, des Loisirs et du Développement durable, Soudan Nonault ainsi qu’avec les Directeurs généraux de l'Office de promotion et de l'industrie du tourisme (OPIT), de la Direction générale du tourisme et de l'hôtellerie (DGTH), et enfin avec celui en charge des études et de la planification.
Avec ces principaux responsables, la Dg de l’AGATOUR a décliné les fondamentaux, les statuts, le compte rendu de la dernière réunion et le règlement intérieur de l’AONT, avec la sollicitation In fine, l'adhésion du Congo à cette plateforme.
Manifestant l’intérêt et l’enthousiasme de recevoir ses hôtes, Mme Soudan Nonault a, dans un premier temps, louer l'initiative de la création de l'AONT, avant de confirmer l’intérêt de son pays pour cette initiative.
Elle a également saisi cette occasion pour dresser un tableau synoptique des différents chantiers de son département ministériel et faire des suggestions pour le bon fonctionnement de l'association.
Au final, le membre du gouvernement congolais a donné son accord de principe pour l'adhésion de son pays à l'AONT. Elle a également promis qu'une délégation de son pays prendra part à la réunion de haut niveau qui se tiendra, à cet effet, très prochainement à Abidjan, en marge du Salon international du tourisme (SITA). Cette rencontre s’est achevée par un échange de présents.
Stéphane Billé
Le ministre Biendi Maganga Moussavou entend réduire la dépendance alimentaire extérieure du Gabon à 50%, à l’horizon 2022
Comment sortir le pays de sa très forte dépendance alimentaire extérieure ? Les autorités gabonaises ne sont nullement en panne d’initiatives. La dernière en date est celle que vient de proposer le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, de l'Alimentation et de la mise en œuvre du Programme Graine, Biendi Maganga Moussavou (photo).
En effet, la dernière trouvaille du ministre Biendi Maganga Moussavou porte sur le développement de l’agro-industrie moderne et la mise en place de Zones agricoles à forte productivité (ZAP). En vue de l’implémentation de cette stratégie, des sites de positionnement ont déjà été retenus pour la première phase.
Ainsi, les localités de Kango et Ntoum pour l’Estuaire seront spécialisées dans les chaînes de valeur du Poulet, Porc, Mouton et produits vivriers ; Franceville dans le Haut-Ogooué fera dans les chaînes de valeur relatives aux plantes à tubercule, autres cultures vivrières, et poulet ; Bitam, dans le Woleu-Ntem, sera spécialisée dans le café-cacao, l’hévéa, le palmier à huile et Idemba dans la Ngounié, va s’appesantir sur la production du riz, maïs et soja.
L’objectif visé est d’atteindre une production végétale de 20 000 tonnes de riz à l’échéance 2020-2021, 200 000 tonnes pour le maïs et soja en 2022. Dans le même temps, la production animale visée est de 51 000 poulets de chair en 2022 et près de 18 000 porcs, 40 000 Bovins et 100 000 Caprins et Ovins, d’ici 2021.
Ce dispositif sera complété par la mise en place d’un Laboratoire de sécurité alimentaire avec un spectre large d’analyses biologiques, et des structures de transformation et de stockage des produits agricoles. Ainsi que par l’implantation de l’Agence du développement agricole du Gabon (ADAG) sur le site historique du Centre d’appui technique à l’hévéa culture (CATH) situé à Akanda, au nord de Libreville.
Quant à la valeur ajoutée de cette stratégie, le ministre Biendi Maganga Moussavou a indiqué qu’elle « tire des nombreux enseignements des précédents essais. Elle a pour mérite de regrouper l’expertise des bailleurs de fonds, de la FAO, de celle acquise par l’ensemble des fonctionnaires du ministère et la volonté du secteur privé auquel nous donnons une place prépondérante dans le succès de ce que nous sommes en train de faire ».
Avec des dépenses évaluées, chaque année, à plus de 450 milliards FCFA pour l’importation des denrées alimentaires, le patron de l’agriculture gabonaise a révélé que cette nouvelle stratégie agricole permettra de réduire cette dépendance de 50%, à l’horizon 2022.
Stéphane Billé
Igor SIMARD prend les rênes de l’Autorité administrative de la ZES de Nkok
Nommé lors du Conseil des ministres du 29 mars dernier, Igor SIMARD (photo à droite), le nouvel administrateur général de l’Autorité administrative de la Zone économique spéciale (ZES) de Nkok, a pris officiellement ses fonctions, le 9 avril dernier. C’était à la faveur d’une cérémonie de passation de charges entre lui et son prédécesseur, Gabriel Ntougou, présidée par le secrétaire général du ministère de l'Economie, de la Prospective et de la Programmation du développement, chargé de la Promotion des investissements, Jeannot KALIMA.
Selon des données déclinées par l’administrateur sortant, le nouvel administrateur Igor Simard prend les rênes d’un complexe industriel performant. En effet, cet espace économique, fleuron du processus d’industrialisation et de la diversification de l’économie gabonaise, qui s’étend sur 1 126 hectares, compte aujourd’hui, près de 90 entreprises en production, avec plus de 4 000 emplois.
Grâce au développement de cette zone, le Gabon occupe désormais la première place en Afrique et la cinquième dans le monde, des producteurs de placage. Sa production représente 38% des containers exportés, pour un chiffre d’affaires qui atteint déjà 130 millions de dollars l’année (exportations de bois uniquement). Selon les chiffres officiels, depuis sa création en septembre 2011, la ZES de Nkok a capté près de 200 milliards de francs CFA d’investissements directs étrangers.
Autre détail et pas des moindres, la ZES de NKOK exporte 521 containers chaque mois, soit 1/3 des exportations nationales, avec à la clef, plus de 3 000 emplois déjà créés. En termes d’ambitions, elle envisage atteindre un chiffre d’affaires de 900 milliards FCFA en 2020.
Au terme de son installation, le nouvel administrateur a rendu hommage au chef de l’Etat, Ali Bongo pour la confiance portée en sa personne. Avant de promettre de miser sur le dialogue de gestion, pour l’atteinte des objectifs assignés à la ZES.
Originaire de l’Ogooué-Ivindo, Igor Simard a été conseiller du président de la République de 2011 à 2016. Avant sa nomination, il était administrateur et directeur général du Fonds national pour le développement du sport (FNDS).
Stéphane Billé
Au Gabon, les dépenses de personnel ont atteint un taux d’exécution de 107% en 2018
Les dépenses de personnel publiées dans le Rapport d’exécution budgétaire (REB) au 4ème trimestre 2018 ont représenté un montant de 684,3 milliards FCFA. Soit un taux d’exécution de 107%, au regard de la prévision de 640,8 milliards FCFA pour l’année.
Dans cette catégorie de dépenses, la solde permanente a représenté 625,5 milliards FCFA, soit 91% du poids de l’ensemble. Quant aux autres éléments de rémunération, à savoir : les rémunérations autres catégories de salariés, les Primes et indemnités, ils se sont élevés à 58,6 milliards FCFA, soit 94,6% de la prévision.
Par ailleurs, il est constaté une baisse des effectifs de près de 2582 agents publics de 2017 à 2018, soit une diminution de près de 2,4% des effectifs des agents de l’Etat.
Selon le ministère du Budget et des Comptes publics, cette diminution s’explique par la décision du gel des recrutements en 2017, le contrôle des effectifs et la mise à la retraite systématique des agents.
Quant aux dépenses liées aux biens et services, prévues à 315,1 milliards FCFA, elles ont été ordonnancées à hauteur de 234,3 milliards FCFA, pour un niveau de règlement de 204,2 milliards FCFA, soit un taux d’exécution de 64,8% par rapport à la LFR.
A fin décembre 2018, les paiements effectués sur ce titre hors remboursement de TVA se sont élevés à 154,5 milliards FCFA, soit un taux d’exécution de 62%.
Les remboursements de TVA et les attributions de produits ont été exécutés respectivement à hauteur de 49,7 milliards FCFA (75,7% en taux d’exécution) et 44,9 milliards FCFA (65,6% en taux d’exécution).
Stéphane Billé
Le Gabon et la France renforcent leur coopération militaire
Une délégation d’officiers des Forces et de défense françaises conduite par le général d’armée, François Lecointre, par ailleurs chef d’état-major des armées françaises a été reçue en audience, ce 11 avril 2019 par le premier ministre, Julien Nkoghe Bekale.
Cette visite s’inscrivait dans le cadre du renouvellement et du renforcement du partenariat de défense entre le Gabon et la France. De manière précise, « l’objectif de cette séance est de travailler ensemble sur les perspectives de l’évolution de notre partenariat. Un partenariat très important, très fort qu’il faut que nous continuions de faire évoluer pour le renforcer encore plus, afin de le rendre plus opérationnel pour que la France et le Gabon participent côte à côte à la stabilisation de l’Afrique centrale en proie à des vives tensions », a indiqué l’officier supérieur français.
Selon des sources proches de la primature, « ce renouvellement passerait notamment par la concrétisation d’un certain nombre de projets, notamment l’équipement des troupes gabonaises appelées à exercer en République centrafricaine, entre autres».
Julien Nkoghe Bekale qui était pour la circonstance entouré de la ministre d’Etat gabonais à la Défense, Rose Christiane Ossouka Raponda, de l’ambassadeur de France au Gabon, Philippe Autié, du chef d’état-major des Forces armées gabonaises, le général d’armée Ferdinand Gaspard Olame Ndong et des officiers supérieurs des armées gabonaises, s’est réjoui de cette visite. Laquelle visite, a-t-il indiqué, « vient renforcer les liens d’amitié et de coopération existant si heureusement entre la France et le Gabon. Des liens que les deux pays ont redynamisé avec la signature d’un traité instituant un partenariat de défense entre les deux pays le 24 février 2010 ».
Par la même occasion, le PM gabonais a « demandé à son hôte d’œuvrer en collaboration avec les Forces de défense et de sécurité gabonaises à la redynamisation de ce partenariat stratégique ».
Stéphane Billé