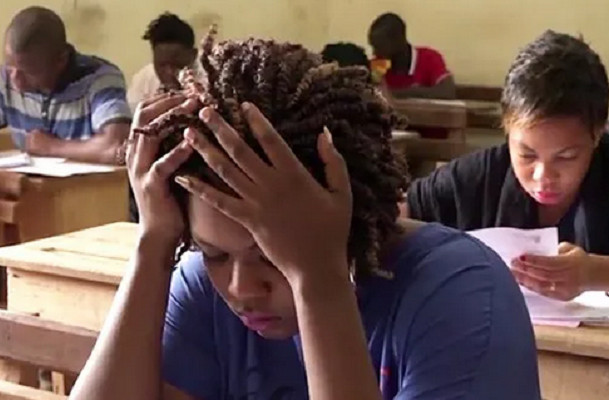Le Nouveau Gabon
Mouila: le procureur présente les premiers éléments de l'enquête sur la mort de Glenn Moundende
Le parquet de Mouila a ouvert une enquête sur la mort de Glenn Moundende Patrick, un présumé preneur d'otage, tué par balles par les forces de sécurité à Mouila. L’information est donnée par Roger Daniel Nguema Ondo, procureur de la République près le Tribunal de Première instance de Mouila, dans une déclaration ce 25 juillet 2023.
Les premiers éléments de cette enquête ouverte révèlent que les blessures occasionnées ne sont que la riposte des agents des forces de l’ordre face à son refus d’obtempérer. Ce, malgré toutes les « négociations » entreprises « même par le biais de ses parents », regrette le procureur de la République près le Tribunal de Première instance de Mouila.
Selon ce dernier, tout a commencé le 18 juillet 2023 à Mandji Ndolou dans la province de la Ngounié. Le jeune Glenn Moundende, armé d'un fusil de type calibre 12, a procédé à l’enlèvement de deux employés de la société Addax Petroleum, puis, les a conduits dans une forêt avoisinant le site.
Le 19 juillet 2023, autour de minuit, pendant la patrouille effectuée par des gendarmes pour retrouver et de libérer les deux otages, l’un des gendarmes a reçu des coups de feu au niveau du genou gauche, tiré par Glenn Moundende, relate le procureur de la République près le Tribunal de Première instance de Mouila. Ce gendarme a été évacué à Port-Gentil pour une opération chirurgicale à la suite des blessures occasionnées. Au cours de cette intervention, les deux employés ont été retrouvés sains et saufs.
Le lendemain, autour de 6 heures du matin, Glenn Moundende va faire irruption cette fois, sur le site de Perenco où il va enlever une employée de la société avec qui il s’est réfugié pendant plus d’un jour dans une forêt proche du site pétrolier. « Celle-ci a finalement été libérée dans la nuit du 20 juillet 2023 à la suite d’une autre patrouille en état de choc psychologique. Elle a été transportée à Port-Gentil pour une prise en charge, et a déclaré avoir été victime de violences sexuelles », poursuit-il.
Par la suite, le ravisseur est rattrapé par les forces de l’ordre le 21 juillet 2023 en forêt. Au cours de son interpellation, celui-ci a été grièvement blessé et conduit aussitôt dans une structure sanitaire à Lambaréné où son décès a été constaté, relate Roger Daniel Nguema Ondo.
Suite à ce drame, le chef de l’État, Ali Bongo Ondimba, s’est rendu à Port-Gentil, chef-lieu de la province de l’Ogooué Maritime, où il a rencontré les deux gendarmes blessés au cours de l’opération ainsi que l’une des otages séquestrées durant 48 heures. « Son témoignage, poignant, m'a profondément touché, de même que son courage et sa dignité malgré la dureté de l'épreuve », a commenté le chef de l’Etat sur Facebook.
Indignation
Ce drame a suscité une indignation collective au Gabon. Plusieurs Gabonais auraient souhaité que Glenn Moundende soit arrêté vivant. Pour des opposants au régime à l’instar du président du Parti social-démocrate (PSD), Pierre-Claver Maganga Moussavou, c’est un « assassinat ». Pour lui « abattre un concitoyen même armé, surtout que vous avez réussi à le désarmer… est une lâcheté ».
Des réactions et bien d’autres qui n’ont pas tardé à faire réagir, notamment sur Twitter et sur Facebook la présidence de la République et des membres du gouvernement qui accusent l’opposition d’instrumentalisation, étant donné que cet incident intervient dans un contexte électoral. « Il est impératif pour chacun d’entre nous de dénoncer fermement la manipulation perverse qui glorifie une agression sexuelle et une prise otage comme un acte héroïque. Ce n'est pas une histoire à célébrer, mais une atrocité à condamner. Que justice soit rendue aux victimes et que de tels actes abominables ne soient jamais glorifiés », s’est indigné le ministre de la Communication et Porte-parole du gouvernement, Rodrigue Mboumba Bissawou.
Dans la même veine, Jessye Ella Ekogha, Porte-parole du président de la République critique les agissements de certains hommes politiques dans cette affaire. « Au nom de petits calculs personnels, certains n'hésitent pas à souffler sur les braises de la violence et monter la population contre ceux chargés de les protéger. C'est dans ces situations que l'on distingue l'homme d'État du politicien, le responsable de l'irresponsable ».
Pour sa part, le procureur de la République près le Tribunal de Première instance de Mouila, invite les populations à ne pas se laisser « impressionner » par des déclarations visant à dénaturer les faits. L’enquête ouverte permettra certainement d’établir les responsabilités de chacun.
SG
Présidentielle 2023 : le meeting de Barro Chambrier perturbé à Franceville par un groupe de jeunes
Le Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) a condamné ce 24 juillet 2023, la perturbation du meeting de son candidat Alexandre Barro Chambrier dans un domicile privé à Franceville dans la province du Haut-Ogooué la veille.
« Le RPM condamne avec la dernière énergie les agissements grossiers, d’un autre âge, des commanditaires de ces exactions tapis au sein d’un pouvoir à bout de souffle usant de violence et de l’intimidation pour masquer son échec à la tête du pays, alors qu’il gagnerait à présenter son bilan au peuple gabonais après quatorze ans à la tête du pays », a fustigé le RPM dans un communiqué signé de son 1er vice-président, Edgard Owono Ndong. Pour le RPM, le Haut Ogooué qui est la province d'origine du président sortant Ali Bongo, « fait partie intégrante du Gabon et n’est la chasse gardée d’aucune famille, d’aucun clan, ou d’aucun parti politique. Tout Gabonais est libre de s’y rendre et de s’y exprimer ».
Ce communiqué fait suite à l’affrontement qui a opposé à Franceville, des militants du RPM et des jeunes de la localité. En effet, dans une vidéo postée sur la page du candidat, l’on voit des gens saccager des chaises et d’autres, se jeter des projectiles. Pour l’instant, aucun lien n’a été établi entre ces gens et le parti au pouvoir.
A la suite du RPM, le Parquet de la République a également condamné ces actes de violence et annonce qu’une enquête judiciaire a été immédiatement ouverte après l’incident dans le but de rechercher leurs auteurs et instigateurs. Ces actes seraient constitutifs d’infractions prévues et punies par les articles 230 et 333 du code pénal. « Le Parquet de la République condamne avec la plus grande fermeté ces agissements, qui troublent l’ordre public. Il recommande à tous les citoyennes de faire montre de civisme, de retenue et de responsabilité en cette période électorale », a indiqué Nzeikoko-Bissala Aymone, procureur de la République adjoint au tribunal de première instance de Franceville.
Il faut dire que malgré ces affrontements, le meeting du candidat du RMP à Franceville s’est tenu. Il s’est par la suite rendu à Moanda dans la même province pour la suite de sa tournée.
SG
Lire aussi :
Présidentielle 2023 au Gabon : 19 candidatures validées par le Centre gabonais des élections
Sécurité routière : le Gabon lance une campagne de sensibilisation à l’approche des élections générales dans le pays
Le Gabon a lancé le 18 juillet une campagne de sensibilisation à la sécurité routière, dans le cadre de grands départs dus aux vacances et en prélude aux élections générales (présidentielle, législatives et locales) prévues le 26 août prochain dans le pays. « Par rapport à ce flux de personnes qui vont être en mouvement en termes de véhicules et de passagers, il était question de revenir sur les principes fondamentaux du respect de la conduite, à savoir l’excès de vitesse, l’utilisation des téléphones au volant, la vérification de l’état des pneus et les surcharges », explique Jean Brice Nzoutsi-Diosse, le secrétaire général adjoint du ministère des Transports.
Selon ce département ministériel, plusieurs accidents de la circulation au Gabon sont causés par le non-respect des règles de sécurité routière. La route nationale 1, seule voie goudronnée qui relie la capitale Libreville à l’intérieur du pays, est souvent surchargée par le trafic. En 2020, le pays avait officiellement enregistré 3 748 accidents de la route, en hausse de 145,6% par rapport à 2019. Le nombre de blessés a suivi la même tendance, avec 1 196 blessés en 2020 contre 660 l’année précédente.
L’objectif de cette campagne est donc de réduire de manière drastique les accidents sur la route. À travers des descentes sur le terrain et des messages diffusés via les spots publicitaires et les plateformes digitales (« La vie vaut plus qu’un SMS », « Non à la vitesse au volant », « Oui à la ceinture de sécurité », « Oui au respect de la signalisation routière », etc.), les autorités veulent ainsi « prévenir et conscientiser » les automobilistes et les usagers sur les principales causes des accidents de la route, indique la Direction générale de la sécurité routière.
Le 12 juillet dernier, le ministre des Transports, Auguste Roger Bibaye Itandas, a pris un arrêté portant interdiction de circulation de nuit en zone interurbaine pour les véhicules de transport public de voyageurs dans la tranche horaire de 20h à 5h du matin. Le membre du gouvernement explique que cette mesure s’inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité des usagers de la route.
Patricia Ngo Ngouem
Lire aussi:
Transport routier : Les voyages de nuit en dehors du Grand Libreville sont interdits
Gabon : 3 748 accidents de la route enregistrés en 2020, en hausse de 145% par rapport à 2019
Véhicules neufs : les ventes chutent de 24,7% au Gabon au premier trimestre 2023, déjouant les prévisions de la Beac
Selon la dernière note de conjoncture sectorielle de la direction générale de l’économie et de la politique fiscale (DGEPF), le commerce des véhicules neufs a chuté de 24,7% au cours des trois premiers mois de l’année en cours, comparativement au trimestre précédent. Le nombre de véhicules vendus avait fléchi de 24% au cours de la même période en 2022, avec seulement 431 unités vendues.
La DGEPF justifie cette baisse par l’augmentation des prix des unités vendues dans un contexte de hausse généralisée des prix et de crise des semi-conducteurs dans l’industrie automobile. Le marché des véhicules neufs au Gabon a été durement impacté par la crise sanitaire et économique liée à la pandémie de Covid-19, comme un peu partout sur le continent.
La Banque des Etats de l’Afrique centrale (Beac) annonçait pourtant en janvier dernier que le commerce des véhicules devrait connaître une tendance haussière au 1er trimestre 2023 au Gabon. La Beac déclarait que ce « secteur est tributaire des performances des opérateurs miniers et forestiers pour ce qui concerne les pièces détachées, l’octroi de nouveaux permis miniers et le démarrage du projet de fer de Belinga, ainsi que la demande locale de matériel industriel permettraient à la branche d’afficher un rythme soutenu de croissance au premier trimestre 2023 ».
Le commerce de véhicules neufs est le seul à afficher une baisse, alors que les autres segments du commerce ont été « bien orientés » au cours de la même période, selon la même source. Les ventes dans le commerce ont de ce fait gagné 0,9% par rapport au dernier trimestre de l’an dernier.
P.N.N.
Lien
Au Gabon, le secteur minier devrait booster le commerce des véhicules au 1er trimestre 2023 (Beac)
Présidentielle 2023 : Jean Ping refuse son soutien à ses anciens alliés politiques
Pour l’élection présidentielle, prévue au Gabon le 26 août prochain, aucun des candidats de l’opposition ne recevra le soutien de Jean Ping, principal challenger d’Ali Bongo il y a sept ans. L’opposant l’a clairement fait savoir au cours d’une récente interview diffusée sur les ondes de Radio France internationale (RFI). En effet, s’il refuse de prendre part à l’élection, Jean Ping se réserve d’émettre un avis sur un candidat qui pourrait fédérer l’opposition face à Ali Bongo, comme lui en 2016. « Je n’ai pas de préférence à donner dans des conditions de simulacre. Je leur souhaite simplement bon vent », a-t-il déclaré sur RFI.
Autant dire que cette sortie de Jean Ping (80 ans) déjoue les pronostics de ceux qui espéraient un retour d’ascenseur au profit de ceux qui ont soutenu sa candidature contre vents et marrées lors de la dernière présidentielle à l’instar de Hugues Alexandre Barro Chambrier, Gérard Ella Nguema Mitoghe, Mike Steeve Dave Jocktane ou encore Paulette Missambo.
Dans le camp des partisans de la candidature unique de l’opposition, la posture de l’ancien président de la Commission de l’Union africaine est critiquée. « Dans ce contexte où à un mois du scrutin, l’opposition évolue encore en rangs dispersés, son avis aurait pu compter dans le choix d’un candidat unique et consensuel, capable d’inquiéter le président sortant Ali Bongo », commente un observateur.
Dans tous les cas, là où Jean Ping croit voir un « simulacre » où « une entourloupe » électorale, certains parmi ses lieutenants d’hier croit en leur destin, même sans son soutien. « Je vous dis et je vous confirme qu’Ali Bongo va partir. Il n’a plus rien à proposer », a déclaré Alexandre Barro Chambrier au cours de son meeting politique le week-end dernier à Franceville (Haut-Ogooué), fief électoral d’Ali Bongo.
Les candidats à la prochaine élection sont connus depuis le 23 juillet 2023. L’ouverture de la campagne électorale est prévue pour le 11 août prochain et sa fin le 25 août 2023. Les bureaux de vote seront ouverts le 26 août.
Sandrine Gaingne
Lire aussi :
Présidentielle 2023 au Gabon : 19 candidatures validées par le Centre gabonais des élections
Libreville : la police dément son implication dans le décès d’un jeune de 17 ans au quartier Bas de Gué-Gué
Le commandant en chef des Forces de police nationale, le Général de division Serge Hervé Ngoma, a démenti l’implication de la police judiciaire dans le décès du jeune gabonais Rwann Samson Apouba dans la nuit du 13 au 14 juillet 2023. « Le commandement en chef dément formellement toute implication de la police judiciaire dans ce malheureux incident », précise-t-il dans le communiqué signé le 23 juillet 2023.
Ce communiqué est publié à la suite des rumeurs accusant la police judiciaire d’avoir tiré mortellement sur le jeune homme. Mais, selon le Général de division Serge Hervé Ngoma, l’enquête ouverte à la suite du décès de ce jeune Gabonais innocente les forces de l’ordre. D’après l’enquête en question, il ressort que dans la nuit du 13 au 14 juillet 2023, aux environs de 24 heures, le jeune homme concerné, conduisait un véhicule de marque Wollksvagen appartenant à ses parents, avec deux autres passagers à bord. Ils ont été victimes d’un accident de voiture au niveau du quartier Bas de Gué-Gué. Au cours de cet accident, le jeune Rwann Samson Apouba a été grièvement blessé, puis, conduit par un chauffeur de taxi au Centre hospitalier universitaire de Libreville, tandis que les deux autres occupants du véhicule ont pris la fuite, indique le communiqué.
« Suite à l’intervention des médecins, il a été découvert un objet métallique provenant apparemment du dispositif Airbag du véhicule accidenté dans la cage thoracique de la victime. L’examen du corps réalisé le 21 juillet 2023 par le médecin légiste, en présence constante des parents, a révélé que le décès avait été causé par un choc violent avec une surface dure », soutient le commandant en chef des Forces de police nationale.
Le Général de division Serge Hervé Ngoma met en garde les auteurs de ces rumeurs sur les lourdes conséquences judiciaires qui peuvent découler de ces actes répréhensibles par la loi. Il encourage par ailleurs les populations, à ne s’en tenir qu’aux informations communiquées par les autorités compétentes, en pareille situation.
SG
Présidentielle 2023 au Gabon : 19 candidatures validées par le Centre gabonais des élections
La liste des candidats retenus pour l’élection présidentielle du 26 août prochain au Gabon est désormais connue. Ils sont 19 dont les dossiers ont été validés sur les 27 candidatures enregistrées, a annoncé le Centre gabonais des élections (CGE) dimanche 23 juillet. Parmi eux se trouvent deux femmes : Victoire Lasseni Duboze (indépendante) et Paulette Missambo, la présidente de l’Union nationale et l’une des principales rivales du président Ali Bongo, candidat à un troisième mandat à la tête du pays.
Alexandre Barro Chambrier du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité (RPM) est l’un des poids lourds de l’opposition dont la candidature a été validée. Comme Paulette Missambo, il est membre de la plateforme « Alternance 2023 ». Il s’agit d’une coalition de l’opposition qui espère fédérer une candidature commune face au président sortant.
Certains candidats retenus ont déjà fait entendre leur voix dans le passé. C’est notamment le cas de Pierre-Claver Maganga Moussavou, le président du Parti social démocrate (PSD). Il a déjà été candidat aux élections de 1993, 1998, 2009 et 2016. La campagne électorale officielle se déroulera du 11 au 25 août à minuit. Le gouvernement affirme être prêt à accompagner le processus électoral dans un climat calme et apaisé, alors qu'une partie de l'opposition dénonce les récentes modifications du code électoral.
P.N.N
Liste des candidat retenus pour l’élection présidentielle 2023
- Barro Chambrier Hugues Alexandre (RPM)
- Biyogue Bi Ntougou Jean Delor (Indépendant)
- Bongo Ondimba Ali (PDG)
- Ella Nguema Mitoghe Gérard (FPG)
- Fanguinoveny Jean Romain (RPG)
- Gnembou Moutsona Thérence (PRC)
- Ibinga Ibinga Axel Stophène (Indépendant)
- Jocktane Mike Steeve Dave (Indépendant)
- Lasseni Duboze Victoire (Indépendante)
- Maganga Moussavou Pierre-Claver (PSD)
- Mbatchi Pambo Joachim (FDR)
- Mbombe Nzoundou Abel (Indépendant)
- Missambo Paulette (UN)
- Mouanga Mbadinga Jean Victor (MESP)
- Mve Mba Emmanuel (Indépendant)
- N’goma Thierry Yvon Michel (Indépendant)
- Ndong Sima Raymond (Indépendant)
- Ondo Ossa Albert (Indépendant)
- Oniane Gervais (Indépendant)
Fonction publique : le gouvernement gabonais dévoile la nouvelle procédure de recrutement
Les 20 et 21 juillet, le gouvernement gabonais a organisé un atelier de vulgarisation de la nouvelle procédure de recrutement dans la Fonction publique, en vue de la réouverture des concours administratifs au Gabon. Edouard Mfoula Mbome, le directeur général de la Fonction publique, a déclaré que ce nouveau procédé repose sur « une connaissance précise de l’existant, tant en moyens qu’en besoins, ainsi que sur l’évaluation et la programmation des besoins ».
Selon le ministère de l’Emploi, de la Fonction publique et du Travail, la procédure passe d’abord par l’expression claire des besoins exprimés par le ministère sectoriel, à travers un plan de recrutement. Ce plan devra clarifier les décisions en matière d’effectifs à recruter, préciser les profils recherchés, élaborer les plans de formations à mettre en œuvre, identifier les formations, l’emploi et les effectifs, et envisager leur projection à court, moyen et long terme, apprend-on.
Ces besoins sont ensuite analysés par le ministère de la Fonction publique et le ministère sectoriel, puis une évaluation financière et une programmation budgétaire sont faites par le ministère du Budget et des comptes publics. Suivra alors l’ouverture du concours par un arrêté du ministre de la Fonction publique, l’organisation du concours proprement dit par le ministère sectoriel en collaboration avec le ministère de la Fonction publique. Un arrêté du patron de ce département ministériel portant publication des résultats viendra clore la procédure.
Les responsables de l’administration ont été invités à mettre en œuvre cette nouvelle procédure pour mieux planifier les recrutements à venir. Ce, afin d’assurer une meilleure employabilité des agents publics et surtout prévenir toute la grogne sociale issue souvent d’une mauvaise planification. Le gouvernement gabonais a décidé de relancer les concours à la Fonction publique lors du conseil des ministres le 12 juillet dernier. Ceux-ci avaient été gelés en 2018 afin de rationaliser les effectifs des employés publics afin de maîtriser la masse salariale.
« Cette perspective, qui vise à répondre aux sollicitations de certaines administrations sur les emplois et effectifs à renforcer, est rendue possible du fait d’une meilleure maîtrise des besoins en termes de plan de recrutement, ainsi que de l’évaluation et de la programmation budgétaire », justifie la ministre de la Fonction publique, Madeline Berre.
P.N.N
Lire aussi:
Anne N. Biyo’o portée à la tête de l’Association des organes de gestion des Zones économiques d’Afrique
L’Association des organes de gestion administrative des zones économiques d’Afrique (Asogazea) a été créée au cours d’une assemblée constitutive à Libreville les 13 et 14 juillet derniers et Anne Nkene Biyo’o, l’administratrice générale de l’Autorité administrative de la zone économique spéciale (ZES) de Nkok a été portée à la tête de cette nouvelle association.
Aux côtés de Anne Nkene Biyo’o, Mickael Ocquay (Ghana) va assurer la vice-présidence, et Idiola Sandah (Togo), le secrétariat général. Roch Massoyi-Eteka (Congo Brazzaville) est secrétaire général adjoint et Ousmane Djougourou (Tchad) assure la trésorerie de l’Asogazea.
L’Asogazea dont le siège est établi à Libreville a pour ambition de faciliter l’échange d’informations et le partage de bonnes pratiques entre les organes de gestion administrative en vue d’accélérer le développement des zones économiques du continent. Aussi, l’Asogazea jouera un rôle prépondérant pour le développement économique de l’Afrique via la promotion des outils performants que sont les Zones économiques spécialisées, apprend-on.
« La création de cette association est un maillot essentiel de la vision du président de la République, Ali Bongo Ondimba en matière de promotion du savoir-faire de la ZIS de Nkok et le renforcement de la coopération intra-africaine », a commenté Anne Nkene Biyo’o.
Le choix du Gabon pour la présidence de cette nouvelle association n’est pas fortuit. Avec le succès de la Zone économique de Nkok qui est aujourd’hui responsable de pas moins 40% des exportations du pays, le Gabon se présente comme un exemple à suivre pour les autres pays. D’après l’Organisation africaine des zones économiques, la Zone économique de Nkok est une référence africaine.
Le lancement de l’Asogazea à Libreville fait suite au 1er Forum des organes de gestion administrative des Zones économiques d’Afrique qui a eu lieu les 02 et 03 février 2023. Une rencontre au cours de laquelle les pays avaient convenu de mettre en place une plateforme d’échanges et de partenariat afin d’élaborer les programmes d’action communs visant à permettre aux zones industrielles respectives de capitaliser des pratiques administratives standardisées et adaptées aux réalités de toutes les zones économiques. C’est donc chose faite.
SG
Écoles normales des instituteurs : le Gabon repousse à 32 ans l’âge limite de participation aux concours externes
Pour permettre au plus grand nombre de jeunes gabonais détenteurs du baccalauréat de passer les concours d’entrée à l’École normale des instituteurs de Libreville (ENIL) et de Franceville (ENIF), le ministère de l’Éducation nationale a repoussé à 32 ans l’âge limite de participation contre 30 ans initialement prévus.
Aussi, les conditions de participation au concours de l’École normale supérieure (ENS) ont été réaménagées. Avec notamment, l’âge limite fixé à 28 ans pour le parcours licence et à 32 ans pour le parcours Master, sans aucune condition sur l’année d’obtention du Baccalauréat ou du dernier diplôme universitaire respectivement.
Cette décision vient répondre aux attentes de plusieurs Gabonais qui avaient demandé à la suite du lancement de ces différents concours externes le 15 juillet dernier, que le critère d’âge soit revu. « Nous avons attendu depuis plus de 3 ans que le concours d’entrée dans les écoles normales soit lancé. Malheureusement, quand on lance ces concours cette année, certains ont déjà dépassé l’âge limite et pour d’autres, c’est le diplôme qui est très ancien. Donc, nous sommes contents que nos cris aient été entendus. Je peux ainsi passer le concours de l’ENS », se réjouit J. Mangola, une candidate.
Pour tous les concours d’entrée dans les écoles normales du Gabon lancés le 15 juillet dernier par le ministère de l’Education nationale, 1580 places sont à pourvoir. Notamment, 580 places pour l’ENS, 400 places respectivement pour l’École normale supérieure de l’enseignement technique (Enset), et l’ENIL et enfin 200 places pour l’ENIF.
SG