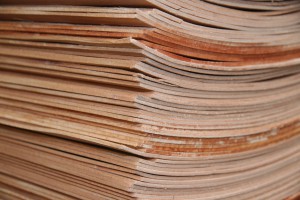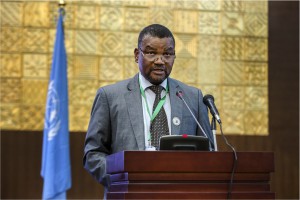Le Nouveau Gabon
Selon l’indice Mercer, la qualité de vie à Libreville est meilleure en Afrique centrale
Le cabinet américain Mercer vient de rendre public l’indice de la qualité de vie dans 450 villes du monde. Pour y figurer, les cités étudiées doivent observer un échantillon de critères regroupés en 10 tableaux qui permettent de construire le classement.
Dans la région Afrique, Port Louis en Ile Maurice, 83ème mondiale, est la ville africaine la mieux classée pour sa qualité de vie, suivie de Durban 89ème, Cape Town 94ème, et Johannesburg 95ème.
Dans la sous-région Afrique centrale, le Gabon devance tous ses voisins et occupe la première place dans l’espace communautaire. 164ème ville en termes de qualité de vie, et 13ème continentale, Libreville aura selon le cabinet Mercer, mieux fait que ses voisins que sont ; Yaoundé (194) mondial, Douala (198), Brazzaville (224), N’djamena (226), Malabo ou encore Bangui (230), en termes d’assainissement, d’accès aux soins de santé, d’accès aux écoles internationales ainsi qu’à la qualité de l’éducation.
Le rapport met à l’index l’instabilité politique persistante dans plusieurs pays, la pauvreté rampante, les changements climatiques ainsi que le manque d'investissements appropriés dans les infrastructures. Ce qui impacte négativement la qualité de vie dans ces différentes villes.
D’après le cabinet américain, la qualité de vie d’une ville ou d’un lieu, influence les choix des investisseurs dans l’implantation de leurs sociétés et du déploiement de leurs travailleurs.
«Dans de nombreuses villes, les dirigeants veulent comprendre les facteurs spécifiques qui affectent la qualité de vie de leurs résidents et s'attaquer aux problèmes qui diminuent le classement global de la qualité de vie d'une ville.», indique le rapport.
Parmi les critères d’éligibilité à la meilleure qualité de vie auxquels les villes doivent satisfaire, il y a l’environnement politique et social, l’environnement économique, l’environnement socioculturel, les aspects médicaux et sanitaires, les écoles et l’éducation, les services publics et les transports, les loisirs, les biens de consommation, le logement et l’environnement naturel.
PcA
Le Gabon, premier producteur africain et deuxième mondial de placages
La politique implémentée par les autorités gabonaises en matière de gestion de la filière bois semble sur une bonne voie. En effet, depuis l’interdiction par décision présidentielle en 2010, de l’exportation du bois en grumes, les performances de ce secteur, notamment en termes de transformation locale de cette matière première, affichent des indicateurs encourageants.
Gardant son crédo de désormais transformer localement son bois, dans l’optique d’accélérer la diversification de l’économie, tout en restant aligné aux engagements internationaux de développement durable des forêts, le pays compte aujourd’hui, parmi les premiers producteurs de bois tropicaux au monde avec une production de plus de 270 000 m3 de placages, contre 170 000 m3 en 2009.
Ces données ont été rendues publiques le 6 avril dernier, par le ministre d’Etat en charge de la Forêt et de l’Environnement, Pacôme Moubelet Boubeya, lors de la cérémonie d’inauguration de la société Accurate Industries, dans la Zone économique à régime privilégié de Nkok.
Occasion a ainsi été donnée au patron des forêts gabonaises, de magnifier la « courageuse et visionnaire décision » du président de la République, Ali Bongo Ondimba d’interdire l’exportation des grumes. Laquelle mesure, a-t-il précisé, « visait principalement la transformation du bois pour, non seulement en apporter une plus-value, mais surtout pour créer un écosystème économique globale afin que l’exploitation de la forêt gabonaise puisse contribuer grandement à la création de la richesse nationale et par conséquent, à la création d’emplois ».
« L’inauguration de la société Accurate Industries vient également renforcer la position de notre pays en tant que premier producteur africain de placage et deuxième producteur mondial dans ce domaine. », a indiqué le membre du gouvernement. Avant d’ajouter que « Ceci constitue un élément de très grande fierté, surtout lorsque nous savons que nous avons atteint ce rang en étant entièrement aligné aux normes d’aménagement durable de nos forêts ».
Il est à noter que cette cérémonie a également servi de cadre à la finalisation de quatre conventions, en vue de la construction de nouvelles entreprises dans le secteur du secteur bois. Avec ces nouveaux opérateurs, a relevé Pacôme Moubelet Boubeya, «la zone Spéciale de Nkok va voir son volume d’exportation mensuelle augmenté de plus de 400 conteneurs en plus des 530 conteneurs déjà exportés à ce jour».
Stéphane Billé
Au Gabon, la FAO entend désormais privilégier les actions à impact palpable sur les populations, notamment féminines
A la faveur d’un entretien en début de semaine avec le ministre délégué à la Promotion des PME et à l’Entrepreneuriat national, le représentant résident de la FAO au Gabon, Helder Muteia, (photo), a décliné les différentes actions et initiatives entreprises par son institution au Gabon.
Au cours des échanges, Helder Muteia, a assuré le ministre délégué, de la disponibilité de son équipe à collaborer avec le ministère de l’Entreprenariat national dans ses différents domaines d’intervention.
Dans cette optique, a-t-il indiqué, l’appui de la FAO a été sollicité pour renforcer les capacités des femmes transformatrices de produits agricoles sur les mécanismes de valorisation et de commercialisation des produits locaux. Les deux institutions se sont accordées à travailler ensemble pour la matérialisation de ce projet qui va contribuer à réduire la pauvreté et l’insécurité alimentaire au Gabon.
Implication des femmes dans les chaînes de valeur
Au Gabon, l’essor de la transformation des produits agricoles est caractérisé par une forte implication des femmes. En effet, sur la chaîne de valeur de ces produits, elles occupent une place prépondérante et créent des emplois dans la transformation. Depuis 2016, la FAO travaille activement au renforcement de leurs capacités, notamment à travers la structuration d’une Fédération nationale des transformateurs de produits agricoles du Gabon (FENATAG), dirigée par une femme.
Grâce à des formations variées en transformation agroalimentaire, en hygiène alimentaire et en gestion d’entreprises, ainsi qu’un voyage d’études au Burkina-Faso à l’endroit de dix femmes, ce secteur a connu de nombreuses avancées.
Les retombées de ces initiatives se traduisent par une nette amélioration de la qualité des produits, leur commercialisation au sein des grandes surfaces, une augmentation des revenus des populations cibles, la création d’emplois pour les femmes ainsi que le développement des chaînes de valeur des produits agricoles.
Un plan de développement stratégique de la FENATAG, couvrant la période 2018-2022, a été élaboré ainsi qu’un Catalogue des Transformateurs des Produits Agricoles du Gabon. Ces documents dont la publication est en cours serviront à mieux faire connaitre la fédération et ses membres et à les aider à s’autonomiser progressivement.
Stéphane Billé
Avec l’appui de la Banque mondiale, le Gabon et le Congo concrétisent l’intégration régionale numérique
Le Gabon et le Congo viennent de franchir une étape décisive dans la réalisation de l’intégration régionale numérique, avec la matérialisation, le 05 avril 2018, de l’interconnexion de leurs réseaux terrestres de fibres optiques.
Cette étape qui marque la clôture de la première phase de mise en œuvre du projet de dorsale à fibre optique en Afrique centrale, encore appelé Central African Backbone (CAB), «devra à terme, permettre à ces deux pays, de diversifier leur économie, de créer des emplois et de démocratiser l’utilisation des technologies et services de l’information et de la communication dans la sous-région », a souligné la directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Cameroun, le Gabon, l’Angola, la Guinée Équatoriale et Sao Tomé & Principe, et responsable du Programme d’intégration régionale de la Banque mondiale pour l’Afrique centrale, Elisabeth Huybens (photo).
Forte de cet important investissement, elle a indiqué que « la Banque mondiale est fière d’avoir contribué au financement de ce projet déterminant ».
Pour rappel, le projet Central African Backbone (CAB) a été initié par les pays de la Cémac, lors du sommet des chefs d’Etats à Ndjamena, au Tchad en avril 2007. Il vise à favoriser l’intégration sous-régionale et à réduire la facture numérique grâce à des infrastructures terrestres de haut débit à base de fibre optique. Son enjeu est d’augmenter la capacité de liaison numérique entre les 11 pays de la communauté.
D’ici 2020, le projet CAB entend s’élargir à d’autres pays de la sous-région. Il prévoit de raccorder le réseau du Congo à celui du Cameroun et de la Centrafrique d’une part, et le réseau du Gabon, à celui du Cameroun et de la Guinée Équatoriale d’autre part.
Stéphane Billé
Vers la création du Conseil supérieur des ordres nationaux en matière de comptabilité dans l’espace Cemac
A l’occasion de la deuxième concertation des professionnels libéraux de la comptabilité de l’espace Cemac, tenue du 26 au 28 mars à Douala au Cameroun, les participants venus de tous les pays membres de la Communauté, ont annoncé la création prochaine du Conseil supérieur des ordres nationaux de la sous-région.
Pour y parvenir, les pays de l’espace communautaire ont procédé d'abord à la constitution d’un organe de transition composé de six postes de responsabilité.
Pour les pourvoir, trois principes directeurs ont été retenus, à savoir la représentativité, la séniorité et enfin la hiérarchie. C’est donc ainsi qu’un Camerounais a été désigné comme président du bureau transitoire. Il est secondé par un Congolais. Le secrétariat général est assuré par un Centrafricain. Son adjoint est Tchadien. La trésorerie revient à un Gabonais.
Comme membres de l’organisation, tous les six pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) sont représentés : RCA, Guinée équatoriale, Tchad, Cameroun, Congo, Gabon.
L’organe de transition a pour mission d’assurer la mise en place effective du Conseil supérieur, à travers une feuille de route qui a été prescrite pour l'année 2018.
S.A
Le gouvernement sollicite la FAO pour la transformation des produits agricoles
Le gouvernement sollicite l’appui de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour renforcer les capacités des femmes, quant à la transformation des produits agricoles, ainsi que pour la mise en place des mécanismes de valorisation et de commercialisation des produits locaux, apprend-on dans la presse locale.
Cette opération qui vise à lutter durablement contre la pauvreté par l’autonomisation des femmes transformatrices de produits agricoles, entend également contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations.
Pour cela, Hélder Muteia (photo), représentant de la FAO, a indiqué à la ministre déléguée aux PME, Irène Lindzondzo, qu’il est plus que jamais nécessaire de privilégier les actions concrètes à réel impact sur le vécu des populations, au détriment des appuis ponctuels accordés lors des événements organisés périodiquement dans l’année.
PcA
BW Energy lance bientôt la production du champ pétrolifère de Tortue
La compagnie pétrolière singapourienne BW Energy, une filiale de la major pétrolière BW Offshore, a procédé à la cérémonie de baptême de son navire pétrolier, le BW Adolo, destiné au développement du champ pétrolifère de Tortue, situé au large du Gabon, annonce un communiqué de BW Group.
La cérémonie de baptême de ce bâtiment pétrolier, tenue à Singapour le 5 avril 2018, et qui a donné l’occasion aux dirigeants de la compagnie de dérouler les perspectives de l’exploitation du champ de Tortue, a vu la participation du ministre gabonais du Pétrole et des hydrocarbures, Pascal Houangni Ambouroue.
Ainsi, souligne le communiqué, le BW Adolo qui se trouve actuellement au chantier naval de Keppel à Singapour, opérait sur le champ Azurite avant d’être sélectionné pour contribuer au développement du champ de Tortue.
«Les plus chaleureuses félicitations aux collègues de BW Offshore pour la désignation de leur FPSO, le BW Adolo.», a déclaré BW Group dans son communiqué lors de la cérémonie de baptême du pétrolier.
Le champ de Tortue qui fait partie du contrat de partage de production de Dussafu, situé au large du Gabon, constitue selon la compagnie pétrolière singapourienne, l'une des quatre découvertes pétrolières existantes dans la zone d'exploitation exclusive de Dussafu.
L’opérateur BW Energy Gabon y détient une participation de 91,667% tandis que son partenaire dans le projet Panoro Energy, détient 8,33% des parts.
Le plan de développement de ce champ a été approuvé par le régulateur gabonais en janvier dernier. BW a aussitôt lancé les opérations de forage sur le puits de production DTM-2H sur ce champ avec la mise en service de la plateforme auto-élévatrice Borr Norve.
Après cette phase de forage qui se poursuit, indique la compagnie, le puits devra être complété par un autre puits sous-marin, constitué d’un drain horizontal d'environ 500 mètres.
Suivra alors le forage par la plateforme, du trou pilote du DTM-3 qui permettra d’évaluer le potentiel des réservoirs de Gamba et de Dentale, situés dans la partie Nord-Ouest de Tortue.
La réforme des pensions en voie d’adoption
Le régime des pensions du Gabon devrait connaître une mue dont l’objectif principal vise un meilleur traitement des retraites et des allocations sociales.
Le cadre juridique actuellement en examen au Parlement, devrait apporter davantage de flexibilité au régime des pensions, question de mieux l’adapter aux fluctuations de l’environnement économique et social. Dans le projet de loi déposé au Parlement, il est question de définir les bénéficiaires et les personnes éligibles au régime des pensions, le financement du système des pensions, l’exercice des droits à pension ainsi que les sanctions applicables en cas de fraude à la sécurité sociale.
La presse locale note une première indiscrétion sur l’origine du financement des différents régimes dont l’assise reposera sur des ressources comme les cotisations salariales et patronales, les subventions de l’Etat et les produits des placements financiers.
Pour les autorités, l’adoption de ce nouveau régime des pensions, vise la mise en cohérence du cadre juridique actuel des pensions avec les dispositions constitutionnelles en vigueur. Car, souligne la presse locale, le texte actuel en vigueur depuis 1996, porte sur le régime général des pensions de l’Etat. Aussi comporte-t-il plus de dispositions réglementaires que légales.
PcA
Olam Gabon lance une mission ophtalmologique internationale au Gabon
Après les infrastructures socio-économiques, industrielles et de transports, la filiale gabonaise de la Singapourienne Olam international, se lance également dans le secteur de la santé.
A compter de ce lundi 9 avril et ce, pour une période de six à neuf mois, la société Gabon Special Economic Zone (GSEZ), va entamer une mission ophtalmologique internationale à travers toute l’étendue du territoire national.
Baptisée « Vision pour tous 2018 », cette mission placée sous la supervision du ministère de la Santé, se résume en un programme ophtalmologique itinérant intégralement financé par la GSEZ, au profit des populations gabonaises.
Selon la direction générale de GSEZ, «cette initiative témoigne de l’engagement de la société dans le volet socio-économique du pays. Lequel engagement se traduit à travers les soutiens multiformes des populations dans leurs défis quotidiens».
Pour Gagan Gupta, le PDG d’Olam Gabon, «le lancement de l’opération ‘’ Vision pour tous 2018’’ procède du constat du nombre considérable de pathologies ophtalmologiques observées à travers le pays, et qui a pour conséquences, d’affecter les personnes aptes à exécuter des activités de production».
C’est dans ce cadre purement social, poursuit-il, que «la GSEZ, a lancé ledit programme afin d’apporter sa contribution au traitement des personnes affectées par ces pathologies ».
Le dispositif médical commis à cet effet se veut être à la dimension des ambitions dudit programme. Il est ainsi composé d’un logiciel de suivi ultra performant qui permet de la prise de rendez-vous, et surtout l’ouverture rapide d’un dossier médical en ligne.
Ce logiciel permettra en outre, de constituer une base de données exhaustive pour la réalisation des statistiques sur la santé oculaire au Gabon.
A côté dudit logiciel, on y trouve également, un autre outil de pointe appelé « Crystal », qui permet, grâce à son intelligence artificielle, d’analyser le globe oculaire de manière exhaustive et précise, en quelques secondes seulement.
Au-delà de ce dispositif thérapeutique, l’autre grand avantage charrié par ce programme est le transfert de compétences.
En effet, les équipes venues de l’Inde, se chargeront également de renforcer les capacités de leurs homologues gabonais pendant la durée de la mission, en matière de technologies ophtalmologiques de l’heure.
Stéphane Billé
Le ranch de SIAT Nyanga a commercialisé plus de 68 000 kg de viande, en 2017
Spécialisé dans l’élevage bovin, le ranch de SIAT Nyanga situé au sud du Gabon a affiché des performances plus ou moins encourageantes, l’an dernier. A la fin du mois de décembre 2017, cette unité spécialisée dans l’élevage et l’exploitation de bovins a mis sur le marché un volume de 68 450 kg de viande, contre 71 423 en 2016, soit un repli de 4,2%.
Selon les données de la société, cette baisse s’explique par la diminution du nombre et de la fréquence des abattages de bêtes à réformer. Cette situation a induit un chiffre d’affaires de 302,6 millions FCFA, contre 317,7 un an plus tôt, soit une baisse de 4,7%.
Contrairement à la production, la société a connu une augmentation de son cheptel. Celui-ci est passé de 5361 têtes, en 2016, à 5832 en 2017, soit une évolution de 8,8%. L’on indique que cette performance est consécutive à la dynamique impulsée actuellement au sein de cette société. Laquelle passe par la détermination de reconstituer le troupeau, à travers la réduction du taux de mortalité des bêtes, la révision à la baisse des fréquences d’abattages, ainsi que l’introduction de jeunes bêtes aptes à la reproduction.
Enfin, la société a connu une forte augmentation de la masse salariale, au cours de la même année. Elle est ainsi passée de 135,6 millions FCFA, en 2016, à 224,4 millions FCFA, à cause notamment du changement de catégorie de nombreux agents, malgré la baisse des effectifs.
Stéphane Billé