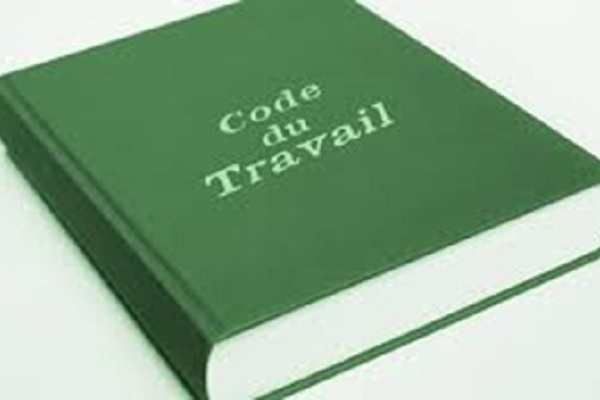Le Nouveau Gabon
Le Gabon veut éradiquer le phénomène de violence à l'égard des femmes
A l’occasion de la journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes, célébrée le 25 novembre 2021, le Gabon a choisi de mettre un accent sur la sensibilisation et la participation de tous pour atteindre l’objectif zéro violence. Le ministre des Affaires sociales et des Droits de la femme, Prisca Nlend Koho a lancé, à cet effet, les assises de la deuxième édition du grand débat à cœur ouvert.
« Nous voulons essentiellement mettre l’accent sur la sensibilisation, la pédagogie mais surtout amener tous les acteurs de la société à prendre cette cause à bras le corps avec les avancées que le Gabon a pu déjà enregistrer en termes de loi, notamment la loi relative à l’élimination des violences à l’égard des femmes qui a été promulguée en septembre dernier », a déclaré Prisca Nlend Koho.
Echelonnés sur trois panels, ces débats ont permis de mieux sensibiliser les forces vives de la nation sur la question des violences faites aux femmes en vue de trouver des solutions pour leur éradication au Gabon. Pour Monseigneur Patric Nguema Edou, panéliste, la lutte contre les violences basées sur le genre passe aussi par l'éducation des enfants. « En réalité c’est tous les enfants qu’on doit éduquer pour qu’ils apprennent déjà cette solidarité homme et femme. Et quand ils grandiront ils deviendront beaucoup plus positifs », a affirmé Monseigneur Patric Nguema Edou.
Les femmes représentent 90% des victimes de violences sexuelles et 83% des victimes de violences économiques au Gabon. Il existe peu de services offrant aux femmes victimes une prise en charge médicale, psychosociale et judiciaire. Ce constat de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba a conduit les autorités à adopter un projet de loi portant élimination des violences faites aux femmes, pour pallier l’absence d’une législation spécifique pour l’élimination des violences subies par les femmes et sur la prise en charge sociale, sanitaire, psychologique et judiciaire.
Selon le ministre des Affaires sociales et des Droits de la femme, un centre d’accueil, de reconstruction et d’hébergement transitoire des femmes victimes de violences sera bientôt opérationnel à Libreville.
Brice Gotoa
Les députés valident l’organisation et le fonctionnement des chambres provinciales des comptes
Réunis en session ordinaire le 25 novembre 2021, les députés gabonais ont adopté le projet de loi organique fixant l’organisation, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l’Ordre financier.
Ce projet participe à la réforme globale de l’organisation judiciaire entamée au Gabon depuis 2019 par la loi portant organisation de la justice, et renferme trois innovations majeures.
Premièrement, le texte régularise l’existence des Chambres provinciales des comptes. Selon le ministère de la Justice, le projet de loi octroie aux chambres provinciales, la maîtrise de l’adoption et de l’exécution de leur budget en concertation avec le ministre chargé des Finances (article 21) et l’élargissement de leurs missions intégrant désormais la certification des comptes de l’État, l’évaluation des politiques publiques et la réalisation de toutes sortes d’audits (article 52).
La deuxième innovation concerne la mise en conformité de la loi organique avec les recommandations contenues dans les instruments juridiques internationaux auxquels le Gabon a adhéré. Notamment, la question de l’indépendance des juridictions de l’ordre financier, conformément aux recommandations de l’Association des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (Intosai). Et troisièmement, la séparation des règles d’organisation de compétence et de fonctionnement et des règles de procédure applicables aux juridictions de l’Ordre financier.
Mais, au-delà de ces trois innovations, cette nouvelle loi oblige la Cour des Comptes à remettre solennellement chaque année un rapport au président de la République (art 122). Il prévoit aussi l’affectation d’une unité des Forces de défense et de sécurité à la protection des locaux et des membres des juridictions financières et à la sauvegarde des archives (art 123).
S.G.
Le groupe BGFIBank réagit au sujet des accusations contre sa filiale en RD Congo
Suite aux accusations de détournement de deniers publics (76 millions de dollars) d’un groupement d’ONG et de médias, dont Mediapart et RFI, contre sa filiale en République démocratique du Congo (RDC), le groupe bancaire BGFIBank dont le siège se trouve à Libreville, a donné, le 24 novembre, sa version des faits.
« Le groupe BGFIBank tient à informer l’opinion nationale et internationale qu’il condamne avec la plus grande fermeté les actes contraires à la loi et à l’éthique qui ont pu être commis dans le passé au sein de sa filiale BGFIBank RDC SA et dont ses préposés auraient pu éventuellement être auteurs ou complices à des degrés divers ; sans préjudice du droit des journalistes, le groupe BGFIBank affirme néanmoins qu’en République démocratique du Congo comme ailleurs, les autorités judiciaires restent les seules habilitées à établir dans le respect des lois, l’innocence ou la culpabilité des personnes poursuivies. En conséquence, toutes informations et allégations autres que les vérités établies par des décisions judiciaires définitives doivent être prises avec les réserves qu’imposent la crédibilité de la démarche et l’objectivité des faits de la part de leurs auteurs », souligne la banque.
BGFIBank indique par ailleurs qu’en 2018, elle a pris les mesures d’assainissement qui s’imposaient. Il s’agit notamment de : la restructuration de son capital social ; le renforcement de sa gouvernance ; la réalisation d’un audit interne pour identifier les méthodes de contournement ayant pu être utilisées pour enfreindre les procédures de contrôle de la Banque ; le renforcement des dispositifs de contrôle interne ainsi que des mesures de remédiation afin de se conformer à la réglementation bancaire applicable en RDC ; la mise en place de nouvelles de procédures de gestion garantissant une plus grande transparence de ses opérations, etc.
Pour rappel, selon les médias qui ont traité cette affaire, la Banque centrale de la RDC aurait ouvert à la BGFI Bank un compte qui aurait servi entre 2013 et 2015 à verser des millions de dollars à la famille et aux associés de l’ancien président Joseph Kabila. Puis la filiale aurait maquillé son bilan officiel pour masquer certains paiements.
Mais BGFIBank demande de rester circonspect et d’attendre une décision de justice pour rétablir la vérité. BGFIBank conclut en indiquant qu’elle continue de nourrir ses ambitions en RDC et s’assure que sa filiale s’engage plus fortement aux côtés de sa clientèle.
S.A.
Barrage de Ngoulmendjim : FGIS-Eranove recherche 196,7 milliards de FCFA sur le marché international
Pour financer la construction de la centrale hydroélectrique de Ngoulmendjim (82 MW) sur la rivière Komo, le consortium Fonds Gabonais d’investissements stratégiques (FGIS)-Eranove, veut lever 300 millions d’euros (196,7 milliards de FCFA) sur le marché financier international, informe FGIS. Pour cela, le Groupe industriel panafricain Eranove et Gabon Power Company (GPC), filiale détenue à 100 % par le FGIS, ont signé le 22 novembre 2021 les mandats pour la levée de fonds.
Il s’agit d’un mandat d’arrangement porté par la Banque africaine de développement (BAD) et un mandat de structuration porté par Standard Chartered Bank (SCB). Pour le compte du consortium FGIS-Eranove, ces deux structures financières sont désormais chargées, d’identifier les institutions financières qui participeront au financement du projet et instruire le dossier avec pour finalité la signature des accords de crédit et le démarrage de la construction, détaille un communiqué du consortium publié par l'Agence Ecofin.
« La signature de ces mandats est un progrès notable vers le financement effectif de ce projet de centrale hydroélectrique, qui répond aux meilleurs standards internationaux dans les domaines environnementaux, sociaux et sociétaux, comme l’a confirmé l’évaluation indépendante menée avec l’outil ESG de l’Association internationale d’hydroélectricité (IHA) », a commenté Marc Albérola, Administrateur, directeur général du Groupe Eranove.
Pour sa part, l’Administrateur-directeur général du FGIS a affirmé que « cette signature est non seulement le témoignage de la confiance des investisseurs internationaux comme Eranove dans la viabilité économique de projets portés par Gabon Power Company mais aussi un encouragement à la poursuite de notre mobilisation en faveur de l’investissement responsable ».
Développée par Asokh Energy, coentreprise gabonaise (JV) créée par le consortium FGIS-Eranove, la centrale hydroélectrique de Ngoulmendjim permettra de subvenir à la demande croissante d’énergie électrique du Gabon. Notamment celle de Libreville, qui abrite plus de la moitié de la population du pays. L’infrastructure va aussi accroître la part d’énergie renouvelable du mix de production d’énergie électrique au Gabon. La construction de cette centrale participera enfin à la création de 800 à 1 000 emplois directs pendant la construction et de nombreux emplois indirects, selon FGIS.
Le démarrage des travaux d’aménagement électrique de cette centrale était prévu pour cette année. Les populations restent dans l’attente du lancement des travaux.
S.G.
Lire aussi :
Flou autour du démarrage des travaux d’aménagement des barrages de Ngoulmendjim et de Dibwangui
Le Gabon affiche un taux d’accès à l’électricité de 15% en zone rurale en 2021
Le Conseil national de l’eau et de l’électricité (CNEE) vient de publier des données relatives à l’accès à l’énergie électrique et hydraulique en zone rurale au Gabon en 2021.
Selon cet organisme public, les zones rurales gabonaises comptent 25% de la population du pays, soit environ 400 000 personnes. « Les taux d’accès à l’électricité et à un point d’eau sont estimés à respectivement 15% et 43%. A moyen terme (2035), l’Etat envisage de développer un accès universel aux services de fourniture d’énergie électrique et d’eau potable sur l’ensemble du territoire gabonais », renseigne le CNEE.
Pour améliorer ces taux, le Conseil indique que la responsabilité globale de l’activité d’exploitation-maintenance lui a été confiée par l’Etat. Ainsi, le CNEE attribue et suit les contrats d’exploitation-maintenance des opérateurs privés et assure un rôle général de contrôle.
A terme, le gouvernement gabonais fonde sa stratégie d’accès universel aux services d’eau et d’électricité sur la mise en place d'un système de pérennisation du service d’accès à l’eau potable et d’accès à l’électricité en transférant le service d’exploitation-maintenance des équipements à un opérateur privé. Sans oublier de passer d’une logique de fourniture d’équipements à une logique de fourniture de services en faisant souscrire les ménages ruraux aux services payants apportés par l’opérateur privé.
Plusieurs réformes et décisions ont déjà été prises pour améliorer l’accès à l’eau et à l’électricité au Gabon. Entre autres, un cadre juridique élaboré pour attirer les investisseurs, la libéralisation du secteur dans la production et le transport, sans oublier le développement des énergies renouvelables grâce à des mesures incitatives. Toutes ces décisions ont permis d’améliorer la disponibilité de ces ressources. Même si ça reste encore insuffisant.
S.A.
Le nouveau Code du travail qui consacre l’égalité de sexe au travail au Gabon entre en vigueur
Adopté par l’Assemblée nationale le 25 juin 2021, le nouveau Code du travail gabonais est entré en vigueur à la suite de sa promulgation, le 19 novembre 2021, par le président de la République. Le texte est d’ailleurs publié ce 25 novembre, dans le journal officiel édition N° 139 qui couvre la période de 16 au 23 novembre 2021.
« Comme un symbole, ce jour correspond à la publication au Journal officiel du nouveau Code du travail dont les dispositions garantissent une meilleure protection des femmes tout en assurant une stricte égalité entre elles et les hommes », a-t-il twitté le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Un symbole parce que ce 25 novembre correspond à la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes consacrée par le texte.
Nos mères, femmes et filles n'ont pas à subir l'insupportable.
— Ali Bongo Ondimba (@PresidentABO) November 25, 2021
Ce 25/11 marque le début de l'opération #OrangezLeMonde: mettre fin aux #violencesfaitesauxfemmes.
Symboliquement, ce jour correspond à la publication au JO du nouveau code du travail qui renforce l'#égalitéFH. #Gabon pic.twitter.com/B5swjZYD5E
Et dans le nouveau Code de travail gabonais, un accent particulier a été justement mis sur la lutte contre les inégalités entre l’homme et la femme, et les discriminations sociales. Dans son article 2 alinéa 1, le texte affirme l’égalité d’accès au travail des femmes. Il permet aussi de lutter contre toute forme de discrimination empêchant l’accès au travail (art. 9 al. 2) ; d’affirmer l’égalité professionnelle entre hommes et femmes et le droit d’accès de la femme à toute sorte d’emploi dans l’entreprise (art. 9 al. 5) ; d’affirmer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et dans le déroulement de la carrière (art. 9 al. 5, art. 168 al. 2 et 3).
Par ailleurs, cette loi garantit la suppression des freins (pénibilité) à l’accès des femmes au marché du travail, notamment au travail de nuit (art. 200), la codification du harcèlement moral et sexuel comme une pratique condamnable et justiciable (art. 6).
Globalement, ce nouveau Code de travail garantit l’employabilité en définissant l’offre de formation par rapport aux besoins sur le marché de l’emploi. Il consacre le dialogue social qui doit faire l’objet d’un rapport social semestriel et annuel, permet de mieux lutter contre la précarité et protège le travailleur, etc. Il remplace celui de 1994, déjà modifié en 2000 et en 2010.
SG
Le Gabon veut augmenter ses recettes douanières de 40% en 2024 pour les porter à 426,2 milliards FCFA
Selon des données contenues dans son document de cadre macroéconomique et budgétaire pour les trois prochaines années, le Gabon ambitionne de porter ses recettes douanières à 426,2 milliards de FCFA en 2024. Une ambition qui est en hausse de 40%, en comparaison aux projections de la loi de finances rectificative de 2021, qui table sur 304 milliards de FCFA de recettes douanières. Pour cela, le pays espère réaliser 346,1 milliards FCFA de recettes douanières en 2022.
Cette projection s’appuie sur l’hypothèse d’une augmentation des recettes douanières à l’exportation, « soutenue par une progression du volume des exportations du minerai de manganèse et de bois débité, couplée à une amélioration de la taxation du droit de sortie du minerai de manganèse et des produits du bois », lit-on dans le document.
Cette hausse devrait également être soutenue par l’accroissement des recettes à l’importation grâce à un meilleur suivi annoncé des exonérations, ainsi que l’amélioration de la prise en charge des marchandises au cordon douanier. Toutes ces actions, d’après le document de cadrage macroéconomique et budgétaire, seront renforcées par le renouvellement des équipements opérationnels ainsi que par les effets induits de l’implémentation du logiciel Sydonia world.
Actuellement opérationnel dans 83% des bureaux centraux des douanes au Gabon, selon le ministère de l’Économie, ce logiciel a été mis en place dans le but d’accélérer les échanges d’information et améliorer la mobilisation des recettes. Rappelons que le Gabon a enregistré l’année dernière 333,3 milliards de FCFA de recettes douanières contre 263,1 milliards FCFA prévus dans la loi de finances rectificative, soit une hausse de 70,1 milliards FCFA.
SG
Lire aussi :
Douanes : le logiciel Sydonia world opérationnel dans 83% des bureaux centraux du Gabon
Industries extractives : la société civile sensibilise les populations sur l’importance de l’ITIE
La société civile gabonaise veut avoir un œil sur la gestion des ressources extractives. Pour cela, elle a lancé une campagne nationale de sensibilisation auprès des populations des provinces du Gabon où sont exploitées les industries extractives. Cette mission, qui s’étend jusqu’au 5 décembre prochain, a pour objectif de mobiliser les populations directement concernées par l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives au Gabon (ITIE) afin qu’elles s’impliquent dans le processus de développement de cette initiative dans le pays.
« Dans 18 mois, les premiers rapports du Gabon doivent être produits. Dans ce contexte-là, la société civile a un rôle capital à jouer. L’objectif de cette mission est de développer sur le terrain une campagne nationale de sensibilisation à l’échelle des zones extractives », a déclaré Georges Mpaga, chef de mission et point focal du collège de la société civile.
Depuis le 21 octobre 2021, le Gabon a réintégré l’ITIE et devient ainsi le 56e pays à mettre en œuvre la norme ITIE et le 27e en Afrique. « Cet engagement pour la transparence des richesses provenant des industries extractives, passe par la mise en œuvre des actions de suivi évaluation, un contrôle citoyen de l’action publique dans le domaine extractif, mais également par la vérification des contrats dans l’intérêt du peuple gabonais », a indiqué Petit Lambert Ovono, représentant du secteur de la gouvernance.
Au cours d’une sortie médiatique sur le retour du Gabon à l’ITIE, le représentant-résidant du Fonds monétaire international (FMI) au Gabon, Gomez Agou Gbedia, avait affirmé que dans ce cadre-là, le Fonds a un programme qui a un certain nombre de mesures qui permettrait de renforcer ce besoin de transparence. « La première mesure c’est la publication sur le site du gouvernement d’un rapport sur la production et les revenus dans le secteur pétrolier. La deuxième mesure importante c’est de s’assurer que toutes les ressources du pétrole sont dirigées principalement dans le seul compte du trésor qui est logé à la banque centrale », avait indiqué Gomez Agou Gbedia.
Les zones extractives sont constituées des localités où sont exploitées le pétrole, le diamant, l’or et le gaz. Il s’agit des provinces de l’Ogooué-Maritime, la Ngounié, le Moyen-Ogooué, le Woleu-Ntem, le Haut-Ogooé et l’Ogooué-Lolo.
Brice Gotoa
Lire aussi :
Aquaculture : les Gabonais s’ouvrent aux systèmes de production hors sol de poisson
L' Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) appuie le Gabon dans le développement de l’aquaculture commerciale intensive en zone péri urbaine. D’où l’atelier national de renforcement des capacités des aquaculteurs lancé le 17 novembre dernier.
Il était question de « renforcer les capacités des pisciculteurs actifs, orientés vers l’aquaculture commerciale, qui disposent déjà d’infrastructures de production en étangs adaptées pour générer des profits ». Cette rencontre a également permis de tester de nouveaux modes de production plus intensifs en zone péri urbaine où se trouvent les marchés importants. En effet ces zones confrontées à la contrainte foncière requièrent d’avoir recours à des systèmes de production hors sol tels que les bacs et les cages, explique la FAO.
Au cours des travaux, le ministre de l’Agriculture, Biendi Maganga Moussavou, a encouragé la vulgarisation des systèmes pilotes de production intensive testés. L’autorité souhaite que des pisciculteurs orientés vers l’aquaculture commerciale, notamment des jeunes entrepreneurs mettant en œuvre des modes de production couplant technologie et rentabilité, soient accompagnés.
Ce programme de renforcement des capacités entre dans le cadre du projet de développement de l'aquaculture commerciale intensive en zone péri urbaine piloté par la FAO. Ce projet vise l’accroissement durable de la production halieutique gabonaise et répondre aux objectifs de diversification de l’économie gabonaise et de sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Malgré les atouts naturels du Gabon, l’aquaculture reste peu développée dans le pays. Selon la FAO, les activités aquacoles sont axées sur la pisciculture avec l’élevage du Tilapia comme espèce dominante. On dénombre une centaine de fermes piscicoles pour la plupart de type extensif. Pourtant, le secteur aquacole est identifié comme l’un des secteurs ayant le potentiel de soutenir et d’optimiser la diversification de l’économie gabonaise et de réduire ainsi l’importation du poisson surgelé.
S.G.
Le Gabon enregistre 31 lauréats au programme d'entrepreneuriat Tony Elumelu en 2021, en hausse de 38,7%
Dans le cadre du programme d'entrepreneuriat organisé par le milliardaire et banquier (UBA) nigérian Tony Elumelu via sa Fondation éponyme, le Gabon enregistre 31 lauréats en 2021, soit une hausse de 38,7%.
Parmi les 31 lauréats gabonais, on dénombre une vingtaine de femmes. Cette prédominance de la gent féminine se fait aussi ressentir à l’échelle continentale car, selon les chiffres de la Fondation, sur 4 949 entrepreneurs sélectionnés dans les 54 pays d’Afrique en 2021, les femmes représentent 68% des récipiendaires. Les lauréats africains bénéficieront d’un appui financier global de 24 750 000 USD (environ 14,4 milliards de FCFA)
Les bénéficiaires de l'édition 2021 ont été sélectionnés parmi un pool de plus de 400 000 candidatures, en fonction de leur innovation, de leurs performances et de leur potentiel de croissance pour créer des emplois et éradiquer la pauvreté sur le continent. Composés à la fois de nouvelles start-ups et de petites entreprises existantes, les entrepreneurs Tony Elumelu 2021 ont suivi une formation, un mentorat et un coaching de classe mondiale et auront un accès à vie au réseau des anciens de la Fondation Tony Elumelu.
Depuis sa création en 2010, la Fondation Tony Elumelu déclare avoir financé un total de 15 847 entrepreneurs qui ont créé plus de 400 000 emplois directs et indirects. Grâce à TEFConnect, la plate-forme numérique exclusive de la Fondation, elle a fourni un soutien au renforcement des capacités, des conseils et des liens commerciaux à plus de 1,5 million d’Africains.
S.A.