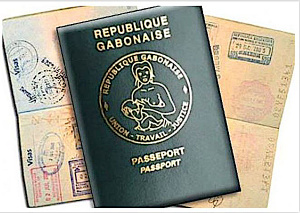Le Nouveau Gabon
Les Gabonais vivant à l’étranger pourront désormais renouveler leur passeport en ligne (DGDI)
Les Gabonais vivant à l’étranger n’auront plus besoin de se déplacer pour renouveler leur passeport. Ils pourront désormais le faire directement en ligne, a annoncé la direction générale de la documentation et de l’immigration (DGDI).
Pour bénéficier de cette nouvelle offre, il faut il faut résider à l’étranger et être détenteur d’un titre de séjour. Ensuite, les demandeurs devront s’acquitter de toutes les modalités exigées à savoir, remplir le formulaire sur le site de la direction générale de la documentation et de l’immigration, remplir correctement toutes les mentions obligatoires, joindre une copie d’acte de naissance, une photo d’identité couleur sur fond blanc…
La direction générale de la documentation et de l’immigration ne précise cependant pas le montant requis pour la souscription ni le mode de paiement, ni comment le demandeur entrera en possession de son passeport.
Cette innovation entre dans le cadre de la dématérialisation des procédures administratives prônées par le président de la République. Une procédure de renouvellement du passeport à distance qui est aujourd’hui plus que nécessaire dans un contexte où la pandémie de la Covid-19 a limité les déplacements à travers le monde.
Cette réforme a été très bien accueillie par les Gabonais de la diaspora qui espèrent qu’elle va enter en vigueur dans les brefs délais.
SG
Budget 2021: le Gabon veut accroitre de 104% la part des ressources propres dans les investissements publics
Le Gabon mise beaucoup sur les investissements pour relever le secteur économique plombé par la crise actuelle. Pour l’année 2021, les dépenses d’investissement s’établiraient à 483,4 milliards FCFA contre 380 milliards FCFA en 2020, selon les prévisions de la loi de finances 2021 actuellement en examen à l’assemblée nationale.
Cette hausse de 103,4 milliards FCFA s’expliquerait selon les autorités par la volonté de la relance « post Covid-19 » de l’économie et d’achèvement des projets en cours. Ceci se traduit par l’accent mis sur les projets financés sur ressources propres estimés à 231,6 milliards de FCFA (+104%).
En plus des ressources propres, les dépenses d’investissements seront financées par trois autres types de ressources. A savoir, les fonds de concours à hauteur de 17 milliards FCFA, les financements extérieurs pour 232,7 milliards de FCFA et les partenariats public-privé pour 2 milliards de FCFA. La part prévue pour ce dernier point est en chute drastique. Car, de 30 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative 2020, les ressources issues des partenariats public-privé dégringolent à 2 milliards de FCFA.
Ces ressources vont être mises à contribution pour le financement des projets structurants dans le pays parmi lesquels la transgabonaise, dont les travaux ont déjà été lancés, ainsi que les différents projets infrastructurels engagés par le pays.
Cependant, comme le note le FMI dans son rapport d’assistance technique sur l’évaluation de la gestion des investissements publics au Gabon entre 2010 et 2019, l’allocation des ressources pour les dépenses d’investissements est parfois plombée par certains manquements, liés notamment à l’absence d’une planification bien coordonnée. Ce qui limite considérablement l’impact des investissements publics sur la croissance du pays.
Il faudrait donc une meilleure allocation de ces ressources afin que l’investissement public au Gabon joue un rôle moteur sur la croissance du pays au cours de l’exercice 2021.
Sandrine Gaingne
Le Gabon est le 2e pays le plus attractif de la Cemac pour les investisseurs selon le classement Deloitte
Selon le classement sur l’Index d’attractivité des investissements en Afrique 2020, publié par Africa CEO forum et le cabinet Deloitte, le Gabon est le 2e pays de la zone Cemac (Communauté économique et monétaire des États de l’Afrique centrale) le plus attractif pour les investisseurs.
Le pays qui arrive au 24e rang sur le plan africain est devancé dans la sous-région par le Cameroun (1er en zone Cemac et 16e en Afrique). Il est suivi par le Congo, la République centrafricaine, le Tchad (tous 36e ex aequo en Afrique), et enfin la Guinée équatoriale (44e).
L’on constate qu’aucun pays de la Cemac ne figure dans le top 10 de ce classement, contrairement à sa soeur de l’Uemoa qui est représentée par deux Etats. Ce qui signifie d'après des analystes que la Cemac a du mal à convaincre les investisseurs sur sa capacité à créer un environnement propice à l’investissement privé.

Ce classement africain pour la 2ème année consécutive est en effet dominé par la Côte d’Ivoire qui se positionne comme le pays le plus attractif selon les investisseurs. Ce pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) est suivi du Kenya, Ghana, Sénégal, Rwanda, de l’Ethiopie, du Nigéria, du Maroc. Les derniers de la classe sont Comores, le Lesotho, l’Erythrée et le Burundi.
D’après le cabinet Deloitte, ce rapport est réalisé sur la base des réponses données par les chefs d’entreprises à la question sur l’attractivité des Etats et il n'est destiné qu’à analyser les conditions d'investissement ou la facilité de faire des affaires dans les pays en question.
SG
Gabon : le chiffre d’affaires global du secteur des télécommunications avoisine 250 milliards FCFA par an
Le secteur des télécommunications est devenu un important levier de croissance pour l’économie gabonaise. Cette performance est la conséquence des multiples investissements engagés dans le secteur, dont notamment la connexion des principaux centres urbains à la technologie 3G/4G.
En 2019, grâce au déploiement de la fibre optique et aux offres de box internet par les opérateurs, le secteur a enregistré une hausse d’activité dans ses principaux segments. En effet, le nombre d’abonnements au téléphone s’est établi à 3 millions, en hausse de 2,1%, conforté aussi bien par la téléphonie mobile que par le téléphone filaire, ce dernier ayant progressé aussi de 2,1%.
De même, le nombre d’abonnements internet a augmenté de 6,7% à 2,1 millions, grâce à internet mobile (+7%) et à l’amélioration de la couverture réseau via la poursuite des efforts de connexion de nombreux centres urbains à la technologie 3G/4G.
Par ailleurs, le nombre d’abonnements à la télévision satellitaire s’est accru de 1,6% à 337 745 clients, à la faveur des offres promotionnelles d’acquisition des kits (baisse des prix des kits). Résultats, le chiffre d’affaires global du secteur atteint aujourd’hui, près de 250 milliards de FCFA par an.
Les investissements réalisés par les opérateurs au cours de la période ont fortement augmenté (+75,8%), pour se situer à environ 56 milliards de FCFA. Ils ont été orientés vers l’acquisition de nouveaux équipements (fibre optique) et le passage à la 4G en vue de l’amélioration de la qualité des prestations. De même, les opérateurs ont investi dans les installations permettant l’accès des ménages à internet (fibre optique et box canal+). En matière d’emploi, les effectifs ont augmenté de 2,1% à 1028 agents pour une masse salariale quasi-stable à 16,2 milliards de FCFA.
Marcel Saint-clair Eyene
Arriérés de salaires : menace de grève illimitée à la Poste au Gabon
Les agents de la poste gabonaise pourraient entamer dès ce 2 novembre une grève illimitée pour exiger le paiement de leurs arriérés de salaires. Cette décision a été prise par le Syndicats national des agents de la poste (Synaposte) à l’issue de son assemblée générale tenue le 30 octobre dernier.
D’après le Secrétaire général adjoint du Synaposte, Chérubin Claver Byonne, tous les bureaux seront fermés dès ce lundi jusqu’au paiement intégral des trois mois d’arriérés de salaire que leur doit la Poste. Une somme qui leur permettrait de préparer avec sérénité la rentrée scolaire prévue dans quelques jours.
« Nous ne comprenons pas que cette société ait été redressée selon les dires du président directeur général, mais que le succès ne se ressente pas à travers les employés. Des employés qui sont dans la détresse totale car leurs enfants ne peuvent plus être scolarisés », se plaint Chérubin Claver Byonne.
La poste qui traverse une crise depuis plusieurs années est donc en passe de faire face à une nouvelle grève des employés après celle qui a duré 12 mois entre 2017 et 2018. Outre les arriérés de salaires, les employés de la poste dénoncent un management « approximatif » de leur président directeur général. L’on se souvient que ce syndicat avait porté plainte en février dernier contre le PDG de la Poste Michaël Adande pour sa gestion de l’entreprise. Cette plainte n’a pas encore abouti jusqu’à ce jour selon le Synaposte.
SG
Gabon : un plan de relance du secteur touristique après la crise du Covid-19, évalué 8,15 milliards de FCFA
Le gouvernement gabonais planche d’ores et déjà sur des pistes de relance du secteur touristique sinistré avec la crise du Covid. Le groupe de travail sur la relance de l’économie post pandémie commis par le gouvernement à cet effet, a esquissé quelques pistes de solutions.
Pour que le secteur puisse se hisser parmi les principaux secteurs contributeurs à la création de richesses et d’emplois du pays, les experts proposent la mise sur les rails d’un nouveau modèle de production et de consommation durables. De ce fait, la relance du secteur s’articule autour de trois composantes : créer une offre touristique innovante et attractive ; encourager le tourisme local et promouvoir la destination Gabon.
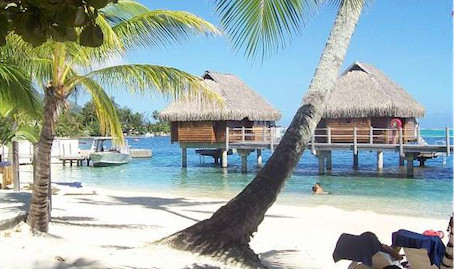
Ces différents axes devraient non seulement, permettre de diversifier le tourisme, d’accroître la compétitivité des voyages internes et intra régionaux, d’inciter les entreprises à distribuer des chèques vacances à leurs employés pour stimuler la demande, d’utiliser à plein le potentiel des réseaux sociaux.
La promotion de la destination Gabon et la constitution des fonds spéciaux pour attirer des conférences internationales et des événements, restent également de mise.
Toutefois, la mise en œuvre de ce plan de relance est cependant conditionnée par certains préalables, tempère le groupe de travail. En effet, souligne-t-il, la réussite de ce plan passerait par : le recensement des sites, opérateurs et activités sur l’ensemble du territoire ; le développement des produits innovants (écotourisme, tourisme communautaire, gorilles) ; la promotion et l’encouragement des circuits courts ; l’élaboration et la mise en place d’un protocole sécuritaire et sanitaire dans les sites touristiques et enfin l’aménagement de Zones d’Intérêt touristiques. Quant au coût financier de ces mesures de relance et d’accélération du redressement du secteur. il est évalué à 8,15 milliards de FCFA.
Marcel Saint-clair Eyene
Le Gabon veut réduire de 50% ses importations alimentaires d’ici 2022
Dans le souci de diminuer sa forte dépendance de l’extérieur, le Gabon envisage de réduire à l’horizon 2022, de 50% ses importations alimentaires qui coûtent actuellement près de 550 milliards de FCFA par an à l’Etat. Pour cela, une stratégie a été adoptée par les autorités, selon le ministre de l’Agriculture Biendi Maganga Moussavou, à l’occasion de la 31e conférence régionale de la FAO.
La stratégie consiste en la mise en place des réformes et mécanismes qui vont permettre de booster la production, la transformation et la consommation locale. Notamment, le développement des zones agricoles à forte productivité dans le but de promouvoir la culture de spéculations vivrières comme la banane, le manioc, le maïs, le riz et le soja, et l’élevage (avicole et porcin) à grande échelle. L’objectif d'ici 2022 étant d’atteindre une production de 20 000 tonnes de riz, 200 000 tonnes de maïs et soja, 51 000 poulets, 18 000 porcs, 40 000 bovins…
Cinq zones agricoles à fortes productivités ont été récemment créées par le gouvernement dans les localités de Kango et Andeme dans la province de l’Estuaire, Idemba et Mboukou dans le Ngounié et Bifoun-Abanga dans le Moyen Ogooué.
Egalement prévu par le gouvernement, le recensement général de l’Agriculture dont la deuxième phase a été lancée il y a quelques semaines. Ce recensement ambitionne d’actualiser les données dans ce secteur, afin de définir et d’ajuster les politiques publiques au niveau national et local. Des données fiables qui permettront de prendre les meilleures décisions pour le développement du secteur agricole.
La nouvelle stratégie prévoit aussi la fixation des prix incitatifs de rachat aux producteurs pour de meilleurs rendements agricoles ; la transformation et le stockage des produits agricoles ainsi que l’installation des aires de quarantaine aux frontières. La formation n'est pas exclue.
Des mécanismes et bien d’autres qui vont permettre, espère-t-on, d’atteindre cet objectif, encourager la consommation locale et réduire ainsi la forte dépendance du Gabon de l’extérieur. Aussi, de créer près de 20 000 emplois dans ce secteur d'ici 2023.
A noter que malgré les mécanismes mis en place jusqu’ici pour réduire la forte dépendance du pays de l'extérieur, les importations globales du Gabon sont croissantes d’années en années. En 2019, elles ont augmenté de 15,7% à 1446 milliards de FCFA selon les chiffres de la douane gabonaise.
Sandrine Gaingne
La Beac lance la dématérialisation du processus d’analyse des demandes de transfert de devises hors Cemac
Dans le cadre de la nouvelle réglementation des changes en vigueur depuis le 1er mars 2019 dans la Cemac (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad), Abbas Mahamat Tolli, le gouverneur de la Banque centrale (Beac), annonce la dématérialisation du processus d’analyse des demandes de transfert de devises hors de la sous-région.
« L’optimisation de ce processus de la dématérialisation a abouti à la mise en production depuis le 1er septembre 2020 d’une plateforme dénommée « eTransfer ». Cette application accessible à tous les acteurs permet aux banques et aux trésors publics de soumettre depuis leurs sites respectifs toutes leurs demandes, qui sont ensuite traitées par la Banque centrale », explique le gouverneur. Il précise qu’eTransfer permet d’assurer la traçabilité et la disponibilité des informations de suivi en temps réel, aussi bien pour les banques, les trésors publics, que les agents économiques initiateurs des dossiers.
Dans le cas particulier des agents économiques et dans le souci de célérité et de transparence, ajoute Abbas Mahamat Tolli, un portail dédié de consultation des dossiers émis a été intégré à cette plateforme. Ce portail dénommé « eTracking » qui est entré en production le 1er novembre 2020, est accessible à tous les agents économiques et aux comptables publics dont au moins un dossier de demandes de transfert est parvenu à la Beac via « eTransfer ».
Ces actions de la Banque centrale vise à prévenir la rareté des devises (artificielle ou non), ayant sévi dans la Cemac en 2019, par exemple. En effet, en mars de cette année-là, Abbas Mahamat Tolli avait fait une sortie au sujet des informations « infondées et totalement inexactes » relayées dans la presse, faisant état d'une crise de devises du fait d’une politique de rationnement entretenue par la Banque centrale.
Sur un ton menaçant, le gouverneur avait déclaré : « La Beac se réserve le droit de mener toutes les actions nécessaires, en particulier l'application des sanctions prévues par la réglementation des changes en vigueur, à l'encontre des banques qui, par leur pratique, entraveraient la bonne réalisation des opérations internationales des agents économiques ».
Abbas Mahamat Tolli avait alors invité tous les agents économiques dont les demandes de transfert seraient rejetées par les banques, au motif de la rareté des devises, d'en informer la direction nationale de la Beac de leur pays de résidence, avec tous les éléments justificatifs. Aux dires de M. Tolli, la Banque centrale dispose d'avoirs en devises permettant de couvrir largement les besoins des économies de la Cemac.
Sylvain Andzongo
Gabon : six entreprises reçoivent des agréments au Tarif préférentiel généralisé CEMAC
Ce 30 octobre 2020, le ministre du Commerce, Hugues Mbandiga Madiya a procédé à la remise des agréments au Tarif préférentiel généralisé CEMAC à six entreprises gabonaises, en présence du PM, Rose Christiane Ossouka Raponda, du président de la Commission de la CEEAC, du représentant-résident de la CEMAC au Gabon, et de plusieurs membres du gouvernement.
Les six entreprises pionnières de ce « Made in Gabon », à l’échelle régionale sont : Chimie Gabon, Soferga, Sogamatec, Sofavin, Pizolub, le Complexe agro-industriel du Gabon. Leurs sésames ouvrent l’accès au TPG CEMAC à plus de 70 produits issus du terroir gabonais qui seront exonérés des droits de douane.
Selon le ministre, Hugues Mbandiga Madiya, «cet événement constitue un moment clé dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale d’industrialisation initié depuis 2013 par le président de la République, Ali Bongo Ondimba ». Laquelle stratégie « permettant au pays de diversifier progressivement sa base de production et de de se doter d’un tissu industriel qui lui permet aujourd’hui d’afficher ses ambitions d’exportation dans le marché commun de la CEMAC », a-t-il précisé.
Le ministre Mbandiga Madiya a également lancé une invite aux entreprises gabonaises à plus d’audace et de créativité. « Je les encourage à soumissionner davantage lors de la deuxième session d’octroi d’agréments qui se tiendra prochainement car l’objectif pour cette année 2020 est de faire agréer plus d’une centaine de produits et cela pour un nouveau positionnement de l’industrie gabonaise dans le contexte communautaire », a-t-il déclaré.
Pour rappel, lors des travaux du Comité régional d’agrément au TAG de la CEMAC en février 2020, 304 produits avaient été évalués. Cet exercice qui vise à booster la croissance et l’intégration de la sous-région, a pour ambition d’atteindre 1000 produits à l’horizon décembre 2020.
L’agrément au TPG CEMAC a été institué en juin 1993. Elle fixe à taux zéro, les produits originaires de la CEMAC. Il constitue par ailleurs, le principal instrument de réalisation de la Zone de Libre-échange, du fait qu’il s’applique à tous les pays de la CEMAC, soit un marché de 52,2 millions de consommateurs.
Marcel Saint-clair Eyene
En 2019, la CEMAC a enregistré une inflation de 2,0 % en moyenne annuelle, en deçà de la norme communautaire de 3 % (Banque de France)
La Banque de France vient de publier son rapport économique et financier sur la zone CEMAC, UEMOA et l’Union des Comores pour l’exercice 2019. Malgré quelques légères différences, les trois monétaires affichent des indicateurs très semblables.
Dans le cas de la zone CEMAC, sous l’effet de la pandémie de Covid‑19, les perspectives économiques se sont fortement détériorées en 2020, indique le rapport qui révèle par ailleurs que l’activité économique a connu en 2019 une croissance de 2,1 %, en légère amélioration par rapport à l’année précédente (1,8 %), confirmant ainsi le redressement très progressif de la sous‑région, frappée à partir de 2015 par la crise des matières premières.
En matière d’inflation, à l’exception de la Guinée équatoriale (1,2 %) et du Tchad, qui a renoué avec une tendance négative (– 1,0 %), en 2019, le taux reste partout compris dans les autres pays de la CEMAC, entre 2,0 et 2,8 %. Cette situation résulte de la baisse des prix des produits alimentaires dans un contexte de récoltes abondantes.
En effet, les hausses de prix ont été alimentées par celles des biens importés, par la perturbation des circuits d’approvisionnement, par le relèvement de la fiscalité sur certains biens de consommation ou services (logement et restauration notamment) au Cameroun, au Congo et au Gabon, ainsi que par la hausse du coût des transports consécutive à l’instauration de péages routiers au Congo.
Dans le même temps, la production de biens alimentaires (bétail, produits vivriers) au Cameroun a été affectée par des conditions climatiques difficiles et par la persistance des tensions politiques dans les régions anglophones, avec un impact haussier sur le prix de ces biens.
Dans l’ensemble, le faible dynamisme de la demande intérieure et la baisse du coût de l’énergie ont néanmoins joué un rôle modérateur dans la progression de l’indice des prix en CEMAC.
Marcel Saint-clair Eyene