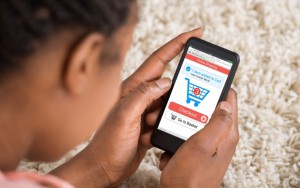Le Nouveau Gabon
Le Gabon importe pour 8 milliards FCFA de riz chaque année
En visite dans un champ d’expérimentation de la culture de riz dans la périphérie de Libreville le week-end dernier, le Premier ministre, Julien Nkoghe Bekale, a révélé que le Gabon importe 70 000 tonnes de cette céréale chaque année.
Un volume qui représente des dépenses de l’ordre de 8 milliards FCFA pour couvrir les besoins alimentaires des trois quarts de la population qui consomment le riz au quotidien.
Mais, d’après les autorités, le pays est en passe de devenir producteur de riz grâce à l’initiative portée par la chercheuse de l’Institut de recherche technologique, Yonnelle Moukombi, propriétaire d'un champ d’expérimentation financé par la coopération coréenne à travers l'Initiative de coopération alimentaire et agricole Corée-Afrique (KAFACI).
Mais ceci passe, selon la promotrice de l’exploitation par la mise en place d'infrastructures adéquates, la mobilisation des moyens et le renforcement de capacités pour la sphère agricole.
« Nos terres sont adéquates pour la culture du riz. Nous avions déjà effectué des tests. J’ai participé à la production rizicole avec l’Onader à Bikele », explique-t-elle.
Pour le Premier ministre qui était accompagné du ministre de l'Agriculture, l’Etat apportera le soutien à tous ceux qui veulent se lancer dans la production du riz en mettant à leur disposition des semences de qualité.
« Nous allons l’encourager pour que le ministère de l’Agriculture dispose, en toute saison, de semences de qualité et que ces semences soient mises à la disposition des compatriotes qui veulent se lancer dans la riziculture ».
PcA
Exécution du budget : le Premier ministre Julien Nkoghe Bekale redonne pleins pouvoirs à ses collègues
A la suite des dysfonctionnements et des écarts de conduite enregistrés dans la chaîne d’exécution des précédentes lois de finances depuis la mise en œuvre de la Budgétisation par objectifs de programme (Bop) au Gabon en 2015, le Premier ministre, Julien Nkoghe Bekale (photo), a décidé de replacer les membres du gouvernement au centre du jeu budgétaire en révisant les procédures d’exécution du budget.
Ce révirement consiste à responsabiliser davantage les chefs de départements ministériels à qui il incombe le devoir de reddition des comptes devant le Parlement et les juridictions compétentes.
En fait, assure une note d’information du ministère du Budget consultée par la presse locale, les ordonnateurs des crédits qu’étaient alors les directeurs généraux et les directeurs de programme, s’étaient émancipés du devoir de rendre compte et étaient devenus plus puissants que les ministres.
Du coup, les membres du gouvernement n’avaient plus le contrôle de la gestion des finances de leur ministère.
Fort de cela, le chef du gouvernement a décidé d’y mettre un terme. Car, assure le ministre du Budget et des comptes publics, Jean-Fidèle Otandault, il est question d’aller «dans le sens d’une plus grande responsabilisation des chefs de départements ministériels à qui il revient de rendre compte de l’exécution des crédits devant les parlementaires et les institutions habilitées à en examiner la gestion ».
«Les conséquences du changement se feront rapidement sentir puisqu’il sera désormais obligatoire d’assurer un reporting périodique adressé à l’ensemble des membres du gouvernement sur l’utilisation des crédits, en particulier, en matière de règlement et de performance.», précise-t-il.
«Plus personne, poursuit-il, ne pourra justifier devant les parlementaires, l’absence d’avancement ou les retards dans la mise en œuvre des politiques publiques par l’existence de la budgétisation par objectifs de programme.»
PcA
La Caistab poursuit l’extension de son réseau de stations-service communautaires
Dans l’optique de résoudre les difficultés d’approvisionnement en carburants rencontrées à l’intérieur du pays, d’étendre le mécanisme de péréquation des prix des produits pétroliers en zone rurale et de contribuer à l’aménagement du territoire, la Caisse de stabilisation et de péréquation (Caistab) a mis en place un programme de construction de stations-service dans les zones rurales, en partenariat avec l'opérateur Engen Gabon devenu depuis le 1er mars dernier Vivo Energy Gabon.
C’est ainsi qu’après les stations-service de Minvoul dans le Woleu-Ntem, nord du Gabon, c’était au tour de la localité de Mekambo le 16 mars dernier, dans la province de l’Ogooue-Ivindo, d’accueillir une essencerie communautaire.
Pour la Caistab, il s’agit de contribuer au soutien de la politique d’aménagement du territoire par le biais d'un mécanisme de péréquation offensive.
Entre autres objectifs poursuivis par ce programme, il s’agit pour le régulateur de contribuer à l’amélioration de la sécurité des populations dans la manipulation des carburants, freiner la vente illicite et anarchique des carburants, lutter contre le chômage et la pauvreté et renforcer la présence de la Caistab sur l’étendue du territoire national.
PcA
Selon Mohamed El-Kettani, PDG d’Attijariwafa, le franc Cfa est une monnaie «d’échange extrêmement importante»
En marge du Forum Afrique développement ouvert le 14 mars dernier à Casablanca au Maroc, le président-directeur général du groupe bancaire marocain Attijariwafa Mohamed El-Kettani (photo), s’est invité au débat sur le destin du franc Cfa, apprend-on dans la presse locale.
«Nous sommes les premiers collecteurs de l’épargne dans cette monnaie en Afrique de l’Ouest, qui est utilisée au sein de l’économie de cette sous-région. C’est une monnaie d’échange extrêmement importante.», a lancé le PDG d’Attijariwafa.
D’après lui, le franc Cfa «s’intègre dans des unions où s’imposent des règles de gestion, tant sur le plan budgétaire, des équilibres macroéconomiques que d’une politique monétaire qui est régie par une banque centrale régionale, que ce soit dans l’UEMOA ou la CEMAC».
Aussi, faut-il selon Mohamed El-Kettani, s’attaquer aux réformes économiques dans les pays concernés, plutôt qu’à la monnaie qui, selon ses explications, ne pose aucun problème.
«Le plus important je pense serait d’accélérer les réformes déjà engagées pour le Doing Business. C’est dire qu’on devrait avoir moins de bureaucratie, plus de digitalisation au service des peuples et des entreprises, et des politiques fiscales cohérentes.», confie-t-il.
PcA
Frappée d'interdiction de survol et d'atterrissage au Gabon, la compagnie Turkish Airlines remplace son 737 MAX 8 sur la desserte de Libreville par un 737-900
La compagnie de transport aérien Turkish Airlines, n’a pas attendu la nouvelle des autorités gabonaises interdisant le survol de son territoire et l’atterrissage sur son sol des Boeing 737 MAX 8.
En fait, trois jours après le terrible accident qui a coûté la vie à l’ensemble des passagers de la compagnie Ethiopian Airlines le 10 mars dernier, six minutes après son décollage, le transporteur turc qui effectue cinq rotations hebdomadaires dans la capitale gabonaise, a remplacé le 737 MAX 8 sur la desserte de Libreville par un Boeing 737-900. 24 heures après ce remplacement, les autorités gabonaises ont décidé d’interdire de survol et d’atterrissage, l’aéronef au Gabon.
«Plusieurs autorités de l'aviation civile ont procédé à l’interdiction de survol de leur espace aérien et d’atterrissage sur leur territoire, des Boeing 737 MAX à titre conservatoire. Dans cette même optique, plusieurs compagnies aériennes exploitant ce type d’aéronef, les ont cloué au sol.», indique l’Agence Nationale de l’Aviation civile du Gabon dans un communiqué repris par NewsAero.
«Compte tenu de ces circonstances, poursuit le communiqué, et bien que l’enquête n’ait révélé aucune cause à ce stade, convaincue que des investigations complémentaires doivent être effectuées par les autorités de certification de ce type pour s’assurer de leur navigabilité, l’Agence nationale de l’aviation civile suspend le survol de son espace aérien et l’atterrissage sur son territoire, de tous les avions Boeing 737 MAX.»
PcA
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations visite les sites de Rougier au Gabon
L'administrateur-directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), Herman Nzoundou Bignoumba, a effectué une visite des sites de Rougier Gabon dans le Haut-Ogooué, Sud-Est du Gabon en début de mois, en compagnie de Francis Rougier, président-directeur général du groupe et de Philippe Autié, ambassadeur de France au Gabon.
Cette visite des chantiers forestiers à Moyabi et Kélé, ainsi que de l'usine de sciage de Mbouma Oyali, intervient après l'annonce de l'adoption du plan de continuité de la multinationale forestière, mise sous contrôle judiciaire en mars 2018. Suite à cette situation, la CDC, actionnaire de Rougier Afrique International, qui détient l'ensemble des filiales opérationnelles, avait décidé de renforcer ses liens avec le management du groupe en s’impliquant davantage durant cette phase, indique une note d’information de la CDC.
Ainsi, rapporte la note d’information, la restructuration profonde du groupe a permis d’adapter sa structure opérationnelle et financière aux besoins de ses activités, notamment par la cession des activités déficitaires et des actifs non stratégiques. Aussi le groupe a-t-il définitivement recentré ses activités sur les productions forestières et industrielles au Gabon et au Congo, ainsi que leur commercialisation.
Propriétaire des chantiers forestiers Ivindo, Mikongo, Babylone et Kouma au Gabon, la multinationale dispose également d’une usine de sciage à Mevang dans le Moyen-Ogooué, Centre du Gabon et de déroulage à Owendo à Libreville.
La société qui emploie localement 1 200 personnes, exploite près de 934 000 hectares de forêts pour une production qui s’établit à 280 000 m³ de grumes par an.
PcA
L’utilisation des smartphones au cœur de la célébration de la Journée mondiale des droits des consommateurs au Gabon
Le Gabon, à l’instar de la communauté internationale, a célébré la journée mondiale des droits des consommateurs ce 15 mars. Du thème international : « Les produits connectés de confiance », les manifestations et les échanges organisés cette année ont porté sur le thème : « L’utilisation des smartphones, opportunités et risques ».
A la faveur de cette cérémonie, le ministre délégué à l’Economie, de la Prospective, de la Programmation du développement, chargé de la Promotion des investissements Publics et Privés, Hilaire Machima, a tenu à situer le contexte ainsi que le choix porté sur ce thème. « Le choix de ce thème national trouve sa justification dans l’usage quotidien et multiforme des smartphones ou téléphones intelligents par la très grande majorité des consommateurs que nous sommes tous.», a-t-il déclaré dans son allocution de circonstance.
Selon le membre du gouvernement, aujourd’hui, les téléphones dits intelligents offrent d’autres services qui améliorent sans cesse l’accès à l’information et les conditions de vie des consommateurs. Autrement dit, « le smartphone est donc devenu un véritable compagnon du consommateur gabonais dans sa vie quotidienne.», a-t-il indiqué.
Toutefois, a-t-il tempéré, il n’en demeure pas moins que leur usage incontrôlé présente un certain nombre de risques pour le consommateur. « En effet, ce dernier n’est pas tout le temps à l’abri d’escroquerie en ligne, de tromperie et même de certains risques sanitaires relatifs à l’utilisation continue des smartphones.», a-t-il fait savoir.
Dans ce cadre, soucieux d’améliorer les conditions de vie des populations, et d’assurer la protection des consommateurs, le gouvernement a mis en place, un cadre propice pour accompagner l’usage des produits connectés dans notre pays. Cela, avec la réalisation d’importants investissements afin de couvrir le territoire national en matière d’accès à la téléphonie et à l’Internet.
Outre ces investissements, des mécanismes ont également été mis en place pour réduire significativement leurs coûts afin de les rendre accessibles au plus grand nombre.
Par ailleurs, a souligné Hilaire Machima, « le cadre juridique sur les télécommunications a été réformé permettant ainsi de prendre en considération toutes les évolutions technologiques notamment la 3G/4G, la fibre optique, d’une part, et de protéger désormais les consommateurs contre de nombreux abus, d’autre part. C’est dire que la vulgarisation de l’usage des produits connectés de confiance reste une priorité pour le gouvernement ».
Cependant, certains défis restent encore à relever notamment en matière de transparence dans les transactions commerciales par les opérateurs et le traitement diligent des conflits par les organes de contrôle et de régulation.
Au terme de son propos, M. Machima n’a pas manqué de rappeler que la célébration de cette journée offre l’opportunité d’échanger sur tous ces enjeux liés à l’utilisation des smartphones.
Stéphane Billé
Depuis 2012, les exportations françaises en direction de la Zone CEMAC ont enregistré une chute de 38,9 %
En matière d’échanges commerciaux, la France perd progressivement du terrain dans les pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEMAC).
En 2018, ses exportations françaises à destination de ces pays se sont à nouveau contractées en 2018 (-1,8 % à 1 419 millions d’euros) et ce, pour la sixième année consécutive.
Selon les services de douanes françaises, au total, depuis 2012, les exportations françaises ont enregistré une chute de 38,9 %. La principale cause de cette contre-performance réside au niveau du ralentissement économique généralisé qui a prévalu ces dernières années dans cette zone, et qui s’est notamment traduit par une baisse des importations des pays de la CEMAC (-23,9 % à l’échelle de la zone entre 2014 et 2017).
A cela s’est ajoutée la crise économique déclenchée par la chute des cours des matières premières en 2014 qui n’a fait qu’amplifier cette tendance qui s’était en réalité engagée dès 2013.
Toutefois, la reprise qui semble se dessiner depuis plusieurs mois met en lumière les difficultés des opérateurs français qui, malgré le rebond de la croissance et des importations en Afrique centrale (+7,2 % en 2018 selon les estimations du FMI), peinent toujours à défendre leurs positions.
Le rythme de baisse s’est certes ralenti par rapport aux années précédentes (-20,0 % en 2017 et -13,6 % en 2016), mais cette évolution se révèle plus inquiétante dans la mesure où les ventes des principaux concurrents de la France – la Chine en tête, mais également la Belgique, les Pays-Bas, l’Italie, etc. – se sont redressées en 2017.
Après avoir fait jeu égal avec la France entre 2014 et 2015, la Chine a conforté sa place de premier fournisseur de la CEMAC, acquise en 2016, à la faveur d’un rebond de ses exportations de 8,7 % en 2017.
Malgré tout, la France se console tout de même avec la reprise de ses exportations vers certains pays notamment, la Guinée équatoriale (+53,7 %), le Gabon (+6,3 %) et la RCA, (+2,7 %), alors que la baisse était généralisée au niveau de la zone en 2017.
Stéphane Billé
Pour le Premier ministre, l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences doit s’adapter au contexte difficile
Le directeur général de l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (Aninf), Alex Bernard Bongo Ondimba, a fait le point des activités de cette structure avec le Premier ministre le 13 mars dernier.
Il en a profité pour présenter les missions, les réalisations ainsi que l’état d’avancement du portefeuille projets du plan sectoriel Gabon numérique au chef du gouvernement lors de cette séance de travail.
S’agissant des difficultés rencontrées dans l’exécution de ses missions, Alex Bernard Bongo Ondimba a exprimé le vœu de bénéficier de financements supplémentaires permettant à l’Aninf d’atteindre un certain nombre d’objectifs et de boucler la réalisation de nombreux projets.
Car, souligne-t-il, depuis 2015, l’Agence ne jouit plus de dotations budgétaires en investissements, et enregistre de ce fait une baisse de 80% de son fonctionnement. Une situation qui freine considérablement ses activités, poursuit-il.
Pour le Premier ministre, la stratégie gouvernementale consistant à rationaliser, optimiser et maîtriser les dépenses publiques, ne peut aboutir à des résultats probants sans un système informatique fiable. Toutes choses que seule l'Aninf peut garantir au regard de ses missions et des réalisations à mettre à son actif.
Ainsi, assure le Premier ministre, l’Aninf sera épargnée par la campagne de suppression de certaines agences gouvernementales et entités publiques dont le but vise la réalisation d'économies budgétaires à l’Etat.
Cependant, indique Julien Nkoghe Bekale, si le gouvernement mettra à la disposition de l’Agence des budgets appropriés, celle-ci doit s’adapter au contexte difficile et optimiser ses processus.
PcA
Selon Robert Masumbuko, la BAD a des engagements de plus de 500 milliards Fcfa au Gabon
Au cours de l’audience avec le premier ministre le 13 mars dernier, Robert Masumbuko (photo), représentant-résident de la BAD au Gabon, a indiqué que l’institution financière panafricaine développe de nombreux projets avec le pays.
Ceux-ci s’étendent de la construction de routes à l’agriculture et l’élevage, en passant par l’adduction d’eau potable, les infrastructures énergétiques, sanitaires ou encore dans le domaine de l’éducation. «Nous avons l’ambition de faire du Gabon, un exportateur de certaines chaînes de valeur telles que le poulet.», confie Robert Masumbuko.
D’après lui, la BAD dispose de ressources suffisantes pour permettre à tous les acteurs institutionnels, privés ou étrangers de développer des projets dans le pays. «Nous avons des ressources pour le Gabon dans le secteur public, privé et aussi pour les partenaires étrangers qui souhaitent co-investir.», renchérit-il.
Robert Masumbuko indique que son institution a une activité qui dépasse 500 milliards Fcfa d’engagements pour le Gabon et ne compte pas s’arrêter là.
PcA