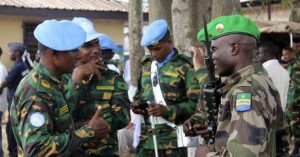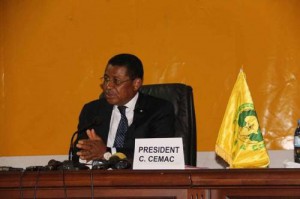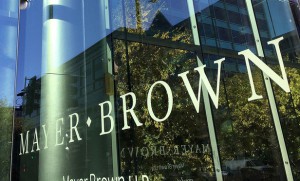Le Nouveau Gabon
Le gouvernement réorganise le fonctionnement des CHU
Quatre projets de décrets portants sur le statut des centres hospitaliers universitaires (CHU) ainsi que sur l’ouverture de ceux nouvellement inaugurés, ont été pris en conseil des ministres le 8 mars 2018.
Pour ce qui est du fonctionnement de ces établissements sanitaires, les missions, les principes et règles de fonctionnement, la catégorisation, l’organisation de la tutelle, les modalités de mise en place ou d’ouverture, de regroupement, d’éclatement ou de liquidation sont désormais définis par un nouveau cadre juridique et réglementaire.
Etablissements de santé hospitalier de niveau tertiaire de la pyramide sanitaire, les CHU ont pour mission, d’assurer la mise en œuvre de la politique nationale de santé en matière de diagnostic, d’exploration, de soins préventifs, curatifs, de réhabilitation, de formation en médecine, en biologie, en odontologie, en pharmacie, ainsi qu’en matière de recherche, d’expertise et d’innovation.
Pour leur fonctionnement, ils sont désormais chapeautés par un conseil d’administration, une direction générale, une agence comptable, les instituts et centres spécialisés ainsi que des organes consultatifs.
Depuis 2009, le Gabon a opté pour la création des centres hospitaliers universitaires. L’ouverture et le fonctionnement de ces établissements sanitaires n’étaient jusque-là, pas encadrés par des textes spécifiques.
Libreville compte à ce jour, trois centres hospitaliers universitaires : Owendo, le CHU mère-enfant Jeanne Ebori et le CHU de Libreville. Le quatrième, celui d’Angondje, a été transformé en hôpital militaire.
PcA
Signature « très prochaine » de l’acte additionnel fusionnant de fait la Bvmac et la Bourse de Douala (Commission de la Cemac)
Au cours de son récent séjour à Libreville, au Gabon, le président de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac), Daniel Ona Ondo (photo), a devisé le 6 mars avec le président de la Cosumaf, Nagoum Yamassoum. Les deux personnalités ont notamment parlé de l’état d’avancement de la mise en œuvre de la fusion des deux marchés financiers de la sous-région. L'un est à Libreville (Bvmac) et l'autre à Douala (DSX).
Pour Daniel Ona Ondo la signature « très prochaine » de l’acte additionnel y relative, ainsi que la convention entre les deux entités (Bvmac et Bourse de Douala) donneront une impulsion significative au processus qui est « une des actions phares du mandat du gouvernement de la Commission ». Le Gabonais Daniel Ona Ondo n’a certes pas donné de délai mais, le programme des réformes économiques de la Cemac lui, prévoit le 30 juin 2019 comme date butoir pour l'achèvement de la fusion des deux bourses.
Pour mémoire, les chefs d’Etat de la sous-région ont décidé en octobre 2017, de fixer le siège du régulateur du marché financier régional à Libreville, et celui de la Bourse des valeurs mobilières régionale à Douala, au Cameroun. La Banque des Etats de l’Afrique centrale (Beac) joue le rôle de dépositaire central.
S.A
Crise centrafricaine : le Gabon va retirer ses forces de la Minusca
C’est eu égard au retour progressif de la paix et de la stabilité dans ce pays que le ministre de la Défense, Etienne Massard, lors du Conseil des ministres, tenu le 8 mars 2018, au palais du bord de mer, a demandé l’autorisation d’entamer le retrait des forces de défense gabonaises engagées dans la mission de maintien de la paix en République centrafricaine, depuis 2016.
En effet, au cours de l’année 2016, le Gabon, dont les soldats ont, de tout temps, été présents dans les multiples crises sécuritaires qui ont perturbé l’ordre et la stabilité de la RCA, a déployé 450 soldats à Bangui, dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations Unies pour la Centrafrique (Minusca). L’objectif de ce déploiement visait à contribuer à la stabilisation du pays, suite à la crise sociopolitique de 2013.
En attendant l’aboutissement des démarches que doivent engager les autorités gabonaises auprès des partenaires internationaux, le Conseil des ministres a prescrit aux ministères de la Défense et des Affaires étrangères, l’établissement d’un chronogramme de démobilisation dans «des délais raisonnables».
En rappel, la Minusca est dirigée par le général gabonais Parfait Onanga-Anyanga, depuis août 2015.
Pierre Célestin Atangana
La filière hévéaculture poursuit ses contre-performances
Selon la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale (DGEPF), la filière de l’hévéaculture gabonaise a enregistré de nouvelles contre-performances, avec une dégradation des volumes usinés, indique au cours de l’année 2017.
En effet, souligne la DGEPF, la production de caoutchouc naturel en fonds de tasse a reculé de 8,6%, s’établissant à 26 233 tonnes, contre 28 699, un an plus tôt, notamment, du fait des intempéries qui ont occasionné la perte concomitante dans les plantations dédiées à la saignée et celles consacrées au « replanting ».
Parallèlement, la transformation de caoutchouc humide en granulé, s’est dépréciée de 4,9% pour un volume de 14 191 tonnes en 2017 contre 14 917 tonnes en 2016.
A l’inverse, les exportations de caoutchouc usiné ont augmenté de 6,3% pour atteindre 15 018 tonnes, grâce à l’amélioration de la logistique en vue de l’évacuation de la production.
Ainsi, le chiffre d’affaires, d’un montant de 15,152 milliards FCFA, a connu une hausse de 37,3% par rapport à 2016, soutenue par le relèvement des cours moyens mondiaux du caoutchouc naturel.
Stéphane Billé
Le Gabon a produit 1, 6 million d’hectolitres de bières en 2017
La branche de la production des boissons gazeuses et alcoolisées au Gabon a connu une baisse d’activités à la fin de l’année 2017.
Selon les données fournies par la Société des brasseries du Gabon (Sobraga) et Sovingab, la production totale de cette filière a reculé de 6,3%, pour un volume de 2,7 millions d’hectolitres, contre 2, 8 millions d’hectolitres en 2016, du fait de la faiblesse de la demande du marché domestique.
Ainsi, au cours de cette période, la production de bières s’est élevée à 1, 6 million d’hectolitres ; celle des boissons gazeuses à 961 024 hectolitres; les vins, 44 713 hectolitres et celle des divers à 44 474 hectolitres. A cause de cette situation, le chiffre d’affaires de la branche est passé de 167, 8 milliards en 2016 à 152,4 milliards FCfa en 2017, soit une régression de 9,1%.
La production d’eau minérale a quant à elle, enregistré une augmentation de 17,9% en 2017, pour un volume de 920 782 hectolitres. De même, le chiffre d’affaires s’est établi à près de 15 milliards de FCfa, enregistrant une hausse de 1%, grâce à la gamme Akewa, qui a considérablement boosté les ventes.
Par ailleurs, les interruptions enregistrées dans le réseau de distribution d’eau de la SEEG ont eu pour effet, de consolider la demande locale de l’eau minérale. Toujours au cours de l’année dernière, les effectifs ont été renforcés à 73 agents pour une masse salariale de 872,5 millions FCfa, soit une hausse de 7,4%.
Stéphane Billé
Une directive sur les partenariats public-privé dans la Cemac sera adoptée, cette année
Pour permettre une exécution réussie des projets inscrits dans le Programme économique régional (PER), l’implication du secteur privé apparaît nécessaire. C’est pourquoi le président de la Commission de la Cemac, Daniel Ona Ondo (photo), a indiqué que le rôle du secteur privé sera accentué, dès cette année, dans la réalisation des projets communautaires.
« Les domaines concernés par le PER sont ceux qui intéressent les investisseurs privés, surtout dans l’environnement actuel marqué par l’amoindrissement des capacités d’intervention de l’Etat », souligne le président de la Commission.
C’est pourquoi, indique-t-il, la Commission va préparer et faire adopter une directive communautaire sur le cadre législatif des partenariats public-privé (PPP) dans la zone Cemac, cette année, dans le but d’encadrer les interventions de ces acteurs.
« Pour relancer et diversifier les sources de la croissance, nos espoirs se fondent sur les énormes potentialités de développement qu’offrent les interventions du secteur privé », souligne Daniel Ona Ondo.
Pour mémoire, la réalisation des projets inscrits dans le programme économique régional sur la période 2017-2021, nécessite la mobilisation de 1000 milliards de FCFA. Une somme colossale qui exige des efforts de financements additionnels, en dehors des canaux institutionnels.
PcA
Affaire Veolia : le président du Conseil du commerce extérieur de la France chez le ministre de l’Economie
Après Dominique Renaux, ambassadeur de France près le Gabon, reçu par le Premier ministre dans la journée du 7 mars, c’est au tour de Didier Lespinas, président du Conseil du commerce extérieur de la France, d’échanger avec les autorités sur la situation des entreprises françaises au Gabon.
Le contexte économique particulier actuel marqué ces derniers temps par la rupture du contrat de concession de Veolia au Gabon par les autorités, cristallise inquiétudes et préoccupations au sein des patrons français présents dans le pays.
Pour Régis Immongault, «c’était l’occasion de faire le point sur l’actualité économique et financière du pays et de repréciser les choses», à la suite des évènements ayant conduit à la rupture de la concession détenue par Veolia sur le service public de l’eau et de l’électricité.
Si, selon Régis Immongault, l’échange a porté sur «ce que fait le gouvernement pour permettre aux opérateurs économiques d’être des partenaires crédibles dans le cadre du plan de relance économique», la question de Veolia a constitué un moment important dans cet entretien.
Suivant ses explications, c’était «l’occasion de repréciser les choses dans le sens où les relations entre l’Etat gabonais et Veolia ne concernent pas tous les opérateurs économiques».
C’est pourquoi, indique Didier Lespinas, l’essentiel des discussions aura porté sur cette question mais également sur le sort réservé aux dettes de l’Etat. «L’opération de réquisition de Veolia, qui a entraîné pas mal de bruit dans la presse, et qui n’était d’ailleurs pas toujours fondée», a donc été au cœur de l’entretien entre la délégation des conseillers du commerce extérieurs français et les autorités.
«Nous avons également abordé les arriérés de l’Etat, les petits dysfonctionnements qu’on peut remarquer dans le cadre de nos activités quotidiennes.», poursuit-il.
D’après Madeleine Berre, ministre de la Promotion des investissements, il n’y a pas de nuage entre l’Etat et les entreprises françaises. «Le Gabon a toujours été un pays ouvert avec qui les entreprises françaises ont toujours trouvé matière à investir. Des conventions fiscales ont toujours accompagné les investissements français. La situation est difficile, mais nous souhaitions que ces entreprises ne soient pas frileuses.», confie-t-elle.
Pierre Célestin Atangana
Veolia confie sa bataille juridique face au Gabon au cabinet américain Mayer Brown
Veolia confie sa bataille juridique face au Gabon au cabinet américain Mayer Brown
C’est La lettre du continent, dans sa dernière livraison, qui révèle l’information. La multinationale française a engagé le cabinet d’avocats américain Mayer Brown, pour attaquer le Gabon en justice.
Depuis le début de cette crise qui a dépassé le simple cadre des affaires, le groupe Veolia, qui vient d’être dépossédé de la concession du service public de l’eau et de l’électricité au Gabon, n’a pas fait mystère de son désir de porter l’affaire devant les tribunaux, notamment devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements basé en France (CIRDI).
Cette posture de Veolia a été renforcée par la sortie du Medef dans un courrier adressé aux autorités gabonaises le 26 février dernier, dans lequel, Pierre Gattaz, président du patronat français, confirmait l’enclenchement imminent d’une procédure judiciaire qui pour lui, devrait permettre que toute la transparence soit faite dans ce dossier et que la «justice soit rendue de façon loyale».
C’est la filiale française Mayer Brown qui va se charger de monter le dossier d’accusation contre le Gabon et d’assurer sa défense devant le CIRDI. D’après La lettre du continent, les équipes de Mayer Brown Paris sont régulièrement citées comme les meilleures dans les domaines du droit des affaires, la fiscalité et le droit bancaire.
S’agissant des conséquences juridiques de cette décision, les autorités gabonaises, réagissant au lendemain de la rupture du contrat de concession, ont indiqué que les aspects juridiques ont été sécurisés auprès de cabinets internationaux. En cas de procès, assurait le porte-parole du gouvernement, Alain Claude Bilie-By-Nze, « le Gabon a de bons arguments ».
Pierre Célestin Atangana
Affaire Etat gabonais – SEEG Véolia : Dominique Renaux lance un appel à un dialogue constructif et apaisé
Sortir de l’escalade verbale, mieux de la guerre des mots entre le gouvernement gabonais et le groupe français Veolia, après la rupture du contrat de concession pour la fourniture d’eau et de l’électricité qui liait les deux parties, tel est le message de l’ambassadeur de France au Gabon, Dominique Renaux au Premier ministre, Emmanuel Issoze Ngondet avec qui, il a échangé ce mercredi 07 mars 2018.
Pour les autorités françaises, seul un dialogue « constructif et apaisé » peut promouvoir des « partenariats fructueux » avec les milieux d’affaires pour accompagner le Gabon dans la mise en œuvre de son Plan de Relance Economique.
Autrement dit, selon des sources de la primature gabonaises, «Paris tente de calmer le jeu et soutient que, fort des liens séculaires qui nous unissent, les deux parties doivent trouver un point d’équilibre dans l’intérêt des deux contractants. »
Pour sa part, Emmanuel Issoze Ngondet, tout en regrettant les « quelques errements » notés çà et là, soutient néanmoins que le partenaire français avait des devoirs vis-à-vis de l’Etat gabonais et notamment des consommateurs qui étaient en droit d’exiger un service de qualité. Malheureusement « le compte n’y était pas.»
Dans l’ensemble, les autorités de Libreville partagent pleinement la vision des autorités françaises de s’inscrire durablement dans le dialogue et l’apaisement sur ce dossier.
Enfin, pour Dominique Renaux malgré « quelques aspérités, la relation privilégiée entre la France et le Gabon se porte bien. ».
Stéphane Billé
La Cémac prépare les textes d’application du nouveau code des douanes communautaire
Christian Bremeersch et Alain Charlet viennent d’être désignés par le département des finances publiques du Fonds monétaire international (FMI), pour participer au Comité de suivi de la valeur ayant en charge, la préparation des projets de textes du nouveau code des douanes communautaires, qui aura lieu du 12 au 16 mars 2018 à Libreville au Gabon.
Leur participation à ces assises se résumera en termes de conseils et avis au comité de suivi de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cémac) en charge de la préparation des textes d’application du nouveau code des douanes communautaires. En effet, cette rencontre s’inscrit dans le cadre du projet de code régional des douanes révisé, dont la version actuelle a été finalisée par le Comité de la valeur de la Cémac en mars 2017, avec l’appui d’experts du FMI et de l’Organisation mondiale des douanes.
Laquelle version, se veut conforme aux meilleures pratiques internationales avec l’Accord sur la Facilitation du Commerce, entré en vigueur en février 2017. Ce, du fait qu’elle intègre de nouvelles règles permettant le renforcement des capacités de collecte des recettes douanières et fiscales, et de lutte contre la fraude et les trafics illicites.
Pour preuve, au cours de la réunion du comité de la Valeur de mars 2017, les représentants ont reconnu l’intérêt d’anticiper la préparation des textes d’application et sollicité une assistance technique d’Afritac centre pour appuyer la rédaction des textes d’application prévus.
Stéphane Billé