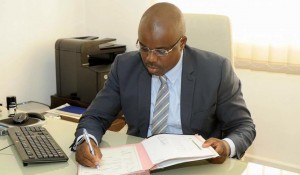Le Nouveau Gabon
Zone Cemac : Daniel Ona Ondo prescrit plus de résilience aux économies de la région
Les travaux du comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, ouverts le 2 février 2018 à Douala, au Cameroun, ont permis aux responsables des institutions communautaires, de tabler sur les défis économiques et financiers qui attendent les Etats de l’espace communautaire au cours de cette année.
Ainsi, s’adressant aux six ministres des Finances et de l’Economie de la zone, Daniel Ona Ondo (photo), président de la Commission de la Cemac, a indiqué qu’«une meilleure résilience des économies des Etats de la sous-région, permettra une plus grande diversification de l'économie et de lutter contre la pauvreté en zone CEMAC».
Car, quatre des six pays de la région, le Cameroun, le Gabon, le Tchad et la République centrafricaine sont sous-programme avec le FMI et la communauté des bailleurs de fonds dans le cadre de la Facilité élargie de crédit. Les négociations se poursuivent avec le Congo et la Guinée équatoriale.
De plus, en dehors du Gabon, de la RCA et du Cameroun, les autres pays sont en récession depuis 2016.
Grâce à la Facilité élargie de crédit, les pays sous-programme avec le FMI disposent de ressources additionnelles pour financer les réformes qui vont conduire au redressement des finances publiques, permettre de rattraper les déficits budgétaires et apurer la dette due aux entreprises, au travers d’une batterie de réformes courageuses qui vont de l’élargissement des recettes fiscales à la rationalisation des dépenses publiques.
«Une plus grande intégration de nos économies devrait s'accompagner de plus de solidarité et de cohésion entre les Etats de la CEMAC.», souligne le président de la Commission.
SeM
Après la réforme de l’ANPI, le capital social est passé de 500 000 à 100 000 FCfa
C’est au cours d’une matinée d’informations dédiée aux opérateurs économiques que l’Agence nationale de promotion des investissements du Gabon (ANPI), a présenté les nouvelles réformes adoptées en faveur des opérateurs économiques.
Il en ressort par exemple, s’agissant de la création des sociétés à responsabilité limitée (SARL), que grâce à la simplification des procédures, le capital social exigible de ces structures est passé de 500 000 à 100 000 FCfa.
Les opérateurs économiques, selon le représentant des commerçants à cette cérémonie, n’attendent que la simplification des procédures pour formaliser leurs activités, reprendre ou déclarer la cessation de celles-ci.
La directrice générale de l’ANPI Gabon, Nina Abouna (photo), a également entretenu les hommes d’affaires, les cabinets juridiques ainsi que les administrations présentes à cet évènement sur la simplification des procédures de création des SARL, la mise en place du formulaire unique issue des réformes du Haut conseil de l’investissement et la nouvelle procédure de création d’entreprises au guichet de l’investissement.
«L’intérêt était de partager toutes ces réformes qui ont été prises pour améliorer la procédure de création d’entreprises, sensibiliser les opérateurs économiques, les notaires et les cabinets conseils pour la prise en compte de ces réformes.», confie-t-elle.
Pour le cabinet conseil Grant Thornton, la mise en œuvre de ces réformes va permettre au pays de se hisser sur les standards internationaux en matière de création d’entreprises et de prise en charge des investisseurs au niveau du guichet unique.
SeM
Gabon Oil Company et GSEZ signent un accord pour le stockage des produits pétroliers
Gabon special economic zone, filiale locale de la multinationale singapourienne Olam, vient de conclure un accord avec Gabon Oil Company (GOC), portant sur la construction, la gestion et l’exploitation d’un terminal de stockage des produits pétroliers dans la zone portuaire à Owendo, rapporte la presse locale.
Cet accord participe de la volonté des deux entreprises à contribuer à un meilleur approvisionnement du pays en produits pétroliers ; sa mise en œuvre sera assurée par Gabon Oil Marketing, filiale de GOC, qui va disposer d’un terminal qui permettra de renforcer la capacité de stockage des produits dans le pays.
«Cette activité est portée exclusivement par la société gabonaise d’entreposage des produits pétroliers (SGEPP). Mais le risque permanent de rupture des produits sur le marché local, dû à la faible capacité de stockage du dépôt SGEPP et aux coûts élevés de logistique, a résolument amené la Gabon Oil Marketing à envisager la construction dudit terminal afin de permettre aux populations de s’approvisionner en tout temps en produits pétroliers.», explique Arnaud Calixte Engandji (photo), directeur général de GOC.
Sur le plan technique, l’on va assister à la construction et à l’installation sur le site de l’ancien parc à bois du port d’Owendo, de 13 cuves de stockage d’une capacité oscillant entre 2 000 mètres cubes et 6 000 mètres cubes.
Dans le respect des normes environnementales, un stationnement pour 14 véhicules de transport pour la distribution, sera également construit en même temps qu’une station de pompage contenant deux réservoirs de 1 293 mètres cubes chacun.
SeM
Havilah Resources investit 1 milliard de dollars dans le gisement de fer de Milingui au Gabon
L'exploitation du gisement de fer de Milingui, province de la Nyanga, au sud du Gabon, vient de se préciser avec la signature entre l'Etat gabonais et la compagnie minière Havilah Consolidated Ressources, d’un accord-cadre visant à engager les travaux sur le site. Basée en Afrique du Sud, la compagnie dirigée par le Professeur Baojin Zhao, entend investir 1 milliard de dollars, soit environ 600 milliards de FCFA dans le projet.
Les fonds seront mobilisés, selon les termes de l’accord, par African minerals exploration and development (AMED), un fonds d’investissement disposant dans son portefeuille de plusieurs projets miniers en Afrique subsaharienne, notamment en Afrique du Sud, en Namibie et au Libéria.
Pour le ministre des Mines, Christian Magnagna, cet accord signe la relance des investissements dans le secteur. «L'accord qu'on vient de signer, participe à l'aboutissement d'une longue négociation avec l'opérateur économique. Celui-ci permet donc d'engager définitivement l'exploitation du gisement de Milingui. C’est un véritable chantier : 40 ans d'exploitation minière dans la zone de la Nyanga et plus de 500 emplois en faveur de la jeunesse gabonaise», souligne-t-il.
Le gisement de fer de Milingui, découvert depuis les années 1950, situé près de Tchibanga, est le deuxième après celui de Belinga, dans la province de l’Ogooue Ivindo (nord-est du Gabon). Outre le minerai de fer qui représente 135 millions de tonnes dont 18 millions de tonnes dont la teneur est fortement concentrée, soit 50% de teneur, l’on y retrouve du cuivre, de l'or, du diamant, et d’autres minerais.
Pour plus d’opérationnalité, le groupe a créé Havilah Mining Gabon qui va se charger du développement de la mine en trois phases dont la première couvre la période 2018-2022.
Ces quatre premières années permettront aux ingénieurs de la compagnie de réévaluer les réserves, de construire une voie d’évacuation du minerai afin de couvrir la centaine de kilomètres qui séparent le site de l’océan Atlantique, et d’engager la production expérimentale.
Entre 2022 et 2025, période de la seconde phase de développement, la production expérimentale passera de 4000 tonnes à 8000 tonnes en un an, avant que la dernière étape qui va de 2025 à 2028 ne vienne parachever les ambitions de la société.
En plus du montage de l’unité de production qui engage les travaux dans deux mois, Havilah Mining Gabon entamera la transformation locale d’une partie du minerai ainsi que l’achèvement du port en eau profonde de Mayumba sur l’océan Atlantique.
D’après le ministre des Mines, l’entrée en production du gisement de Milingui entre dans le cadre du plan de relance de l’économie. Ce qui créera entre 500 et 700 emplois directs dans la zone.
SeM
Avantages fiscaux : la direction générale des impôts lance les audits
Pour donner corps à l’interpellation du directeur de cabinet du président de la République, Brice Laccruche Alihanga, faite le 30 janvier dernier au sujet des exonérations dont bénéficient certains opérateurs économiques, la direction générale des impôts a décidé de lancer la session des audits de ces avantages fiscaux.
A compter de ce 6 février, les entreprises ayant bénéficié d’avantages fiscaux divers, devront se présenter dans les services du fisc afin de fournir la preuve des investissements devant être réalisés en contrepartie de ces abattements, réductions d’impôts, exonérations et autres dispenses fiscales accordées par les autorités.
D’après la présidence de la République, les bénéficiaires d'avantages fiscaux disposent d’un mois pour apporter la preuve de l'existence de ces contreparties. «Passé ce délai et en l’absence de réelles contreparties, les exonérations seront annulées et les abus sévèrement sanctionnés.», avait prévenu le directeur de cabinet du président de la République.
Les pertes fiscales du Gabon ont culminé à 410 milliards Fcfa, en 2016. Si l’incivisme des contribuables et les multiples grèves des services fiscaux peuvent expliquer et justifier cette situation, le gouvernement entend gérer le problème en d’autres termes pour mettre les chefs d’entreprises au pas et exiger de ces derniers le respect des clauses du cahier des charges.
SeM
L’Afritac de l’Ouest et l’Afritac Centre renforcent les capacités des acteurs en matière de régulation et de supervision bancaires
Conjointement avec l’Afritac de l’Ouest, l’Afritac Centre a organisé un séminaire régional à Dakar, Sénégal du 22 au 26 janvier 2018, dans le domaine de la régulation et de la supervision bancaires, axé sur le thème de la supervision du risque de crédit selon les normes internationales et l’approche par les risques.
Selon les participants, ce thème était hautement sensible et porteur d’enjeux pour l’ensemble de l’Afrique subsaharienne. Cette rencontre a été une occasion de dialogues et d’échanges d’informations particulièrement intenses avec les experts et entre les autorités participantes elles-mêmes. Cela, grâce aux présentations détaillées effectuées par chaque délégation, complétées par celles des intervenants.
L’un des objectifs de ce séminaire ; promouvoir le partage des bonnes pratiques et la recherche de la convergence des cadres de supervision du risque de crédit dans l’ensemble de l’Afrique subsaharienne, a été atteint, et pourra se poursuivre au moyen des réseaux de contacts enrichis durant cet événement.
Sur le fond, les experts ont passé en revue les normes internationales les plus récentes applicables au risque de crédit, notamment la nouvelle méthode standard de Bâle III et l’IFRS 9, avec un focus sur un certain nombre de modes opératoires pour la mise en œuvre efficace des contrôles sur pièces et sur place. Les participants ont posé de très nombreuses questions et leur participation très active aux discussions atteste de la réussite de ce séminaire régional conjoint.
Outre Alexis Boher, conseiller résident en régulation et supervision bancaires à l’Afritac Centre, ce séminaire était animé par Eric Lemarchand, conseiller résident en supervision et restructuration bancaires à l’Afritac de l’Ouest, et par Gérard Granboulan, expert recruté par l’Afritac de l’Ouest.
Stéphane Billé
La Coface prévoit une conjoncture délicate en 2018, malgré une probable reprise de l’économie
Dans son analyse des risques pays, publiée la semaine dernière, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) indique une fragile reprise de l’économie gabonaise en 2018, en raison des lenteurs de la diversification.
Le leader de la protection contre les risques commerciaux, fait premièrement savoir que l’activité a ralenti en 2017 du fait de la baisse des prix du pétrole, dont dépend fortement l’économie gabonaise, et des mauvaises performances du secteur tertiaire. En outre, les obligations en matière de liquidité, ainsi que la conjoncture économique peu favorable, ont affaibli le secteur bancaire qui a accordé moins de crédits.
Fort de ces aléas, la Coface fait remarquer que la conjoncture restera délicate en 2018, même si une reprise est probable suite à l’augmentation des cours du brut. La part du PIB non-pétrolier devrait croître, notamment celle du secteur minier, de l’agroalimentaire et du bois. Car, dans le cadre d’un partenariat public-privé, l’entreprise singapourienne Olam a ouvert, en 2017, la plus grande usine de production d’huile de palme.
La production de manganèse restera quant à elle, dynamique en raison d’une demande soutenue, tandis que les secteurs du fer et du ciment pourraient rebondir après la baisse des commandes en 2017.
La Zone économique spéciale créée à Nkok afin d’inciter fiscalement le développement d’activités et d’attirer les IDE monte progressivement en puissance. Le nouveau port international d’Owendo construit par Olam (276 millions d’euros), inauguré en octobre 2017, devrait également jouer un rôle majeur dans le plan de relance de l’économie.
Dans le secteur agricole, le prêt de la Banque africaine de développement (BAD), d’un montant de 100 millions d’euros, à la fin de l’année 2017, permettra également de poursuivre les progrès effectués dans le cadre du programme agricole GRAINE pour réduire les importations gabonaises de denrées alimentaires.
Stéphane Billé
Forte implication de Sylvia Bongo Ondimba à la Journée citoyenne le 3 février dernier
La Première Dame, Sylvia Bongo Ondimba et ses équipes ont activement pris part à la Journée citoyenne le 3 février dernier. En collaboration avec la mairie de Libreville et quelques associations, elles se sont rendues à l’école publique d’Okala. Déterminés à montrer que la propreté de l’espace public est un acte civique, bottes et outils en mains, Sylvia Bongo Ondimba et ses collaborateurs ont retroussé les manches et mis la main à la pâte notamment, dans le nettoyage, le débroussaillage, la peinture, et le jardinage.
Au terme de ces moments d’échanges et de travaux, Sylvia Bongo Ondimba a tenu à planter un arbre. Un geste, selon son entourage, qui peut paraître anodin à certains, mais combien symbolique pour elle. « Planter un arbre, c’est planter la vie. C’est lutter contre les changements climatiques qui dérèglent les saisons. C’est rendre la nature plus belle, plus saine pour ses habitants, les jeunes comme les moins jeunes. En un mot, planter un arbre, c’est prendre notre destin en mains.», a-t-elle affirmé.
C’est donc une école propre et rayonnante qui accueille les élèves ce lundi matin. Par cette action de salubrité, la Première Dame du Gabon souhaite donner l’exemple et encourager la population à participer à la Journée citoyenne, tous les premiers samedis du mois.
Stéphane Billé
Le Vice-président de la Société financière internationale attendu au Gabon
Jingdong Hua (photo), le Vice-président chargé de la trésorerie de la Société financière internationale (IFC), effectuera une visite de travail, du 5 au 8 février 2018 au Gabon.
Durant son séjour, indique-t-on, il rencontrera les autorités gabonaises ainsi qu’une représentation des secteurs financier et privé gabonais. Avec ces différentes parties prenantes, il discutera du développement du secteur privé et de la création d’opportunités au Gabon.
Pour rappel, au mois de septembre 2017, l’IFC s’était déjà dite disposée à aider les Etats de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale (CEMAC), dans la mise en œuvre d’un marché financier fort, avec un focus sur les obligations corporatives émises en devises locales. Cette proposition faisait suite à une de ses récentes analyses indiquant que le secteur privé de cette sous-région avait besoin d’un marché financier efficace, afin qu’il puisse jouer un rôle plus accru dans le processus de redynamisation de l’économie sous régionale.
Selon l’IFC, le défi était important dans la mesure où le marché financier et celui global des capitaux, était très peu dynamique. Jingdong Hua faisait ainsi allusion à la bataille de leadership que se livraient les places boursières de Douala et de Libreville, qui détournait les investisseurs.
La Société financière internationale est une filiale du groupe de la Banque mondiale. Elle est la plus grande institution mondiale de développement dédiée au secteur privé au sein des pays émergents. En collaboration avec plus de 2 000 entreprises à travers le monde, elle met à disposition son capital, son expertise et son influence pour créer des opportunités et des marchés, là où le besoin se fait le plus sentir.
Au cours de l’exercice 2017, ses investissements à long terme dans les pays en développement ont atteint le montant record de 19,3 milliards de dollars. Ils ont ainsi permis d’engager le secteur privé dans l’éradication de l’extrême pauvreté et la promotion d’une prospérité partagée.
Stéphane Billé
Après le Tchad, c’est maintenant le Congo qui se trouve en situation très délicate avec les traders de pétrole et les banques
La situation complexe que traverse actuellement le Tchad avec Glencore Plc, le géant mondial du trading des matières premières, ne serait pas un cas isolé en zone CEMAC.
Ainsi, selon des sources auxquelles l'Agence Ecofin a eu accès, la République du Congo se trouve également en une situation délicate suite à des transactions menées avec des traders et des banques internationales.
Le pays d'Afrique centrale est aujourd'hui pointé du doigt par les agences de notation et des experts de l'économie de la sous-région au sujet de sa dette en forte hausse, et dont le montant ne serait pas très clairement défini. Selon certains commentateurs, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle des discussions pour un plan de relance avec le FMI peinent à avancer.
Bien que le pays ait obtenu le statut « conforme » dans le cadre de l'Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE), il n'a pas expliqué publiquement la situation de sa dette, que des chiffres alarmistes n'hésitent pas à présenter comme ayant atteint les 100% de son produit intérieur brut (PIB).
De sources crédibles, il ressort que le flou dans la dette congolaise, serait davantage lié à des engagements pris par sa société nationale pétrolière, la SCNP Congo, avec des traders et des banques internationales. Il se dit, que l’entité serait allée au-delà de ses pouvoirs, et aurait reçu de l’argent en avance, de la part d’un trader et de plusieurs banques internationales, pour du pétrole qui était censé être livré dans le futur, dans le cadre de ce qu’on appelle des contrats à terme.
C’est une pratique assez courante dans les transactions modernes, où deux parties peuvent convenir de la livraison d’une quantité de marchandise précise dans le futur, et le vendeur reçoit le prix convenu bien à l’avance.
Dans le cas du Congo, la Société Nationale Pétrolière devait livrer des quantités précises de pétrole. Mais elle ne dispose de ce pétrole que dans le cadre de ce qu’on appelle « un contrat de partage de production. »
La contrainte avec ce type d’accord, c’est que lorsque les prix du baril sont élevés, la part de production en baril, affectée pour la compensation des dépenses d’exploitation et d’exploration (fixées en dollar US) est relativement faible, et les parties dégagent des cargaisons importantes. Mais lorsque les prix baissent, il faut plus de baril pour compenser les dépenses et le volume des cargaisons des associés baisse d’autant.
Nous n’avons obtenu d’indicateurs précis sur le montant de dette concernée, parce que ni le contrat à terme avec les traders, ni les contrats avec les sociétés de productions pétrolières ne sont rendus publics. Mais en 2017, le gouvernement aurait décidé de reprendre la dette de la société des hydrocarbures et de procéder à une évaluation de son poids réel dans la dette publique globale du pays.
La situation n'est pas très éloignée de celle que vit le Tchad. Le pays du président Idriss Deby pour sa part, avait obtenu un prêt formel de Glencore et de banques internationales pour acquérir des actifs pétroliers. Le remboursement de la dette était adossé sur des volumes de pétroles à transférer. Avec la baisse des prix, le gouvernement tchadien recevait moins de cargaisons et ne pouvait honorer facilement ses engagements.
Que les pays soient victimes ou coupables dans des processus parfois très complexes, la question de la relation entre les Etats et leurs partenaires dans le secteur pétrolier, fait aujourd'hui l'objet de sérieuses discussions entre la banque centrale (BEAC) et les gouvernements de la CEMAC. L'institution d'émission monétaire a souhaité recevoir les contrats miniers et pétroliers, afin d'avoir une visibilité sur le poids des deux secteurs sur les revenus en devises.
Mais de sources proches à la BEAC, si les pays membres n'ont pas formellement marqué leurs refus, aucun n’a encore communiqué ces contrats à l'institution d'émission monétaire. La question ne manquera donc pas de faire l'objet de débats lors de la quatrième rencontre du comité de pilotage du programme de réforme économique de la CEMAC, qui se tient ce 02 février 2018 à Douala au Cameroun.
Un des piliers de ce programme est justement l'amélioration des relations avec les bailleurs de fonds, afin de poursuivre avec la consolidation des réserves de change. Or le Tchad se trouve dans une situation de quasi blocage avec le FMI en raison du dossier Glencore. Il n'est pas exclu, que la république du Congo soit en train d'avancer à petit pas sur son programme économique en raison du flou qui entoure la situation de sa dette publique.
Idriss Linge