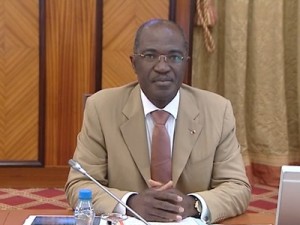Le Nouveau Gabon
Le Comité d'organisation de la Conférence nationale de leadership féminin au Gabon 2017 reçu par le ministre Blaise Louembé
Dans le cadre des préparatifs de la Conférence nationale de leadership féminin au Gabon 2017 qui se déroulera les 13, 14, et 15 juillet prochains, les membres du comité d’organisation ont été reçus en fin de semaine, par le ministre de l'Egalité des chances, Blaise Louembe (photo).
Au cours de cet entretien, Blaise Louembe a qualifié l'organisation de cette conférence de louable. Raison pour laquelle, il a émis le souhait que cette initiative puisse participer à la vulgarisation des lois et règlements en faveur de la promotion de la femme.
En tant que fervent promoteur de l'égalité des genres, il a enfin assuré le comité d’organisation de l'appui du ministère, pour la bonne tenue de cette conférence.
La présence du comité d’organisation de la Conférence nationale de leadership féminin au Gabon 2017 au ministère n’est pas fortuite. En effet, cette activité fait partie des initiatives que soutient ce département ministériel, à travers la mise en œuvre des politiques publiques pour l'égalité des chances à l'endroit des jeunes et des femmes.
Stéphane Billé
L’Afrique centrale planche sur l’éco-sécurité et le conflit Homme/Faune à Ndjamena du 25 au 28 juillet 2017
Du 25 au 28 juillet 2017 à Ndjamena (Tchad), le Secrétariat général de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (Ceeac), à travers le programme de conservation de la biodiversité, organise la Conférence des ministres de la sous-région sur la sécurité des ressources naturelles, le conflit homme/faune et les autres conflits liés à l’utilisation des terres en Afrique centrale.
L’objectif général de cette Conférence est de renforcer le dialogue politique pour permettre aux ministres d’adopter des outils politiques, stratégiques, sécuritaires et techniques opérationnels afin d’améliorer le système de la sécurité des ressources naturelles convoitées par des groupes armés. Il est aussi question d'atténuer le conflit homme/faune, notamment, celui entre l'homme et les éléphants, agriculteurs/éleveurs, orpailleurs/aires protégées, et le conflit permis miniers/aires protégées.
Les résultats obtenus et leur mise en œuvre devront contribuer sur le plan politique à la paix, la sécurité et la stabilité dans la sous-région Afrique centrale (Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, Congo, Tchad...). De même, les résolutions à l'issue des travaux devront accélérer, sur le plan économique, la transformation structurelle de l’économie des ressources naturelles d’une part, et le développement de trois segments de l’économie verte (l’écotourisme, l’économie des aires protégées et celle des parcs zoologiques) d’autre part.
S.A
Le gouvernement considère la Sobraga comme faisant partie des 10 premiers acteurs économiques au Gabon
En remettant des médailles de travail à 42 récipiendaires de la Société des brasseries du Gabon (Sobraga), le 7 juillet à Libreville, le ministre du Travail, Eloi Nzondo, a indiqué que cette entreprise fait partie des 10 premiers acteurs économiques au Gabon.
« Forte de ses 38 marques, générant près de 1 000 emplois directs et des dizaines de milliers d’emplois indirects répartis sur l’étendue du territoire national grâce à son réseau de distribution, la Sobraga est un partenaire clé sur lequel l’Etat s’appuie depuis plusieurs décennies pour asseoir sa politique gouvernementale en matière d’emploi.», a déclaré le membre du gouvernement.
En 2016 par exemple, la brasserie contrôlée par le groupe français Castel, a investi 4 milliards de Fcfa pour le seul mois de mai pour doubler sa production en eau minérale.
Selon Eloi Nzondo, la Sobraga s’est positionnée, de 1966 à 2017, par son poids économique, parmi les dix premiers acteurs économiques tous secteurs confondus (pétrole, mines, bois, etc.).
« Mais, au-delà de ces aspects purement macro-économiques, il me plaît de souligner entre autres, l’amélioration constante des conditions de vie et de travail de vos salariés, la mise en place des instances de promotion du dialogue social, toutes choses qui garantissent un climat social apaisé, propice à la prospérité de votre entreprise.», a félicité l’autorité.
S.A
Cuba et Libreville signent un partenariat dans le domaine de l’industrie médico-sanitaire
Le président de la République, Ali Bongo Ondimba (photo), a consacré la seconde journée de sa visite, le 10 juillet à Cuba, aux problématiques de la santé. Aux côtés de Léon Nzouba, ministre de la Santé publique et des dirigeants du Centre hospitalier universitaire de Libreville et de la Croix Rouge gabonaise, le chef de l’Etat a eu une séance de travail avec le ministre cubain de la Santé publique, Roberto Morales Ojeda, suivie d’un parcours d’inspection du Centre international de santé La Pradera.
Selon ce qui a été expliqué à la délégation gabonaise, le Centre La Pradera offre des prestations médico-hôtelières dans près de 80 pays dans le monde. Ali Bongo Ondimba s’est également rendu à l’Ecole latino-américaine de médecine, l’institution-phare où sont formés chaque année des centaines de médecins africains.
Adossés au Plan national de développement sanitaire 2017-2021 des autorités gabonaises, les accords conclus à La Havane induiront des bénéfices directs. Sont ainsi convenus le doublement sous trois mois des effectifs de la brigade cubaine dans les structures de santé, l'envoi planifié de 50 candidats gabonais aux études médicales à Cuba, le projet d’hôpital cubano-gabonais avec un programme de formation aux métiers de la santé, le conventionnement des évacuations sanitaires Cnamgs, etc.
Les avancées notoires dans le domaine de la santé qu’on observe dans le partenariat entre Libreville et Cuba s’ajoutent aux projets développés dans les filières du bois, de l’agro-industrie et de l’ingénierie touristique.
S.A
Seyni Nafo : « On va reconstituer le Fonds vert »
Lors de la dernière conférence des ministres africains de l’Environnement, tenue à Libreville, le président du Groupe africain des négociateurs sur le climat, s’est exprimé à travers plusieurs médias de la presse gabonaise sur la volte-face américaine quant à l’application des résolutions de l’Accord de Paris sur le climat, du financement du Fonds vert, de l’impact des changements climatiques sur les économies africaines, des efforts que doivent réaliser les Africains afin de mobiliser davantage de fonds auprès des guichets spécialisés, ainsi que des spécificités de la finance climat.
Il y a environ deux ans, lors de la Cop 21, à Paris, les pays développés avaient décidé d’apporter leur contribution financière aux pays non pollueurs. Mais depuis, pas grand-chose ne filtre de ce côté?
A Paris, nous avons, en tant que Groupe de négociateurs africains, recensé tous les engagements qui ont été pris par les différents organismes bilatéraux et multilatéraux, les fonds climat et autres. Le Fonds vert pour le climat qui est aujourd’hui le mécanisme international dédié pour financer la lutte contre les changements climatiques, a été capitalisé en 2014, un an avant Paris, à hauteur de 10 milliards de dollars. Ce fonds est d’ailleurs actif. L’Afrique y a sept administrateurs et il commence à décaisser. On a un portefeuille africain d’à peu près 4,3 milliards $ de projets. Ça, c’est un mécanisme. Les pays développés ont pris un engagement en 2009 pour mobiliser les fameux 100 milliards $ par an, à partir de 2020. Nous avons toujours demandé d’avoir une feuille de route. De savoir où nous en sommes dans la mobilisation de ces ressources-là. Combien vont à l’adaptation, à la réduction des émissions. L’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques, NDLR) a fait un rapport, il y a deux ans, pour nous indiquer que les pays développés étaient à peu près à 63 milliards de dollars par an. Donc ils doivent monter encore d’à peu près une trentaine de milliards de dollars pour 2020. Tous les ans, ils font un rapport sur cette mobilisation. Ce qui passe par le fonds vert, c’est spécifique. C’est les 10 milliards $. Les Etats-Unis avaient pris un engagement de 3 milliards $. Donc 30% de ces 10 milliards. Barack Obama avant de partir, avait déjà décaissé 1 milliard $. Il restait 2 milliards $ qui ne vont pas être décaissés puisque Trump a été clair sur le fait qu’il ne va pas les donner.
Avec le retrait des Etats-Unis de l’Accord de Paris, les Africains y voient déjà un échec de ce soutien. Quel en sera l’impact ?
Ça ne posera pas de problème dans l’immédiat parce que le Fonds lui-même ne décaisse pas encore 2 milliards de dollars par an. Puisqu’il a déjà décaissé à peu près 1milliard et quelques, il reste encore 6 milliards $. Donc on a encore trois années durant lesquelles on peut fonctionner si on reste à 2 milliards $ par an. Ce qui risque de se passer probablement, c’est que le Fonds doit être reconstitué. C’est-à-dire que quand on consomme 70% des ressources du fonds, on doit commencer un processus de reconstitution. Et le processus de reconstitution du Fonds vert va démarrer beaucoup plus vite que prévu parce qu’il n’y aura pas les 2 milliards $ des Etats-Unis. Donc, on n’arrivera pas à un moment ou à un stade où le fonds va arrêter de fonctionner. On va tout simplement le reconstituer beaucoup plus tôt que prévu.
En quoi la finance climat est-elle spécifique ?
La difficulté fondamentale avec la finance climat aujourd’hui, c’est une question d’accès. C’est-à-dire que les fonds existent, mais les pays africains, le secteur privé africain, les gouvernements, les collectivités territoriales ou locales ont des problèmes pour y avoir accès.
Lesquels ?
Généralement c’est un problème de capacité. C’est vrai que ce n’est jamais facile de mobiliser de l’argent à l’international parce que chaque fonds, chaque mécanisme a des standards, des modalités, des lignes directives, des procédures assez spécifiques. Il faut des capacités.
Quelles peuvent être ces capacités ?
Nous, nous pensons qu’il y a trois capacités fondamentales qu’il va falloir renforcer pour augmenter la chance des pays africains ou le potentiel de mobilisation de l’Afrique. La première, c’est la capacité d’intégrer le climat dans la planification du développement. Tout le monde fait de la planification. Ce qui est nouveau, c’est d’intégrer, c’est-à-dire comprendre quel est l’impact du changement climatique dans tous les secteurs, sur tous les territoires. Parce qu’il faut des outils, il faut des instruments, il faut des méthodologies pour pouvoir faire ça. Comprendre exactement quel est l’impact du changement climatique sur l’érosion côtière, sur la salinisation des sols, sur l’agriculture, sur l’énergie, sur le transport. Ça, il faut des études assez fines. Parce que, avant d’avoir accès au financement climat, la première condition c’est de pouvoir expliquer ou quantifier l’impact du changement climatique sur le secteur que vous voulez adresser. Deuxièmement, c’est un métier que de savoir formuler des projets et des programmes bancables. Ça s’apprend. Il y a des gens dont le seul travail c’est d’écrire des projets et des programmes bancables. Ça, en Afrique, on n'en a pas beaucoup. On n’a pas énormément de collègues au sein des administrations publiques ou même privées, qui ont la capacité de faire ce travail. La dernière capacité, c’est de pouvoir suivre et évaluer les progrès. Donc d’avoir des cadres, des méthodologies encore et des procédures de suivi-évaluation de l’impact de ce que nous faisons.
Quel pourrait être l’impact des changements climatiques sur les économies africaines ?
Ce qu’il faut savoir, c’est que la grande majorité des pays africains a des économies qui reposent sur la gestion des ressources naturelles. Et les changements climatiques induisent une raréfaction de ces ressources. Pour une grande majorité de l’agriculture africaine qui est une agriculture basée sur la pluie, quand il y a une déstabilisation du régime pluviométrique, ça rend la production agricole victime de ces changements-là. A cela s’ajoutent les inondations et les périodes de sécheresse qui provoquent une grande incertitude sur les économies, une grande précarité pour les populations également. Nous sommes à Libreville, donc sur la côte Atlantique, l’un des impacts les plus importants va être l’érosion côtière. Dans le Sahel et le Sahara, le plus grand impact va être l’avancée du désert. Il y a aujourd’hui un lien très fort entre dérèglement du climat et intensification du processus de désertification. Il y a aussi un lien très fort sur le système pluviométrique. Avec les changements climatiques, on a de plus en plus de mal à prévoir la saison des pluies. C’est-à-dire qu’il y a une interférence entre les deux systèmes tant en matière de fréquence de pluie, de quantité et de distribution par rapport à la saison. Tout ça induit énormément d’incertitudes et de risques par rapport à des économies qui sont basées sur la gestion des ressources naturelles et l’agriculture. Le dernier point, c’est la variabilité entre des événements climatiques extrêmes. Donc une alternance entre les inondations et les périodes de sécheresse qui s’intensifie.
Que faites-vous en tant que Groupe de négociateurs africains ?
Nous essayons, en tant que groupe de négociateurs africains, de mettre en place des programmes pour renforcer les capacités parce que les deux choses se tiennent. D’un côté, il y a des fonds, mais ces fonds-là répondent à des critères, à des procédures très spécifiques et, plus vous voulez des fonds, plus aussi on vous demande de respecter un certain nombre de critères, de procédures, de standards. Donc pas de prêts à taux zéro. Il y a des ingénieurs de gestion de projets pour pouvoir faire tout le cycle. Parce qu’il faut que vous fassiez un document pour mobiliser. Avec ce document il faut que vous expliquiez le lien entre le climat et ce que vous voulez faire. Ensuite, il faut mettre en place des mécanismes, des indicateurs de suivi-évaluation qui vont vous permettre de faire le suivi de la mise en œuvre de ce que vous faites. C’est un métier et nous sommes en train de travailler sur tous ces aspects.
SeM avec Matin Equatorial
Shell Gabon renforce la sécurité de ses installations pétrolières
Shell Gabon renforce la sécurité de ses installations pétrolières. La filiale gabonaise de la compagnie pétrolière anglo-néerlandaise Shell a posé un dispositif de sécurité maritime ultramoderne, sur la route du port de Port-Gentil, rapporte la presse locale.
C’est en réponse aux préoccupations sécuritaires inhérentes à cette zone, encombrée de débris et d’épaves de navires, que Shell Offshore Central Gabon (SOCG) a lancé, en 2015, une campagne de sécurisation des fonds marins dans l’optique de l’exploitation future du gaz au large des côtes du pays. Pour la stabilité des activités pétrolières dans la cité pétrolière, la sécurisation de cet espace dont le caractère stratégique n’est plus à démontrer, constitue selon les autorités portuaires et la compagnie, une importante contribution.
«Cette donation est d’un apport considérable dans la mesure où elle vient renforcer la signalisation sécuritaire maritime, notamment à l’entrée du quai DPS. Ces balises offrent désormais une meilleure visibilité, minimisant ainsi les risques d’accident dans cette zone.», indique le délégué provincial de la marine marchande, sur Direct Infos.
Pour le directeur de la SOCG, Cees van Eden, «les entreprises d’exploration sont généralement de nature temporaire en raison de la difficulté à mettre en œuvre de vastes plans d’investissements sur le long terme. Nonobstant cela, le Groupe Shell tient à conférer un caractère fondamental au volet social de ses investissements».
Le responsable néerlandais indique que la société a également offert des équipements informatiques aux écoles de Port-Gentil, et proposé l’installation de deux bouées marines pour marquer l’entrée du port de cette ville. Pour la compagnie Shell Gabon, la pose de ces balises permettra aux navires qui fréquentent la zone portuaire commerciale de Port-Gentil de disposer davantage de sécurité.
SeM
Le Gabon et Cuba veulent renforcer leur coopération dans l’agriculture
La visite officielle du chef de l’Etat gabonais Ali Bongo Ondimba, à Cuba, a été couronnée de succès. Le forum d’affaires organisé par les deux pays à La Havane pour explorer les possibilités de coopération dans divers domaines, a donné l’occasion à plusieurs chefs d’entreprises cubains et des décideurs gabonais, d’étudier les opportunités d’affaires existantes ou à améliorer.
Pour le président de la République qui a ouvert les travaux de ce forum, les partenariats mutuellement bénéfiques doivent guider la nouvelle coopération entre les deux pays. «Ce qui est important, c’est de vous dire la volonté des autorités gabonaises de non seulement renforcer nos liens avec nos partenaires cubains, mais surtout de les inviter dans un cadre gagnant-gagnant. La stabilité de notre pays est reconnue, les opportunités sont aussi reconnues.», explique-t-il à la communauté des Hommes d’affaires de La Havane.
Ainsi par exemple, dans le domaine agricole, les deux pays veulent monter une usine de production d’engrais, l’accélération du programme Graine ou encore la transformation locale des produits, afin de parvenir à l’autosuffisance souhaitée par le Gabon.
«Dans le secteur agricole, nous devons renforcer notre partenariat dans la production d’engrais, dans la chaîne de froid et dans la transformation locale des produits gabonais. Dans le cadre du projet Graine, nous souhaitons également proposer des partenariats dans ce secteur pour renforcer la production locale nationale.», indique Nina Abouna, directrice générale de l’Agence nationale de la promotion des investissements.
SeM
Jean Marie Ogandaga plaide pour un CAFRAD plus actif dans l’émergence du continent
A la faveur des assises de la 55ème session du Conseil d’administration du Centre africain de formation et de recherche administratives pour le développement (CAFRAD), tenues les 3 et 4 juillet 2017 à Rabat au Maroc, Jean Marie Ogandaga (photo), le ministre de la Fonction publique a décliné la vision du Gabon pour cette institution.
Selon lui, le Gabon milite pour un CAFRAD davantage performant, et censé servir l’émergence du continent. Le responsable gabonais a clairement indiqué que son pays entendait pleinement honorer tous ses engagements pour le fonctionnement optimal de cette institution et, partant, de toutes les autres organisations internationales auxquelles il appartient.
De même, relève-t-il, «il serait souhaitable que de vastes opérations de promotion médiatique soient menées dans les différents Etats pour que les activités du CAFRAD soient pleinement connues, aussi bien par les pouvoirs publics que par les populations». Une manière, selon lui, d’évoquer en filigrane, la possibilité pour l'institution, de disposer d'antennes ou de représentations dans les différents Etats membres.
Rappelons que le Centre africain de formation et de recherches administratives pour le développement (CAFRAD) a vu le jour le 13 mai 1964, à l’initiative du Royaume du Maroc, et de l’UNESCO. Il compte, à ce jour 36 Etats-Membres.
Stéphane Billé
Gabon Oil Company s’engage à viabiliser des parcelles sur un site de plus de 30 hectares à Akanda
Le ministère de l'Urbanisme, de l'habitat social et du logement et la Société nationale des hydrocarbures communément appelée Gabon Oil Company (GOC) ont signé, le 6 juillet, à Libreville, un protocole d'accord dans le domaine du foncier.
A cet effet, le ministre Bruno Ben Moubamba (photo) et l'Administrateur directeur général de la GOC, Arnaud Engandji, ont paraphé un accord lié au projet de la viabilisation des parcelles sur un site de plus de 30 hectares, situé dans la commune d'Akanda. Grâce à cette collaboration, plusieurs parcelles seront très prochainement achetées par les populations dans le besoin. Une démarche en phase avec l'objectif « un titre foncier pour tous » souhaité par le gouvernement gabonais.
La viabilisation des lots fonciers à Akanda revient au goût du jour après la suspension en novembre 2015, des demandes de permis de construire par l’Agence nationale de l’urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre (Anuttc). A l’époque, l’Anuttc avait indiqué que les permis de construire seraient à nouveau délivrés lorsque le conseil municipal aura validé le plan d’aménagement élaboré par l’Agence nationale des grands travaux et des infrastructures (Angt).
Akanda, situé dans le nord de Libreville, a la réputation d’une commune qui connaît de nombreux problèmes liés au foncier.
S.A
La réforme foncière expliquée par l’ANUTTC
L’Agence nationale de l’urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre national de l’urbanisme (ANUTTC), a engagé une campagne d’explications des réformes survenues dans le domaine foncier.
D’après Ida Rachel Moussavou, directrice générale adjointe de l’agence, la réforme a consisté en la réduction des étapes d’obtention des titres de propriété provisoires et définitifs sur les parcelles sollicitées par les usagers. Ce gain de temps leur a permis d’obtenir le titre foncier, désormais en 180 jours, au lieu de plusieurs années comme par le passé.
«Il fallait attendre au moins cinq ans et la procédure était complexe.», explique la Dga. Elle précise : «Le titre foncier n’est pas délivré par l’agence ; il est délivré par la conservation foncière. L’agence concourt à la délivrance du titre foncier».
Ce sont ces améliorations, souvent contenues dans les récriminations portées par la communauté des opérateurs économiques contre l’Etat, que l’ANUTTC a expliquées aux usagers.
SeM