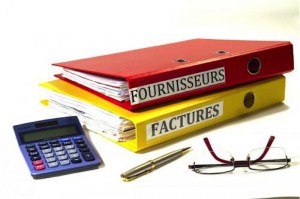Le Nouveau Gabon
Le parlement gabonais examine le projet de loi sur la gestion des produits phytosanitaires
Les techniciens de l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (Agasa) et ceux de l’Institut gabonais d’appui au développement (Igad) ont été auditionnés le 21 juin par les sénateurs au sujet de la proposition de la loi fixant le cadre juridique sur la production, l’importation, la distribution et la commercialisation des intrants agricoles au Gabon.
« La nouvelle loi est une loi d’avenir parce qu’elle va véritablement apporter un plus dans le cadre législatif phytosanitaire en République gabonaise et va nous permettre de renforcer nos opérations sur le terrain et nous permettra effectivement de protéger au mieux et davantage la santé des populations gabonaise », a indiqué le Dr Sylvain Patrick Enkero, directeur général (DG) de l’Agasa.
« L’Igad est une interface entre d’un côté les vendeurs de ces produits et de l’autre côté les utilisateurs. », a précisé Pascal Pommarel, DG de l’Igad. L’Igad et l’Agasa ont aussi fait un exposé sur les produits illicites dans ce domaine, le contrôle en la matière, la liste agréée des produits phytosanitaires.
Cette proposition de loi sera examinée au fond avant son éventuelle adoption lorsque la séance plénière sera programmée. Raison pour laquelle les sénateurs voulaient des outils d’analyses nécessaires pour un examen approfondi de ce texte, conscients de l’influence des produits phytosanitaires en matière de santé et d’environnement.
S.A
Le Gabon s’apprête à contracter un emprunt de 365 millions d’euro auprès de trois institutions financières internationales
Le Gabon s’apprête à contracter un emprunt de près de 365 millions d’euros auprès de la Banque africaine de développement (BAD), la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Bird) et de l’Agence française de développement (AFD).
A cet effet, le ministre de l’Economie, Régis Immongault Tatagani a défendu le 22 juin, quatre projets d’ordonnances autorisant le gouvernement gabonais à contracter des emprunts auprès de ces institutions financières internationales. Selon les explications du membre du gouvernement, il s’agira pour l’Etat de solliciter un premier emprunt de 200 millions d’euro auprès de la BAD pour le financement du Programme d’appui aux reformes économique et financières (PAREF). Ce programme vise en particulier, à renforcer l’assainissement des finances publiques grâce à une mobilisation accrue de recettes et une rationalisation des dépenses avec accent particulier sur la maîtrise de la masse salariale et de la dette publique. Sans oublier le renforcement de l’efficacité de l’investissement, tout en appuyant la diversification de l’économie à travers l’amélioration du climat des investissements, de l’accès au financement et de la compétitivité.
L’autre emprunt d’un montant 20,2 millions d’euro auprès de la Bird a pour objectif, entres autre, d’accroître la couverture géographique des réseaux à bande passante de grande capacité et l’utilisation de services régionaux d’internet à haut débit, ainsi que de réduire les coûts de services de communication sur le territoire national. Abordant l’aspect des caractéristiques techniques, le ministre Immongault a mentionné que cet emprunt constitue un financement additionnel à la quatrième phase du programme et comprend les composantes suivantes : l’environnement propice à la connectivité, la connectivité et la gestion du projet.
Quant au troisième emprunt d’un montant de 51,5 millions d’euro, toujours auprès de la Bird, il a pour objet d’améliorer la disponibilité et les délais de production d’information à l’appui des services de santé publique, de promouvoir le développement d’applications de e-santé. Dans son propos aux sénateurs, le ministre a affirmé que ce projet permettra de renforcer le dispositif de surveillance épidémiologique en utilisant les TIC pour collecter les données nécessaires et diffuser les informations d’alerte et de riposte.
Enfin, le dernier emprunt, de 93 millions d’euros, obtenu auprès de l’Afd est destiné au financement du projet de réhabilitation du Transgabonais, afin de doter le Gabon d’un axe de communication rénové et fiable entre Libreville et l’intérieur du pays, dans un souci de désenclavement de cette zone et de développement de son potentiel minier, a soutenu le ministre gabonais de l’Economie. L’objectif principal de ce projet est de redresser la situation opérationnelle et financière de la société d’exploitation du Transgabonais (Setrag).
Sylvain Andzongo
EMEA Finance honore le consortium FGIS-Eranove pour ses projets de Ngoulmendjim et de Dibwangui au Gabon
Le consortium composé du Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS) et du groupe industriel Eranove vient de remporter le prix du « Best Water Deal 2016 » (meilleur projet de développement hydraulique), décerné par le magazine EMEA Finance.
Cette distinction porte sur la conception, le financement, la construction et l’exploitation des centrales hydroélectriques de Ngoulmendjim et de Dibwangui. Et dont, les conventions de concession ont été signées le 21 octobre 2016 entre le consortium FGIS-Eranove et la République Gabonaise.
«Nous sommes très honorés de recevoir le prix EMEA Finance Best Water Deal 2016 pour les projets de Ngoulmendjim et de Dibwangui. Nous tenons à remercier le gouvernement gabonais pour la mise en place d’un cadre incitatif pour les producteurs indépendants dans le secteur de l’énergie au Gabon qui nous permet d’investir dans des projets tels que ceux-ci. Ce prix est le résultat des efforts des équipes FGIS/ Eranove qui ont su, grâce à leur expertise technique et à une volonté commune, aboutir à un projet de développement qui fournira à terme une électricité propre, de qualité et à prix maîtrisé » explique Serge Thierry Mickoto (photo), Administrateur -Directeur général du FGIS.
Et de poursuivre : « Ces deux ouvrages permettront au Gabon à la fois de mieux exploiter son immense potentiel hydroélectrique et de mieux satisfaire ses besoins en énergie, au grand bénéfice de ses populations et de son développement industriel».
La centrale de Ngoulmendjim, d’une puissance installée estimée à 73 MW (mégawatts), avec un productible annuel estimé de 500 gigawattheures (Gwh), sera située à 125 km de Libreville, sur le fleuve Komo. Quant à la centrale de Dibwangui, sur la rivière Louetsi, d’une puissance installée estimée à 15 MW avec un productible annuel estimé de 90 Gwh, sera, située à 152 kilomètres de Mouila.
Pour rappel, le magazine EMEA Finance, reconnu pour la qualité de ses analyses, récompense les meilleures pratiques de la finance dans le monde. Autrement dit, ce prix constitue donc une reconnaissance de la qualité de cet investissement.
Stéphane Billé
Le gouvernement a réglé 61,1 milliards de FCFA de dette publique au premier trimestre 2017
Au premier trimestre 2017, le gouvernement a réglé 61,1 milliards de FCFA de la dette publique au premier trimestre 2017, contre 68,0 milliards de FCFA à la même période en 2016. Cette évolution s’explique principalement par le recul du volume de paiement de la dette intérieure.
Le règlement de la dette extérieure a été consacré au paiement de la dette commerciale (62,8% du montant), aux créanciers multilatéraux (24,0% du montant total réglé sur la dette extérieure) et à la dette bilatérale (13,1% du montant total réglé sur la dette extérieure). Comparativement à 2016, le règlement de la dette extérieure a progressé de 14,6% au premier trimestre 2017, du fait principalement de la hausse du règlement de la dette commerciale (31,0%).
Le paiement de la dette intérieure a concerné le règlement de la dette bancaire (52,6% des règlements intérieurs), moratoire (27,4% des règlements intérieurs), divers (18,8% des règlements intérieurs) et marché financier régional (1,2% des règlements intérieurs). Comparativement au premier trimestre 2016, le règlement de la dette intérieure a diminué de 38,8% pour s’établir à 19,4 milliards de FCFA.
La baisse du volume de paiements concerne uniquement la dette intérieure.
Stéphane Billé
Le bilan de l’Office des ports du Gabon affiche 70 milliards de FCFA en 2016
Le conseil d’administration de l’Office des ports et rades du Gabon (Oprag), tenu le 22 juin à Libreville, a révélé que la société a souffert de la conjoncture défavorable qui affecte l’économie dans son entièreté.
Cette situation a eu pour effet de dégrader les produits d’exploitation de 7,8%. Ils passent ainsi de 15,511 milliards de FCFA en 2015, à 14,306 milliards de Fcfa en 2016. En ce qui concerne la valeur ajoutée des activités portuaires, elle est en baisse de 22,2% à 8,06 milliards de Fcfa, contre 10,104 milliards de Fcfa en 2015.
La plus forte reculade concerne l’excédent brut d’exploitation qui plonge de 47%, passant ainsi de 4,136 milliards de FCFA en 2015, à 2,191 milliards de Fcfa en 2016.
Le bilan de l’Oprag révèle cependant qu’en 2015, la situation patrimoniale de l’entreprise présente un total bilan de 69,257 milliards de Fcfa contre 70,339 milliards de Fcfa au 31 décembre 2016. Bien que le résultat net de l’entreprise soit en baisse de 9%, celui-ci reste en hausse et affiche une performance de 683 millions de Fcfa en 2016 contre 621 millions de Fcfa en 2015.
SeM
Dette intérieure : le gouvernement se donne deux ans pour régler les factures des PME
Au lendemain de l’accord de prêt du FMI de 642 millions de dollars au Gabon, le ministre de l’Economie, Régis Immongault (photo), a réuni, le 21 juin, les opérateurs économiques du secteur des PME ainsi que le Comité d’audit de la dette intérieure, la direction générale de la dette et les différents syndicats du secteur privé, afin de discuter des créances en souffrance au Trésor public, dues à ces entreprises depuis des années.
Au cours de la rencontre, il a été procédé à la signature des conventions avec ces patrons de PME qui réclament le paiement de 100 milliards de Fcfa de factures à l’Etat.
D’après Régis Immongault, le conclave du jour entrait dans le cadre des mesures visant à apurer les arriérés de paiement de cette dette dont les retards de paiement s’accumulent depuis un certain temps.
«Nous avons déjà eu cette cérémonie avec le patronat. Pour les petites et moyennes entreprises qui sont concernées, une commission d’audit avait été mise en place au ministère du Budget et les travaux avaient été définis sur la base de l’audit réalisé.», explique le ministre.
Les conventions signées avec les patrons des entreprises après l’examen de la situation fiscale des uns et des autres, pourront servir au refinancement de ces structures auprès des banques locales. Car, celles-ci, à la manière des titres publics, pourront être cédées aux établissements bancaires afin de mobiliser des fonds.
«Nous sommes donc dans la phase de signature de ces conventions.», souligne le responsable qui a rassuré les chefs d’entreprises que le gouvernement se donne un ou deux ans, en fonction des dossiers des entreprises, pour régler définitivement cette dette.
SeM
Le gouvernement transforme le CHU d’Angondjè en hôpital militaire
A la faveur du conseil des ministres du 21 juin, il a été décidé du transfert du Centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angondjé au service de santé militaire du ministère de la Défense nationale.
Cette mutation se justifie, selon le communiqué du conseil des ministres, par la saturation des structures sanitaires de l’Armée. «En effet, au regard de la capacité des structures d’accueil du Service de Santé Militaire qui se réduisent devant l’afflux important des malades; et afin de permettre ainsi un meilleur quadrillage hospitalier au Gabon.», souligne le communiqué du conseil.
A la suite des nombreuses grèves des personnels de santé des hôpitaux publics qui secouent le pays et notamment Libreville, l’hôpital d’instruction des armées ne parvient plus à offrir les soins à l’ensemble des patients. Ce qui entraîne des désagréments sur la santé des malades; les services sont, par ailleurs, obligés d’encadrer certaines prestations afin de donner la chance à tous de bénéficier des consultations d’un spécialiste.
SeM
Le Gabon veut renforcer les lois sur les communications et les transactions électroniques
Le Gabon veut renforcer les lois sur les communications et les transactions électroniques. Et cet effet, le gouvernement a, au cours d’un conseil ministériel le 21 juin, approuvé deux projets lois qui vont régir le secteur.
Le premier projet vise à améliorer le cadre juridique en favorisant une concurrence loyale au bénéfice des utilisateurs des réseaux et services de communications électroniques. Le même texte entend encadrer le développement des réseaux et services en favorisant les initiatives permettant l’adaptation à l’évolution des technologies et des progrès scientifiques.
Le second projet, quant à lui, vise la mise œuvre d’un environnement juridique conforme aux bonnes pratiques internationales et aux normes communautaires dans le domaine des transactions électroniques. « L’adoption de ces deux projets de lois vise à doter le secteur de l’Economie numérique des outils juridiques indispensables à son développement », précise le communiqué final du conseil des ministres.
SA
Le gouvernement gabonais entérine un projet de loi créant une Commission nationale d’affectation des terres
Le Conseil des ministres a entériné le 21 juin à Libreville le projet de décret portant création et organisation de la Commission nationale d’affectation des terres (Cnat).
Ce sera une commission interministérielle dont la mission principale sera d’élaborer un plan national d’affectation des terres. Pour ce faire, le Cnat devra collecter et centraliser l’ensemble des informations relatives aux affectations des terres sur l’étendue du pays et mener des consultations avec les autorités et les populations locales. Sans oublier d’encadrer et de définir l’utilisation du territoire aux fins de garantir la compatibilité des activités socio-économiques, l’intégrité environnementale et l’optimisation de la gestion des ressources naturelles.
La Commission disposera d’un Secrétariat permanent qui se réunira au moins une fois par trimestre en session ordinaire. Elle comprendra un président, qui sera le ministre chargé du Développement durable ou son représentant. Le Cnat sera par ailleurs constitué de 25 membres parmi lesquels, le directeur général de l’Agence nationale de la pêche et de l’aquaculture, celui du Droit de la mer, de la Marine marchande, etc.
Sylvain Andzongo
Libreville dans le top10 des villes les plus chères en Afrique pour les expatriés
La 23ème enquête annuelle de Mercer sur le coût de la vie, publiée ce mercredi 21 juin 2017, révèle que la capitale gabonaise fait partie des villes africaines qui arrivent en tête de liste, des destinations les plus chères en termes d'affectation à l'étranger.
Selon cette étude, la capitale gabonaise passe ainsi de la 28e position mondiale l’an dernier, à la 33e cette année et pointe au 7e rang continental.
Luanda arrive en première position en tant que ville la plus chère pour les expatriés en Afrique et dans le monde, sur les 209 cités recensées, malgré l'affaiblissement de sa monnaie par rapport au dollar américain.
La capitale angolaise est suivie par Victoria (14e mondiale et 2e africaine), Ndjamena (16e mondiale et 3e africaine), Kinshasa (18e mondiale et 4e africaine) ; Lagos (29e mondiale et 5e africaine), Brazzaville (31e mondiale et 8e africaine) et Libreville (33e mondiale et 7e africaine).
La suite du top 10 est composée d’Abidjan (42ème mondiale et 8e africaine); Djibouti (49ème mondiale et 8e africaine) et d’Accra qui ferme la liste, (54ème mondiale et 10e africaine). En revanche, Tunis est la ville la moins chère dans ce classement.
Par ailleurs, cette 23ème enquête annuelle de Mercer révèle que certains facteurs, tels que l'instabilité du marché du logement et l'inflation touchant les biens et services, contribuent au coût global de l'activité des entreprises dans l'environnement mondial actuel.
Stéphane Billé