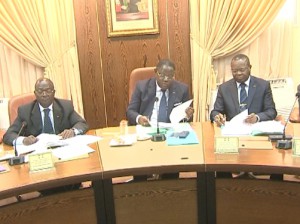Le Nouveau Gabon
Le Fonds d’initiative départementale sera lancé en avril
En sus des questions relatives à la protection sociale, la solidarité nationale, le financement des régies des travaux publics et du réseau de drainage des eaux pluviales, ou encore des conditions et modalités de privatisation de la rémunération des personnels de l’État, la création et la mise en place du Fonds d’initiative départementale (FID), était au centre du conseil interministériel présidé par le Premier ministre gabonais, ce 22 mars 2018.
Le fonds dont l’objectif vise à assurer le financement de projets communautaires dans chacun des départements du pays, a été annoncé par le président de la République lors de son message à la Nation le 31 décembre 2017.
Le projet d’arrêté qui fixe les modalités de gestion du fonds ainsi que la mise en place de ses organes de gestion que sont les gouvernorats, les conseils départementaux et les collectivités territoriales décentralisées, a été soumis à l’examen des départements ministériels concernés.
Le texte permet aussi d’identifier les secteurs éligibles et la détermination des critères d’éligibilité au financement des projets communautaires, avec la prise en compte de l’impact sur la population. En attendant son opérationnalisation, le lancement du FID est prévu, d’après le gouvernement, au mois d’avril prochain.
PcA
Ali Bongo vérifie l’effectivité de la gratuité de l’accouchement dans les hôpitaux de Libreville
Les annonces présidentielles de la Saint Sylvestre concernant la gratuité des frais d’accouchement dans les formations hospitalières publiques du Gabon, ont été passées au crible par le chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba, au cours de la journée du 22 mars 2018.
Dans les centres hospitaliers universitaires de Libreville et d’Owendo, le président de la République, accompagné de la Première dame, a visité les services de la maternité, de la néonatologie ainsi que celui de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS), partenaire de l’opération.
Pour le président de la République, la mise en œuvre de cette mesure prioritaire constitue un symbole de son engagement dans la lutte pour l’accès des populations à de meilleurs soins de santé.
« Je suis toujours à l’écoute de la population gabonaise. J’ai beaucoup discuté avec des mères de famille. Et je peux vous dire que nous sommes, depuis quelques années, préoccupés par tout ce qui touche à la question de la naissance et son environnement. Aucune femme ne doit mourir en donnant la vie et les enfants qui naissent doivent venir au monde dans un environnement sain. L’accouchement gratuit ne doit donc pas rester que des mots, cela doit se matérialiser. Je suis donc venu me rendre compte que tout se passe bien », explique le chef de l’Etat.
La descente du chef de l’Etat et de son épouse sur le terrain intervient après que des kits d’accouchement et de layettes ont été distribués dans différents hôpitaux publics de Libreville. Un processus qui s’étendra prochainement sur l’ensemble du territoire national, selon les autorités.
Pierre Célestin Atangana
La Beac a révisé le dispositif des réserves obligatoires des banques de la Cemac
A l’issue d’une réunion du Comité de politique monétaire (CPM) de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (Beac), le gouverneur Abbas Mahamat Tolli a annoncé, le 21 mars à Yaoundé dans la capitale camerounaise, qu’il a été décidé de « réviser le dispositif des réserves obligatoires » des 52 banques de la zone Cemac.
Concrètement, a expliqué Abbas Mahamat Tolli, « on a revu le mode calcul des réserves obligatoires des avoirs des banques à la Banque centrale ». Par le passé, a-t-il relevé, c’était assez rigide. « Avec le nouveau mode de calcul, plutôt que de sanctuariser de façon permanente les montants, les banques en fonction de leurs dépôts, ont une flexibilité au niveau de la gestion de leur trésorerie. C’est un allégement qui permet aux banques d'avoir des marges dans la gestion de leur trésorerie. », a indiqué le gouverneur.
M. Mahamat Tolli a expliqué que, de par la loi, les banques de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cameroun, Congo, RCA, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad), sont obligées d’avoir un niveau de réserves de dépôts régulièrement rémunérées à la Beac. Ceci pour prévenir des risques.
Sylvain Andzongo
Après la découverte d’un puits, Petronas et le Ministère du pétrole évaluent le potentiel du gisement
A la suite de la découverte d’une couche pré-salifère riche en hydrocarbures de 90 mètres d’épaisseur, après un forage de 2800 mètres au large des côtes gabonaises, la compagnie pétrolière malaisienne Petronas et le Ministère du pétrole et des hydrocarbures vont procéder à une évaluation du potentiel de ce puits situé dans le bloc F-14, encore appelé Likuale, renseigne le site Energie Media.
PC Gabon Upstream S.A. (PCGUSA), filiale locale de la compagnie pétrolière malaisienne, se chargera de réaliser ce travail dans le pays, aux côtés de son partenaire australien Woodside Petroleum, propriétaire de 30% de parts dans ce bloc situé à 160 kilomètres de Mayumba, province de la Nyanga, sud du Gabon.
D’après les responsables de Petronas, cités par le média en ligne, le gisement découvert au large des côtes gabonaises est « capable de stimuler l’industrie pétrolière et gazière du Gabon ».
L’évaluation des ressources commercialisables, réalisée conjointement par l’Etat et l’opérateur, permettra d’avoir une photographie réelle des bénéfices attendus par chaque partenaire sur ce bloc où Petronas a conclu, avec le Ministère du pétrole, un accord de partage de production en 2014, lors de son entrée dans le pays.
PcA
Le Gabon envisage se doter d’un code de l’eau et de l’assainissement
Les questions de production et de distribution de l’eau constituent désormais une véritable préoccupation pour le gouvernement gabonais. Cela a une fois de plus été manifesté jeudi 22 mars, par le ministre en charge de l’Eau et de l’Energie, Patrick Eyogo Edzang (photo), dans son discours marquant la célébration de la journée mondiale de l’eau.
A la faveur de cet événement, le membre du gouvernement a, non seulement appelé chaque Gabonais à une utilisation rationnelle du précieux liquide, mais également à adopter un comportement citoyen. Une attitude qui, selon lui, passe par la pratique d’habitudes de base telles que la réparation des fuites domestiques et la gestion responsable des ordures ménagères, pour éviter le gaspillage et la pollution de cette ressource.
Loin de s’arrêter à ces dispositions pédagogiques, Patrick Eyogo Edzang a tout aussi déploré l’absence d’un cadre réglementaire et institutionnel, notamment la politique nationale de l’eau, le Code de l’eau et le retard d’investissement en infrastructures de mobilisation de cette ressource et de sécurisation de la desserte en eau potable.
Pour pallier ces difficultés, le pays avec l’appui de ses partenaires au développement, a décidé d’intégrer la dynamique universelle en s’arrimant aux standards mondiaux en matière de gestion efficiente du secteur de l’eau. Laquelle dynamique passe nécessairement par une participation active dans les organismes dédiés d’une part, et l’organisation du secteur ainsi que la réalisation des investissements nécessaires d’autre part.
Dans ce cadre, le gouvernement a récemment pris acte d’un projet de politique nationale de l’eau par la soumission d’un Projet d’adoption d’une Loi portant Code de l’eau et de l’assainissement en République gabonaise. Ledit cadre réglementaire permettra entre autres, de créer un Fonds de l’eau à même de faciliter l’autofinancement de ce secteur.
De même, sous l’égide de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEEAC), le Gabon a décidé de mettre en place un mécanisme de gestion intégrée des ressources en eau. Membre du Conseil des ministres en charge de l’eau (AMCOW) depuis 2014, le Gabon s’est déjà doté d’un cadre institutionnel de gestion de la ressource en eau en 2016.
Stéphane Billé
La directrice générale de L’UNESCO, Audrey Azoulay en visite au Gabon, du 28 au 30 mars prochain
En prélude à la visite prochaine d’Audrey Azoulay (photo), la directrice générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) au Gabon, le gouvernement s’active afin de lui réserver un accueil des plus cordiaux. Par ailleurs, les autorités gabonaises entendent mettre à profit cette visite, pour consolider la relation partenariale UNESCO-GABON, en lui donnant tout son « sens, sa cohérence et sa lisibilité ». Plusieurs points sont inscrits au cœur des préparatifs. Il s’agit notamment de voir l’état de la coopération entre le Gabon et l’UNESCO, les projets d’accords communs entre les deux parties et enfin, le contenu à donner à cette visite.
Toutes ces questions ont constitué la toile de fond de la réunion préparatoire organisée par le Premier ministre, Emmanuel Issoze Ngondet le 21 mars dernier. Avec les ministres d’Etat en charge de la Forêt et de l’environnement, Pacôme Moubelet Boubeya, de l’Enseignement supérieur, Guy Bertrand Mapangou ; de la Culture, Alain-Claude Billie-By-Nzé, et du ministre délégué aux Affaires Etrangers Sylvie Léocadie Nzaou, il a donc été question ainsi d’apprécier le programme de cette visite et son contenu. Notamment, les sujets d’intérêt commun portant sur l’éducation, tel que le programme « Train my generation » qui concerne près de 5 000 jeunes. Une remise de diplômes et une visite dans une école professionnelle, dont les programmes sont soutenus par l’UNESCO sont également prévues à cet effet.
Dans le domaine de l’environnement, il sera question d’apprécier la stratégie à moyen terme de l’organisme onusien relative à l’agenda 2030 consacré aux objectifs de développement durable et à la biodiversité.
Dans le secteur de la culture, un accord cadre ou un mémorandum d’entente pourrait être signé pour renforcer les bases de la coopération culturelle et technique. Audrey Azoulay devrait aussi se rendre au musée national d’arts et traditions pour voir la grandeur de notre patrimoine culturel.
Stéphane Billé
Après 2020, l’Afrique veut un APE de développement
Les travaux de l’assemblée parlementaire des pays du groupe Afrique Caraïbes et Pacifique (ACP) à Bruxelles se sont achevés par une position commune des pays du continent.
Au terme des travaux qui ont élu un nouveau président à la tête de l’assemblée parlementaire, les pays ACP, notamment le groupe africain, ont posé sur la table, le débat de la période post 2020.
«Nous avons ouvert cette négociation conformément au mandat reçu des chefs d’Etat et nous devons aller vers un accord gagnant-gagnant, un accord qui prenne en compte les autres acteurs, pas seulement l’Union européenne. Et le nouvel accord devrait avoir une disposition parlementaire forte.», explique le nouveau président de l’assemblée parlementaire du groupe ACP, Owono Kono. Car, le nouvel accord dont les négociations doivent être conclues avant 2020, voulu par les pays africains, va prioriser la dimension développement et non plus le commerce. Bien que des divergences soient apparues dans les discussions entre les délégués africains sur le calendrier et son contenu.
«Nous avons des valeurs communes ; et à partir de là, nous devons rester unis contrairement à l’approche de l’Union européenne qui veut travailler avec des sous-régions à part.», lance Vichy Katamwa, chef de délégation de RDC aux travaux.
Au-delà des difficultés à faire entendre la voix des pays du continent et à imposer leur voie, certains participants estiment qu’il est temps de se prendre en main par-delà les contraintes et les préoccupations que rencontrent les Etats dans leur vécu quotidien.
«Il est temps de se prendre en main. Parce que ce qui me déconcerte c’est la référence à l’Union européenne alors que nous sommes des peuples souverains.», fulmine Jean Philibert Mabaya, député de RDC.
Les pays africains demandent une réforme de la coopération économique avec l’Union européenne afin que celle-ci soit favorable à l’essor d’Etats développés au détriment des accords commerciaux qui déséquilibrent de manière structurelle leurs économies.
PcA
Zone de libre-échange continentale africaine : le défi de la transformation
44 pays ont apposé leur signature au bas de l’accord portant mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), à Kigali, le 21 mars 2018. Si l’une des économies les plus en vue du continent, le Nigeria, n’a pas cru bon devoir se rendre au Rwanda, il reste cependant que plusieurs Etats y voient la volonté de faire chorus face à l’invasion du marché africain par des produits importés d’ailleurs.
« Elle favorisera la création de nombreux emplois et une croissance plus inclusive porteuse d’un développement harmonieux et équilibré pour notre continent », confie le chef de l’Etat gabonais, Ali Bongo Ondimba.
Au-delà de l’euphorie, les réticences nigérianes soulèvent quelques interrogations, quant à l’implémentation et l’opérationnalisation de ce vaste marché de 1,2 milliard de consommateurs, avec un PIB dont le potentiel est estimé à 2500 milliards de dollars.
Plus qu’un espace commercial, c’est d’abord un espace de production de richesses qui vient de voir le jour à Kigali. Entre ceux qui appellent à la retenue pour sa mise en œuvre effective annoncée pour janvier 2019, et les pourfendeurs de cet accord qui y voient une précipitation, une analyse de la situation économique de certains Etats s’impose.
Car, en Afrique du Nord et dans les pays du Maghreb, le tissu économique est relativement solide et peut faire face aux besoins de consommation des ménages. Du coup, le volume des importations de certains produits en provenance d’Asie, d’Amérique ou d’Europe n’est pas aussi élevé que dans les pays d’Afrique subsaharienne où les industries sont encore embryonnaires, dans certains cas, voire quasi inexistantes dans d’autres.
Ce qui rejoint les réserves de certains observateurs qui avaient estimé que les pays devraient au préalable disposer d’une structure d’échanges solide, capable de faire concurrence à la production étrangère. Il faudra pour cela que les pays africains puissent ravitailler les ménages en denrées alimentaires de toute nature et mettre un terme aux importations qui, en 2016, ont siphonné plus de 65 milliards de dollars au continent.
Parmi les produits les plus prisés, l’on note les céréales (riz, maïs et blé), les produits laitiers, la viande et les produits de viande, le sucre, les produits de confiserie, les huiles comestibles et les graisses alimentaires. Difficile de croire que les 44 signataires de cet accord disposent de manière équitable et complémentaire, d’industries ou d’une agriculture capables de subvenir à la demande africaine de ces principaux produits.
L’enjeu de la mise en œuvre de la ZLECA réside donc dans la production, si l’on veut retenir la masse importante de devises qui s’évade chaque année vers l’Occident, l’Asie ou encore l’Amérique.
Etre capable de nourrir les centaines de millions de bouches africaines, grâce au travail de la terre et à l’élevage, changer les habitudes de consommation en s’émancipant du complexe du colonisé, mettre sur pied un tissu industriel compétitif capable d’approvisionner les populations en biens manufacturés.
Produire en quantité et en qualité des biens de consommation très prisés sur le continent, devra constituer la préoccupation des dirigeants des pays signataires, plutôt que de penser à la protection d’un espace économique ouvert aux importations du fait de l’absence de masse critique de produits locaux.
En somme, la structure des échanges devra changer et ne plus être adossée aux hydrocarbures et à d’autres matières premières. Plus qu’une zone de libre-échange, ce sera une zone de transformation continentale globale avec, à la clé, l’amélioration et le développement des infrastructures de transports et énergétiques, en même temps qu’il faudra accentuer des complémentarités dans les économies africaines pour une production équilibrée.
PcA
Pour le Gabon, la zone de libre-échange est porteuse de développement
Parmi les 44 signataires de l’Accord de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) du 21 mars 2018 à Kigali, l’on note la présence du président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, par ailleurs président en exercice de la CEEAC. Pour lui, la signature de cet accord est un tournant historique dans les relations des peuples en Afrique et constitue une marque d’optimisme dont les pays du continent devraient s’approprier les avantages et les bienfaits.
«En signant l’acte juridique de la zone de libre-échange continentale africaine, nous pouvons d’ores et déjà être optimiste… Elle favorisera la création de nombreux emplois et une croissance plus inclusive porteuse d’un développement harmonieux et équilibré pour notre continent », indique le chef de l’Etat dans le communiqué de la présidence de la République.
L’intégration continentale africaine demeure, selon Ali Bongo Ondimba, la seule option pour l’émergence économique de l’Afrique, ainsi que son insertion dans le concert des Nations et dans une économie mondiale et globalisée en constante mutation. Car à terme, la mise en œuvre de la ZLECA permettra la suppression des barrières tarifaires et douanières entre les pays signataires, le renforcement de la compétitivité africaine, en plus de stimuler le commerce intra-Africain de 53 %.
Aussi, poursuit le communiqué de la présidence de la République, favorisera-t-elle l’ouverture sur le continent, d’un marché commun de 1,2 milliard de consommateurs. «La CEEAC, conclut le chef de l’Etat, a amorcé le processus de libéralisation et entend s’inscrire résolument dans le marché de la Zone de libre-échange continentale africaine. Nos Etats membres adoptent actuellement des mesures de suppression de visas d’entrée sur leur territoire national afin de favoriser la libre circulation des personnes et des biens.»
Pierre Célestin Atangana
Le gouvernement et la société Averda trouvent un modus vivendi sur la crise de la gestion des ordures ménagères
En service très minimum depuis quelques semaines, la société Averda, chargée de la collecte et de la gestion des ordures ménagères à Libreville, devrait reprendre du service normalement à partir du 22 mars 2018. C’est ce qui ressort de l’audience accordée, ce 21 mars 2018, par le ministre d’Etat, en charge du Budget et des Comptes publics, Jean Fidèle Othandault, au Directeur du développement d’Averda, Nicolas Achkar.
Au cours de cet entretien, les deux parties ont naturellement fait le point sur tous les contours de ce dossier. Ainsi, au-delà de la question de la dette intérieure de l'Etat vis-à-vis de la société Averda, la question de la décharge ainsi que le problème de la révision de la convention entre les deux parties ont également été évoquées.
Au terme de cet entretien, les deux parties ont fini par trouver un terrain d’entente. Pour la reprise de services, l’Etat gabonais va débloquer un montant de 1 500 000 000 FCFA à la société Averda. Quelque peu détendu au sortir de cette audience, Nicolas Achkar a indiqué que «ce qu’il faut retenir de ces échanges avec le membre du gouvernement, c’est qu’on a pu avancer dans notre position. Et dès aujourd’hui, nos équipes vont reprendre du travail. Nous avons également réitéré au ministre d’Etat, notre dévouement pour le Gabon».
Pour le ministre d’Etat, Jean Fidèle Otandault, «Il est souhaitable de retenir que des efforts ont été accomplis par le gouvernement pour cette sortie de crise en ces temps de difficultés financières. En effet, l’Etat a fait beaucoup d’efforts pour apporter une solution définitive à ce problème d’insalubrité à Libreville. Car, comme vous le savez, l’hygiène et la santé n’ont pas de prix. Sous l’impulsion du chef de l’Etat, il était tout à fait normal et temps que le gouvernement se saisisse de ce dossier et essaye d’apporter une solution définitive à ce problème».
Pour rappel, le 15 mars dernier au sortir d’une audience avec le ministre de l’Intérieur, Lambert-Noël Matha, Nicolas Achkar avait indiqué que la dette de l’Etat gabonais vis-à-vis de la société Averda, s’élevait à près de 16 milliards FCFA. Faute de paiement, depuis plusieurs semaines, Libreville croule sous le poids des immondices.
Stéphane Billé